Les langues Néo-Latines – 109e année – 4 – n° 375 – Décembre 2015 33 1. Ángel R
Les langues Néo-Latines – 109e année – 4 – n° 375 – Décembre 2015 33 1. Ángel ROSENBLAT, La lengua del Quijote, Madrid, Gredos, 1971, p. 167. Je traduis. À Jean Vilar, in memoriam En réalité tout est jeu dans le Quichotte, mais jeu pour signaler un sens ou un double sens. Tout nous apparaît porteur d’une double intention, bonne ou mau- vaise, ou bonne et mauvaise, une double et même une triple ou une quadruple intention1. Cette affirmation de Ángel Rosenblat a inspiré le jeu de dérivation du titre de cet exposé et je traiterai donc de cette facétie cervantine qui, avec Don Quichotte, fait du livre l’enjeu de lui-même. Le jeu y appa- raît comme un trait constitutif qu’il soit revendicatif ou stratégique, narratif ou stylistique, spéculatif ou générique. Cervantès combine les stratégies d’occultation et de séduction qui entraînent le lecteur dans la complexité féconde de son œuvre par la voie du plaisir. La mise en abyme est une figure récurrente dans l’architecture du roman et le motif du livre ou des livres dans le livre s’impose comme l’un des plus féconds par les livres de référence bien sûr, mais surtout par le roman lui-même. Je partirai de la matérialité concrète du livre de papier, objet présent dans le roman, feuillets manuscrits ou volume relié, de la bibliothèque à l’imprimerie, pour aller vers la représentation imaginaire du livre- texte, sujet de la narration autant que des discours théoriques qui s’y mêlent. Marthe Robert décrit fort justement ce « mouvement d’une DON QUICHOTTE : LES ENJEUX DU LIVRE OU LE LIVRE EN JEU(X) Isabelle ROUANE SOUPAULT Aix Marseille Université CAER- EA 854 34 Isabelle Rouane Soupault 2. Marthe ROBERT, Roman des origines et origines du roman, Paris, Gallimard, 1972, p. 11, note 1. 3. Miguel de CERVANTES, Don Quijote de la Mancha, ed. de Francisco Rico, Barcelona, Punto de Lectura, 2013 (I, 2, p. 35). La traduction utilisée est celle de Jean-Raymond FANLO, Don Quichotte, Le livre de poche, Paris, 2008, ici p. 151. J’indiquerai à la suite de la référence à cette édition celle du texte espagnol : Miguel de CERVANTES, Don Quijote de la Mancha, ibid. Ici II, 2, p. 565. 4. Don Quichotte, ibid., p. 668 ; II, 3, p. 566. 5. Voir Daniel Henri PAGEAUX, Les aventures de la lecture. Cinq essais sur le Don Quichotte, Paris, L’Harmattan, 2005, 3. Des livres au livre, p. 73-86. littérature qui, perpétuellement en quête d’elle-même, s’interroge, se met en cause, fait de ses doutes et de sa foi à l’égard de son propre mes- sage le sujet même de ses récits »2, ce mouvement qui est à l’origine du Quichotte et fonde sa modernité. Dès les premières pages du Quichotte de 1605, on perçoit cette mise en miroir : alors que don Quichotte se prépare à sa première sortie, il se projette déjà dans la mise en récit de ses aventures. Tel un nouvel Amadis, il imagine le livre dont il sera le héros : « Qui doutera que dans les temps à venir, lorsque la véridique histoire de mes exploits fameux viendra à la lumière, le sage qui les écrira [...] »3. Cette première projection du protagoniste en héros réflé- chit l’image du livre dans le texte : la véridique histoire est celle dont le lecteur est en train de prendre connaissance et son auteur entame un jeu de cache-cache aux multiples déclinaisons dont il sera question plus avant. Dès le chapitre deux du volume de la Seconde partie, le livre est une réalité éditoriale incluse dans la fiction nouvelle par l’annonce de Samson Carrasco aux deux principaux personnages. L’effet de sur- prise est suivi d’un sentiment de perplexité du héros-protagoniste qui pose clairement le problème de cette réflexivité, au sens où l’entendait Bourdieu, du personnage qui devient pour lui-même un sujet d’étude : « Don Quichotte resta tout pensif à attendre Samson Carrasco dont il comptait entendre des nouvelles de lui-même mises en livre [...] »4. Ainsi s’installe le jeu principal et l’enjeu majeur de cette Seconde Par- tie : tout se passe comme si le personnage fictif était renvoyé dans un monde réel dans lequel la fiction l’informe de sa réalité de personnage. Désormais, fort de sa renommée livresque, qui n’est pas forcément celle qu’il avait imaginée, il se sait lu et il va voir le monde l’imiter comme il a pu, par le passé, imiter ses héros épiques favoris. Cervantès offre au lecteur un texte qui construit progressivement son propre uni- vers fictionnel5. Ces jeux de miroirs invitent à une réflexion sur les modalités de l’écriture fictive tout en satisfaisant au « plus haut but 35 Don Quichote : les enjeux du livre ou du livre en jeu(x) 6. Don Quichotte, ibid., p. 599 ; I, 47, p. 492. 7 Don Quichotte, ibid., p. 604 ; I, 48, p. 497. 8. Jean CANAVAGGIO, Cervantès, Paris, Mazarine, 1986, chap. 6 : « Le métier d’écrivain », p. 255-302 ; Michel MONER, Cervantès conteur. Écrits et paroles, Ma- drid, Casa de Velázquez, 1989, « L’objet », p. 17-46. 9. I, 1, p. 28. qu’on puisse viser dans un écrit, enseigner et plaire en même temps [...] »6, comme le dit le chanoine dont le discours normatif rappelle les préceptes aristotéliciens et horatiens qui président à toute composition littéraire à l’époque. Par un constant retour au texte, je vais ici envisager d’abord les enjeux économiques et leurs conséquences en termes de notoriété et de légitimité pour l’auteur ; puis, j’examinerai les enjeux esthétiques de ces propositions nouvelles pour tenter, en conclusion, de dégager l’enjeu philosophique de l’entreprise cervantine célébrée encore au- jourd’hui comme l’invention du roman moderne. Enjeu économique : du marché à la postérité Une brève remarque du curé rappelle les difficiles relations entre créateurs et éditeurs à cette époque charnière de la fin du XVIe siècle et ce qui est dit pour le théâtre vaut aussi pour la prose romanesque : « Mais comme les comédies sont devenues une marchandise à vendre [...] le poète essaie de s’accommoder à ce que lui demande l’homme de théâtre qui doit lui payer son travail »7. Comme l’ont écrit biographes et exégètes, Cervantès connaît bien ces soucis, et la préoccupation liée aux vicissitudes de l’ouvrage imprimé affleure régulièrement dans ses œuvres8. Des intérêts financiers aux fruits de la renommée Les ouvrages ont un coût : don Quichotte n’a-t-il pas dû vendre de nombreux arpents de terre pour acheter ses livres9. Au marché de Tolède, le narrateur précise qu’il n’a payé que medio real pour les pré- cieux manuscrits : une bonne affaire soulignée avec malice comme pour mieux rappeler les aléas de ce marché. Contrairement aux in- variants du motif des romans de chevalerie, le manuscrit n’a pas été retrouvé mais bien acheté. Cette transaction commerciale dissipe le 36 Isabelle Rouane Soupault 10. Don Quichotte, ibid, p. 1109 ; II, 62, p. 1032-1033. 11. II, 3, p. 567. 12. Don Quichotte, ibid., p. 669. 13. Don Quichotte, ibid., p. 756 ; II, 16, p. 662. 14. Don Quichotte, ibid., p. 152 ; I, 2, p. 35. 15. Don Quichotte, ibid., p. 673 ; II, 3, p. 571. mystère de la tradition et oppose un contrepoint concret à l’idéalisation de l’écrit en faisant entrer la réalité économique dans la fiction. La scène de l’imprimerie de Barcelone, à la fin du parcours, achève de confirmer l’essor de la nouvelle industrie. Don Quichotte, curieux de découvrir cette technique, s’enquiert auprès d’un auteur des conditions financières de l’édition. Les chiffres, sciemment répétés dans le récit, attestent de la tension latente entre commerce et création : « Je m’im- prime à mon compte et j’espère gagner au moins mille ducats pour cette première impression qui va atteindre deux mille exemplaires ». Et la conclusion de ce dialogue est claire : « Je cherche le profit car sans lui la bonne réputation ne vaut pas un liard »10. Pour prouver le succès de l’histoire, Samson Carrasco dresse un inventaire éditorial qui coïncide avec la liste des grandes places commerciales du royaume11 et les chiffres sont là pour l’attester puisque « [...] au jour d’aujourd’hui, on a en imprimé plus de douze mille livres »12. Mais la fiction reprend vite ses droits : la géographie se dilate et les données chiffrées dérapent lorsque le chevalier témoigne de sa fierté d’être le héros d’un best sel- ler : « J’ai mérité de parcourir maintenant par le livre toutes les nations du monde ou presque : on a imprimé trente mille volumes de mon his- toire, on est en voie d’en imprimer encore trente mille milliers de plus, si le Ciel n’y remédie »13. Le recours à l’hyperbole focalise la dérision sur les excès du personnage mais, à l’évidence, la raillerie atteint le système dans son ensemble. Pour don Quichotte, il n’est de renommée que si le livre est là pour la prouver. Il exprime très tôt sa foi en l’écrit par ce vœu : « Ô toi, sage enchanteur, qui que tu sois, à qui doit uploads/Litterature/ don-quichotte-les-enjeux-du-livre.pdf
Documents similaires





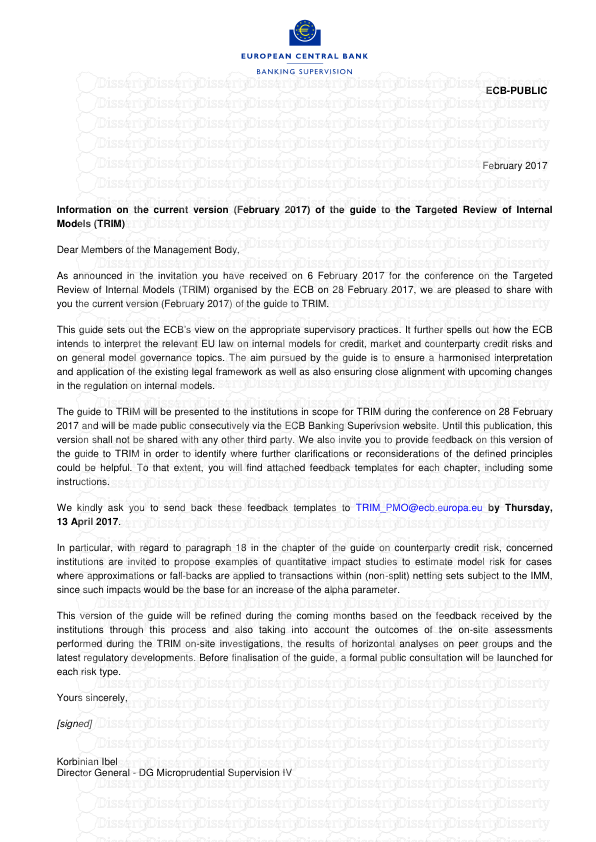




-
63
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 08, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2428MB


