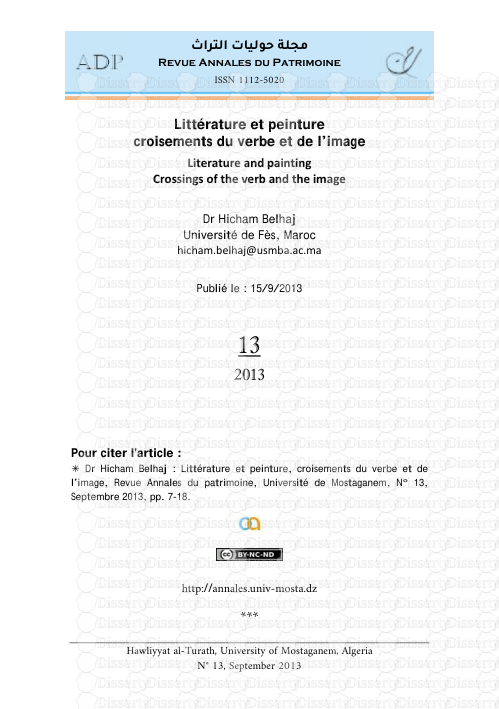ﻣﺠﻠﺔ ﺣﻮﻟﻴﺎت اﻟﺘﺮاث Revue Annales du Patrimoine ISSN 1112-5020 Hawliyyat al-Tura
ﻣﺠﻠﺔ ﺣﻮﻟﻴﺎت اﻟﺘﺮاث Revue Annales du Patrimoine ISSN 1112-5020 Hawliyyat al-Turath, University of Mostaganem, Algeria N° 13, September 2013 Littérature et peinture croisements du verbe et de l’image Literature and painting Crossings of the verb and the image Dr Hicham Belhaj Université de Fès, Maroc hicham.belhaj@usmba.ac.ma Publié le : 15/9/2013 13 2013 Pour citer l'article : Dr Hicham Belhaj : Littérature et peinture, croisements du verbe et de l’image, Revue Annales du patrimoine, Université de Mostaganem, N° 13, Septembre 2013, pp. 7-18. http://annales.univ-mosta.dz *** Revue Annales du patrimoine, N° 13, 2013, pp. 7 - 18 ISSN 1112-5020 Publié le : 15/9/2013 hicham.belhaj@usmba.ac.ma © Université de Mostaganem, Algérie 2013 Littérature et peinture croisements du verbe et de l’image Dr Hicham Belhaj Université de Fès, Maroc Résumé : Le rapport entre peinture et littérature n’est pas un sujet récent. Il a été abordé depuis l’Antiquité où l’on trouve l’idée que la peinture est une poésie muette tandis que la poésie est une peinture parlante. En Orient arabo- musulman, la condamnation des images formulée par le Coran va se solder par l’interdiction de la représentation des êtres vivants. Ce climat "aniconiste" va, en revanche, placer la calligraphie et la miniature au centre de l’art dit islamique. Au Maroc, l’aniconisme a refait surface avec la doctrine malékite. Cela a eu pour résultat l’éclipse peu ou prou totale de toute représentation figurative. Mots-clés : littérature, peinture, image, calligraphie, aniconisme. o Literature and painting Crossings of the verb and the image Dr Hicham Belhaj University of Fez, Morocco Abstract: The relationship between painting and literature is not a recent subject. It has been approached since Antiquity where we find the idea that painting is silent poetry while poetry is talking painting. In the Arab-Muslim East, the condemnation of images formulated by the Quran will result in the ban on the representation of living beings. This "aniconist" climate, on the other hand, placed calligraphy and miniatures at the center of so-called Islamic art. In Morocco, aniconism resurfaced with the Maliki doctrine. This has resulted in the more or less total eclipse of all figurative representation. Keywords: literature, painting, image, calligraphy, aniconism. o La littérature et la peinture ont, depuis longtemps, partie liée. Simonide dit que : "la peinture est une poésie muette et la Dr Hicham Belhadj - 8 - Revue Annales du patrimoine poésie une peinture parlante". Le rapport qui unissait les deux modes d’expression était un rapport de subordination de l’image au texte. Car ce dernier a toujours été au service de la première. Dans le présent article nous essayerons de retracer l’histoire de ce rapport en Occident chrétien, en Orient arabo-musulman et au Maroc depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Notre approche se veut ainsi historiciste et quasi-narrative. Elle va s’articuler autour de trois parties : la première est consacrée aux convergences historiques du texte et de l’image en Occident, la deuxième examinera le rapport entre le visible et le lisible dans l’art islamique, la troisième insistera sur le rôle de la revue "Souffles" au Maroc, et finalement celui des Editions "Al- Manar". 1 - Texte et image en Occident : Depuis l’Antiquité, les Anciens ont toujours rêvé de parvenir à une sorte de fusion entre les arts. Dans sa Poétique, le poète latin Horace n’a pas cessé de prôné un partage et une fusion entre peinture et poésie. Cette dernière devait constituer, par le bais des mots, une véritable traduction de ce que voyaient les peintres. Au Moyen-âge, la religion chrétienne, soucieuse de vulgariser les textes sacrés de la Bible pour qu’ils soient à la portée d’un peuple dont l’immense majorité est illettrée, a beaucoup favorisé l’échange entre le texte et l’image. La seconde, voulant substituer au premier, assumait la fonction d’une "Bible des illettrés" grâce à la mission didactique qu’elle devait remplir. Pendant la Renaissance, l’objet de l’art ne pouvait s’écarter de la trilogie "Nature - Homme - Dieu". L’artiste, qui vient d’obtenir ses titres de noblesse, se trouve chargé de restituer la beauté du monde, de la magnifier en vue de refléter une beauté supérieure, en l’occurrence celle de Dieu. Littérature et peinture travaillaient sur les mêmes thématiques inspirées en majorité de la mythologie antique. Littérature et peinture croisements du verbe et de l’image - 9 - N° 13, Septembre 2013 Au XVIIe siècle, les rapports entre le texte et l’image seront fortifiés. Le tableau est désormais considéré comme un poème muet. Les nouvelles explorations des astronomes vont contrebalancer certains fondements du Christianisme. Pour remédier à ces failles, l’Eglise catholique va proposer aux fidèles une religion séduisante en multipliant les décors et les ornements dans les lieux de culte. Cette nouvelle tendance va favoriser le développement de la peinture qui va, avec l’avènement du Classicisme, accéder au statut d’"art libéral", intellectuel, voire scientifique au même titre que la poésie. Au XVIIIe siècle, la dialogue entre les deux arts s’intensifie et s’enflamme suite aux controverses acharnées suscitées par la "Querelle des Anciens et des Modernes". Les prémisses du Romantisme transparaissent, une promotion du statut des écrivains et des peintres s’ensuit car les premiers peuvent, finalement, vivre de leurs plumes, les seconds de leurs pinceaux. La naissance de la critique d’art des écrivains, par Diderot, va consolider les rapports entre littérature et peinture. Avec le XIXe siècle, les convergences entre littérature et peinture sont plus que jamais massives grâce notamment au rôle promoteur qu’avaient joué à la fois le Romantisme, le Réalisme et le Symbolisme. Ces trois courants artistiques ont favorisé une réflexion théorique qui a eu un effet retentissant en esthétique. A cette même époque qui a vu fleurir une pléthore de doctrines littéraires et artistiques, l’osmose entre littérature et peinture est devenue fructueuse, bénéficiant ainsi de la "vague" de la correspondance entre les arts dont l’opéra wagnérien représente le modèle. Car dans cet opéra, se trouvent imbriquées et entrecroisées à la fois littérature, musique et peinture (grâce au choix des décors et des costumes). Par ailleurs, le dialogue entre l’art littéraire et plastique arrive au summum grâce au courant romantique qui va les alimenter de thèmes communs. Les peintres vont par conséquent s’adonner à l’écriture (Delacroix dans son Journal) et les Dr Hicham Belhadj - 10 - Revue Annales du patrimoine écrivains vont se pencher sur la peinture (Hugo dans ses dessins et aquarelles, Baudelaire et Fromentin dans leurs peintures occidentales). D’autres, en outre, comme Stendhal, Gautier, Baudelaire, Zola, Maupassant par exemple, ont préféré, en plus de leur métier d’écrivain, faire l’histoire de l’art et la critique picturale. Le dialogue entre les modes d’expression susmentionnés sera confirmé par l’avènement du Symbolisme, qui va chercher, grâce à sa conception spiritualiste du monde, d’autres moyens d’expression pour dépasser la simple représentation réaliste. Au XXe siècle, la modernité va favoriser le dialogue entre les deux arts littéraire et plastique par des thèmes qui renvoient au monde contemporain. La poésie va jouer un rôle fédérateur dans ce dialogue vu que de nombreux poètes vont être séduits par la peinture. La poésie d’Apollinaire, comme celle de Pierre Reverdy, s’est beaucoup nourrie du Cubisme. L’apparition de l’abstraction en peinture avec Kandinsky va inaugurer une nouvelle étape : celle où le tableau va s’éloigner de toute prétention mimétique ou "diégétique" pour ne renvoyer qu’à lui-même. Marcel Proust va rompre, dans le roman, avec la reproduction de la réalité. L’apparition du Nouveau Roman et du Surréalisme vont donner naissance à de nombreuses collaborations entre écrivains et peintres dont la plus célèbre est celle de Pablo Picasso et Paul Eluard. Ce dernier va d’ailleurs consacrer, dans son livre "Capitale de la douleur", plusieurs poèmes aux peintres contemporains tels Pablo Picasso, Paul Klee, Max Ernst. En outre, de nombreux recueils de poésie vont être illustrés par des peintures surréalistes. 2 - Texte et image dans l’art islamique : Le Coran, en de nombreux versets, formule une condamnation des images(1), d’où l’interdiction de représenter des êtres vivants. Cependant, les images dont parle le Coran dénotent celles qui sont dotées d’une fonction rituelle. Celles qui n’entrent pas dans cette catégorie, ne sont pas concernées par Littérature et peinture croisements du verbe et de l’image - 11 - N° 13, Septembre 2013 cette interdiction. Les images qui sont repoussées par l’Islam sont celles qui représentent une divinité car il est question d’une interdiction de l'idolâtrie et non pas de l'image elle-même. Ceci dit, la proscription des idoles n’a rien à voir avec la condamnation des images représentées. Ainsi, contrairement à ce que pense la majorité des critiques d’art musulmans, aniconisme et iconophobie ne sont pas mentionnés dans le Coran mais dans la Sunna. C’est la même idée que développe Rachid Benlabbah, en mettant, par ailleurs, l’accent sur la querelle des images en Islam. Ainsi pense-t-il que la condamnation des images est "l’œuvre du hadith et de la tradition des générations suivantes"(2). La relation qu’entretenaient les musulmans avec l’image était dans cette optique complexe dans la mesure où elle n’était ni interdite d’une manière explicite ni autorisée d’une façon définitive. Ce climat "aniconiste" va placer la calligraphie et la miniature au centre de l’art dit uploads/Litterature/ dr-hicham-belhaj-litterature-et-peinture-croisements-du-verbe-et-de-l-x27-image.pdf
Documents similaires










-
39
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 28, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1903MB