Revue internationale de l'enseignement E. Faguet. Drame ancien et drame moderne
Revue internationale de l'enseignement E. Faguet. Drame ancien et drame moderne. Colin, 1898 Th. Bonnerot Citer ce document / Cite this document : Bonnerot Th. E. Faguet. Drame ancien et drame moderne. Colin, 1898. In: Revue internationale de l'enseignement, tome 35, Janvier-Juin 1898. pp. 466-467; https://www.persee.fr/doc/revin_1775-6014_1898_num_35_1_3632_t1_0466_0000_2 Fichier pdf généré le 01/10/2019 466 REVUE INTERNATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT Chevaldin. — Grammaire appliquée , série synoptique de thèmes grecs et latins, Klincksieck, 1897, p. 219. M. C. nous offre ici, à propos d’un chapitre de Montesquieu, un essai parallèle de traduction grecque et latine. MM. Croiset et Benoist, ses maîtres — qu’il suffit de nommer — nous sont déjà de sûrs garants de la méthode. Le commentaire explicatif, les références, les index, font, de ce qui ne semblait qu’un corrigé, un véritable manuel de syntaxe comparée. Les meilleurs élèves des classes supérieures, ceux à qui on a pu appren¬ dre autre chose que les déclinaisons et les verbes, surtout nos étudiants, trouveront en M. C. un guide éprouvé. Ce livre, œuvre d’un maître de conférences, tenu à jour pendant 12 années d’enseignement, a été fait avec eux et pour eux, d’abord. Outre ces thèmes, les exercices pratiques de version grecque et latine, la critique détaillée de certaines traductions im¬ primées, tout à peu près est à méditer, à appliquer. Nous disons à peu près tout. A travel’s tant de questions de syntaxe, de vocabulaire, de styli¬ stique, d’interprétation, le moyen d’éviter, sinon toute erreur, du moins toute objection ? Mais, ubi plura nitent ..... les imperfections de dé¬ tail, entendez certaines particularités discutables, ne méritent pas de compter. Th. Bonnerot. E. Faguet. Drame ancien et drame moderne. Colin, 1898, in-18, p. 274. M. Faguet a estimé qu’il avait assez de fois dans ses livres, ses feuille¬ tons, touché au théâtre, depuis sa thèse française — où telle page résume d’avance le présent livre — pour coordonner ses observations et esquis¬ ser sa dramaturgie, sauf à laisser le mot à Lessing. Six chapitres lui ont suffi pour la théorie et les exemples. La tragédie française forme le centre. De même quelle nous est donnée comme le parfait exemplaire de l’esprit classique chez nous, le théâtre grec, lui, nous offrira la syn¬ thèse harmonieuse de tous les arts. Des cinq éléments qui la constituent, musique, plastique, lyrisme, épopée, drame, le théâtre moderne ou Sha- kesparien n’a gardé que les deux derniers, le théâtre classique français a eu assez de la partie dramatique allégée de sa partie épique. Mais il a, avec un art incomparable, fondu ses qualités propres — ethniques ou féo¬ dales _ avec le meilleur de la tradition antique. Ici c’est surtout le souci de la beauté qui domine. Là, chez nous, c’est une préférence marquée pour la raison, interprète éloquent d’une idée plutôt que d’un sentiment, qui s’incarnera dans un type général. L’Oreste grec sera, il est vrai, moins complexe que Hamlet, puisqu’il nous offre, non plus l’histoire de toute une vie, de toute une âme, de toute une époque, mais seulement la crise d’un héros. Par ce point capital, il n’est que plus voisin du génie français, Athènes se reconnaît encore à travers notre rhétorique latine. L’idéal qui crée les héros, le goût qui sait les faire agir et parler, voilà qui nous est commun avec les Grecs. Veut-on pousser la démonstration plus loin ? qu’on compare trois pièces assez semblables parle sujet, où l’on verra, non plus en puissance, mais en acte l’esthétique difféi’ente des trois thé⬠tres : Antigone, Roméo et Juliette, le Cid, c’est-à-dire, la beauté, la vie, la raison. Or, chez les deux classiques, la beauté et la raison tendent na¬ turellement à se rejoindre. Que de fois la vie, elle, n’est ni belle, ni rai¬ sonnable! ANALYSES ET COMPTES RENDUS 467 Voilà le squelette de ce livre, systématique, oui cei’tes, comme toute généralisation, mais inattaquable, dès qu’il sait faire la part des excep¬ tions, comme il n’a garde d’y manquer; aussi savant d’ailleurs dans son fond, que sobre, soutenu, et cependant toujours alerte dans sa forme. Pour l’écrire, il fallait être un critique très bien informé, qui connaît He-' gel, Schlegel, comme Voltaire, Patin, Mézières, P. Stapfer, mais ne croit pas utile de noyer son texte sous les citations. Il fallait être un huma¬ niste, nourri aux lettres antiques, et capable de comprendre, comme de1 faire comprendre Corneille et Racine, Shakespeare sans sacrifier Sophocle,1 par une ignorance ou un dilettantisme qu’il laisse à d’autres. Il fallait enfin, de cette culture classique avoir retenu — et heureusement déve¬ loppé — ce qu’elle dépose en germe chez la plupart, d’abord, largeur d’i¬ dées, puis sens de la mesure et de la composition. Ce sont qualités bieü françaises. Est-ce que, parlant ici de la tragédie française avant tout, par une conformité du ton avec le sujet, M. Faguet a voulu lui emprunter quelque chose de sa marche régulière, de son allure rapide ? toujours est- il que l’auteur a relégué les feux d’artifices dans la préface, et qu’il n’a jamais composé de « discours plus nu, plus facile à réduire à une seule proposition mise au plus grand jour par des tours variés ». Ces qualités ont leur place partout et surtout à l’Académie, si (comme nous le disait un de nos maîtres de Sorbonne) ce sont celles qu’ont toujours recherchées dans les livres présentés aux concours les Académiciens d’aujourd’hui, et ceux de demain. Th. Bonnerot. Roger Debury. — Ln pays de célibataires et de fils uniques . — Paris, Dentu, 1897. Le nom dont ce livre est signé est un pseudonyme. Le véritable nom de l’auteur que plusieurs journaux ont depuis longtemps révélé au public est Georges Rossignol, professeur d’histoire au Lycée de Bordeaux. 11 s’est moins proposé d’écrire un livre que de remplir un devoir patriotique. Il veut appeler l’attention du public et du gouvernement sur les dangers que nous fait courir l’arrêt de développement de la population française, tan¬ dis que celle de nos voisins et rivaux continue à s’accroître. Il a été, dans cette voie, précédé par d’autres écrivains qu’il se plaît d’ailleurs à citer. Il confesse l’exagération voulue du titre qu’il a donné à son livre. Il y a certes encore parmi nous des gens qui se marient et même des familles nombreuses, mais les uns et les autres se font de plus en plus rares. L’objet de l’auteur n’est pas tant de signaler le fait de la dépopulation de notre pays, fait depuis longtemps constaté et reconnu, que d’en signa¬ ler les conséquences nécessaires ou probables et surtout d’indiquer les re¬ mèdes que, suivant lui, nous pourrions encore apporter au mal. Cela expli¬ que qu’un seul chapitre, le premier, soit consacré à l’exposition des faits. L’auteur insiste surtout sur la comparaison entre la'France et l’Allemagne. Nous comptons actuellement 38 millions d’àmes et l’Allemagne 52 mil¬ lions ; c’est donc une avance de 14 millions qu’elle a déjà sur nous et tan¬ dis que notre population commence à décroître, la sienne s’accroît an¬ nuellement d’un demi-million. Si le mouvement continue, il y aura dans' cinquante ans environ 76 millions d’Allemands contre 38 millions de Français, autrement dit deux Allemands contré un Français. . s La conséquence immédiate de cet état de chose, c’est la décadence de notre pays. La France a dû sa grandeur dans le passé au chiffre considé- uploads/Litterature/ faguet-drame-ancien-drame-moderne-compte-rendu.pdf
Documents similaires








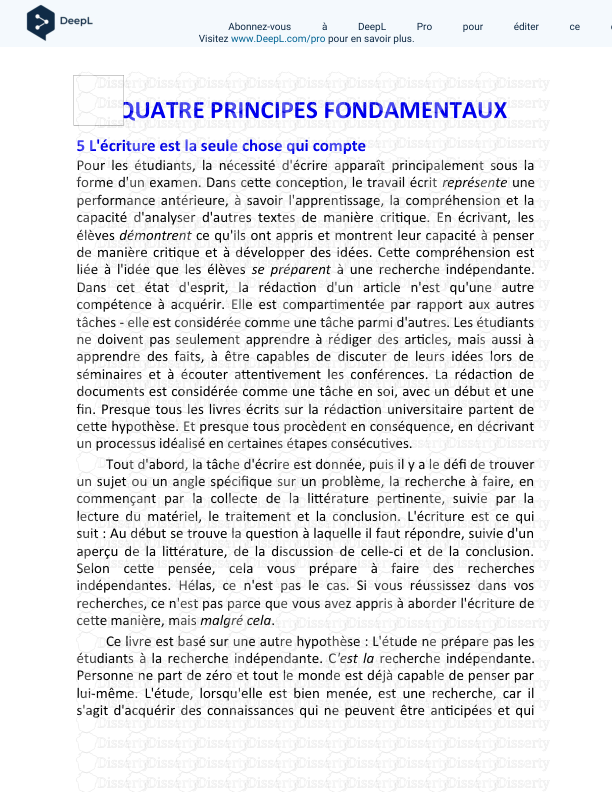

-
40
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 19, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2713MB


