Modèle du héros Identification avec le héros Caractéristiques du héros
Modèle du héros Identification avec le héros Caractéristiques du héros Environnement nouveau ou inconnu Frontière des âges et des littératures Passages du réel vers l’imaginaire Roman d’aventure = roman d’apprentissage Apprentissage de la lecture L’intégration du genre Enfance Foyer Adolescent Chaos Adulte Vie bourgeoise Frontière de l’aventure et frontière de l’enfance Quitter un monde quotidien (du lecteur) pour plonger dans un monde dépaysant, de revenir dans son univers initial Deux univers : le quotidien et celui de l’aventure 1. La transition se fait via un processus d’emboîtement – suivant un va-et-vient, un aller-retour du héros. 2. On bascule d’un monde quotidien dans lequel rien ne se passe vers un monde de l’action, qui est le lieu même du récit et dans lequel chaque choix devient l’essentiel à la survie du héros ---- basculement marqué par un voyage ou par une expulsion du héros 3. L’imaginaire est inséré dans le réel = enchâssée (mis en valeur) et mis à distance (le héros se trouve seul dans sa quête quelle que soit sa nature) --- un le réel est repérable par la mise à distance du réel ; loin du caractère fantasmatique. 4. Monde de l’aventure : le monde des possibles + le franchissement de la frontière = expériences de ces possibles, terrifiants, attirants La distance romanesque Mise en scène d’une rencontre triomphante avec la mort Le danger n’existe que pour assurer la victoire du héros Le RV obéit à un modèle téléologique d’apothéose du héros La logique du genre impose la victoire du héros et le retour à l’ordre Glissement qui se produire du principe de plaisir vers le principe de réalité = caractère double du processus mis en scène dans le RV : le héros rencontre des ennemis et des dangers démesurés, mais cette démesure n’est en définitive que l’expression d’une puissance démesurée du héros. On feint de croire à la fiction, mais on feint d’ignorer que le danger n’est lui-même qu’une fiction dans la fiction, puisque la logique du genre impose la victoire du héros et le retour à l’ordre. Romance, rêverie et jeu Lecteur-modèle du RV = le RV n’imite pas le réel, mais l’imaginaire ludique des enfants, cet ensemble que Caillois appelle le mimicry, le jeu de fiction, le jeu du « faire semblant » Le jeu de faire semblant (chercher de l’or, être pirate ou chef militaire) Le jeu et les rêveries : Robert Louis Stevenson : « La fiction est à l’homme adulte ce que le jeu est à l’enfant ». R.S. Stevenson : « le RV comme une dynamique d’involution, capable de susciter chez l’adulte des plaisir infantiles » « l’art du romancier est d’exalter le sentiment esthétique encore informe suscité par les rêveries et les jeux ». Analyse par chapitres UN Le protagoniste franchit deux seuils – du monde des vivants au monde des morts (il meurt à ce qu’il était) / et / du monde des morts à celui des vivants (il renaît initié) Julienne a des problèmes de santé et elle se fait opérée au cœur – changer une valvule *elle se trouve dans un état de dégradation parce que son mari s’occupe de tous les préparatifs médicaux « Moi, je restais à ma place, discrète et je faisais ce qu’on me disait de faire. Bien sûr, je happais quelques informations au passage. » DEUX « Cela a continué après mon retour » - l’opération a été un déclencheur de gourmandise Le départ pour l’aventure – le héros doit affronter le monde des morts pour renaître héros. Une fois vainqueur des forces nocturnes, le héros peur revenir à la lumière, au monde des vivants, mais il retourne transformé --- il est désormais un héros solaire. Héros adulte à la différence de la spécificité des romans d’aventure. On propose au premier une métamorphose qui renvoie à une idée de maturité. Importance du discours moral : « la gourmandise fait partie des sept péchés capitaux » TROIS On observe un désordre dans la famille – le marie ne lui rend visite que trois fois dans en mois au centre de rétablissement ; le fils n’en est même pas mentionné puisqu’il s’occupe des magasins et Julienne soupçonne son mari de tromperie. Julienne est habituée avec les réactions ou non-réactions de son mari 1) Elle ne lui a pas dit qu’elle mangeait énormément de religieuses 2) Elle lui a dit qu’elle allait passer l’examen de permis de conduire et pout tous les deux elle savait déjà les réponses. « … en Forêt Noir, cette lubie. » = fantaisie extravagante / c’est pendant le séjour en Forêt Noir, donc après l’opération qu’une multitude d’idée lui est frappé l’esprit = « elle revenait de plus en plus souvent … comme la crise de religieuse » - comme les enfants qui ne savent pas quand s’arrêter, car ils sont menés par des sentiments, et non par la raison. Donc, elle est en train de s’éloigner d’un monde gouverné par la raison. J’ai tendance à dire que les animaux n’ont pas de raisonnement et que leur existence est guidée par des instincts, par des impulsions inconscientes qui modifient sa façon d’être. Changement de situation : ne plus demander la permission comme elle le faisait avant « il m’a traitée de folle, de grande enfant » p.28 Elle a commencé de pleurer sans baisser les yeux « je sentais mon cœur de cochon pomper régulièrement, sereinement, me remplissant de vie jusqu’au bout des doigts. » « le moi du plafond m’est tombé dessus lourdement » « sur le moment ça m’a rempli d’une horreur qui me chatouillait de la tête au pied. » = la modulation de la relation au réel QUATRE « Avec Ferdinand, on s’est toute de suite bien entendue. » -- le pronom inclusif ON à valeur indéfini. C’est qui ON ? On commence à déceler que la protagoniste assite à plein de premières dans sa vie puisque sa vie prend une forme après la greffe de cœur. « C’était la première fois depuis le baccalauréat que je passais un examen ; » « je m’en souvient parfaitement » /vs/ « je happais quelques informations au passage. » Un témoignage d’une personne dont la vie a changé suite à une opération médicale. Différences des contes --- la relation au réel qui est proposée Emboîtement du merveilleux dans l’univers réaliste Le RV insiste sur l’unicité des mondes réaliste et merveilleux faisant de l’espace de l’aventure un espace hautement improbable, mais jamais impossible, jamais tout à fait merveilleux, séparé du quotidien par une frontière narrative et symbolique. CINQ un retour à un monde des rêves : Paris qui « était la ville de ses rêves » (quel enfant n’a pas rêvé d’aller sur un autre continent, de traverser le continent, de connaître un autre univers ?) le RV est un roman au sein duquel on retrouve « qqch de sa propre imagination. C’était, oui, son monde d’images ». Julienne se retrouve changée, voit la réalité avec d’autres yeux, n’est plus dérangeait par des habitudes qui la perturbaient avant (fumer : « moi qui détestais ça). Il joue comme les enfants : ils ont une quête – d’arriver à la tour Eiffel en faisant appel à l’imagination – retenir le réseau des moyens des transport à Paris Julienne se rend compte qu’elle avait construit sa vie selon les règles de la raison, et que son entourage avait fait de même : « Mais par sentiment, je croyais cela réservé à un âge ou à une catégorie d’individus dont j’étais très éloignée » *Julienne a vécu que par le biais de la raison et a supprimé son côté ludique et enfantin. Elle a perdu les images de l’enfance une fois attirée dans le monde adulte. Elle a franchi l’âge d’enfant et est passé dans l’univers adulte qui est soumis à la raison afin de trouver de la stabilité sociale. L’imaginaire n’est plus alimenté par désirs, impulsions ou intuition, mais par la logique. « J’ai suivi Ferdinand à Paris » / « c’est quand même autre chose » Julienne est absorbée par la redécouverte de son pouvoir imaginatif et Ferdinand, le moniteur de conduite, lui insuffle ses escapades dans le monde de la rêverie. « Cœur de cochon » - métaphore qui symbolise son cœur d’enfant qui est en train de réapparaître/de renaître dans son esprit et dans son corps. Comme le cochon est un animal qui est poussé par une impulsion innée, Julienne reçoit une greffe de cœur d’origine animalière, à savoir d’un « cochon engraissé pour ça ». L’opération a été un succès, puisque : « je sentais mon cœur de cochon pomper régulièrement, sereinement, me remplissant de vie jusqu’au bout des doigts. » Par analogie, on uploads/Litterature/ fiche-de-lecture-la-ballade-de-lucienne-jourdain.pdf
Documents similaires








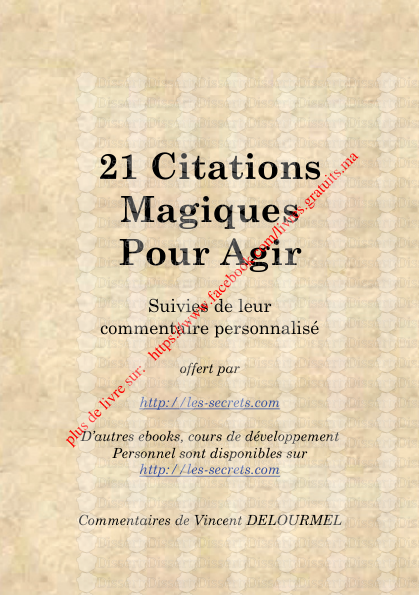

-
54
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 09, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0834MB


