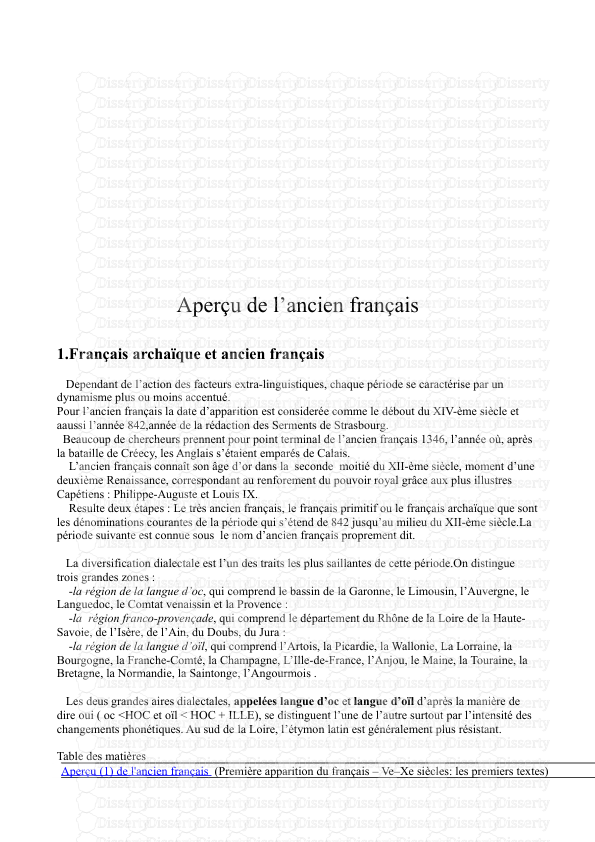Aperçu de l’ancien français 1.Français archaïque et ancien français Dependant d
Aperçu de l’ancien français 1.Français archaïque et ancien français Dependant de l’action des facteurs extra-linguistiques, chaque période se caractérise par un dynamisme plus ou moins accentué. Pour l’ancien français la date d’apparition est considerée comme le débout du XIV-ème siècle et aaussi l’année 842,année de la rédaction des Serments de Strasbourg. Beaucoup de chercheurs prennent pour point terminal de l’ancien français 1346, l’année où, après la bataille de Créecy, les Anglais s’étaient emparés de Calais. L’ancien français connaît son âge d’or dans la seconde moitié du XII-ème siècle, moment d’une deuxième Renaissance, correspondant au renforement du pouvoir royal grâce aux plus illustres Capétiens : Philippe-Auguste et Louis IX. Resulte deux étapes : Le très ancien français, le français primitif ou le français archaïque que sont les dénominations courantes de la période qui s’étend de 842 jusqu’au milieu du XII-ème siècle.La période suivante est connue sous le nom d’ancien français proprement dit. La diversification dialectale est l’un des traits les plus saillantes de cette période.On distingue trois grandes zones : -la région de la langue d’oc, qui comprend le bassin de la Garonne, le Limousin, l’Auvergne, le Languedoc, le Comtat venaissin et la Provence : -la région franco-provençade, qui comprend le département du Rhône de la Loire de la Haute- Savoie, de l’Isère, de l’Ain, du Doubs, du Jura : -la région de la langue d’oïl, qui comprend l’Artois, la Picardie, la Wallonie, La Lorraine, la Bourgogne, la Franche-Comté, la Champagne, L’Ille-de-France, l’Anjou, le Maine, la Touraine, la Bretagne, la Normandie, la Saintonge, l’Angourmois . Les deus grandes aires dialectales, appelées langue d’oc et langue d’oïl d’après la manière de dire oui ( oc <HOC et oïl < HOC + ILLE), se distinguent l’une de l’autre surtout par l’intensité des changements phonétiques. Au sud de la Loire, l’étymon latin est généralement plus résistant. Table des matières Aperçu (1) de l'ancien français (Première apparition du français – Ve–Xe siècles: les premiers textes) Aperçu (2) de l'ancien français (Poésie épique – XIe siècle: Chanson de Roland) Aperçu (3) de l'ancien français (Poésie épique (suite) – XIIe siècle: Cycle de Guillaume au court nez, Pèlerinage de Charlemagne) Aperçu (4) de l'ancien français (Littérature courtoise – XIIe siècle. Béroul, Thomas: Tristan, Marie de France, Chrétien de Troyes) Aperçu (5) de l'ancien français (La prose – XIIIe siècle. Guillaume de Tyr, Villehardouin) Aperçu (6) de l'ancien français (La prose (suite) – XIIIe siècle. Un procès sous Louis IX) Aperçu (7) de l'ancien français (La poésie lyrique en langue d'Oïl - XIIe siècle: Gace Brûlé, Châtelain de Coucy) Aperçu (8) de l'ancien français (La poésie française (suite) - XIIe et XIIIe siècles: Colin Muset, Conon de Béthune, anonymes, Thibaut de Champagne, Adam de la Halle, Rutebeuf) Aperçu (9) de l'ancien français (La poésie française (suite) - XIVe et XVe siècles: Guillaume de Machaut, Eustache Deschamps, Christine de Pisan, Charles d'Orléans, François Villon) Les langues romanes Toutes les langues romanes viennent du latin, langue indo-européenne, issue de la famille des langues italiques, qui s'est imposée dans la partie occidentale de l'Empire Romain et au nord du Danube, en Dacie (la Roumanie actuelle), au dépens notamment du celtique (par exemple le gallois). Dans la majeure partie de l'Empire d'Orient (Byzance), où domine la culture hellénistique, le grec a mieux résisté au latin. Avec les invasions barbares, les différentes parties de l'Empire Romain furent peu à peu isolées l'une de l'autre et du centre. D'abord la Dacie fut abandonnee aux Goths (+271), ensuite les différentes provinces devinrent de plus en plus autarciques avant de tomber entre les mains de peuples germaniques: Goths, Vandales, Lombards, Burgondes et Francs. Le parler populaire, le latin vulgaire ou bas latin, déjà distinct du latin littéraire ou latin classique, se différencia dans les provinces isolées. Seule l'Église, devenue institution d'État par l'interdiction du paganisme par Théodose en 391, put maintenir une certaine unité de la langue latine et une certaine culture classique. Le proto-roman (nom donné par les philologues à la langue parlée du haut Moyen Âge) se scinda d'abord en sarde et en roman continental. Le sarde est la langue romane la plus conservatrice, c.-à-d. celle qui a le mieux conservé la forme linguistique du latin. Les autres langues romanes se différencièrent à leur tour. Une distinction très importante est celle qui résulte entre les langues romanes occidentales, où l'-s final du latin se maintient, et les langues romanes orientales, par exemple l'italien, où l’-s final est perdu. Ainsi les déclinaisons nominales deviennent très différentes. Voici d'abord un schéma montrant la déclinaison de l'adjectif latin purus, fr. pur, ensuite une carte montrant la diversité linguistique de la Romania, et enfin un stemma montrant la diversification des langues romanes . Latin: Masculin Féminin Singulier Pluriel Singulier Pluriel Nominatif purus puri pura purae Accusatif purum puros puram puras Italien: Masculin Féminin Singulier Pluriel Singulier Pluriel puro puri pura pure Ancien français: Masculin Féminin Singulier Pluriel Singulier Pluriel Cas sujet purs pur pure pures Cas oblique pur purs pure pures Français moderne: Masculin Féminin Singulier Pluriel Singulier Pluriel pur purs pure pures Le latin non-classique Dans sa version gallo-romaine a fourni la base principale du français, qui a hérité de lui la plus grande partie de son vocabulaire et de sa structure grammaticale. Le latin littéraire, qui continuait à être utilisé dans l'enseignement, dans l'administration et dans la jurisprudence, n'a jamais cessé d'influencer le français, qui a trouvé dans le latin classique une source de renouveau et un idéal de perfection et de clarté formelles. Au Moyen Âge, on considéra le latin comme représentant l'essence de la langue, donc comme éternel, immuable, régulier, alors que les parlers vulgaires étaient contingents, altérables, remplis d'impuretés et d'imprécisions. Le latin était le seul idiome imaginable dans les genres nobles, à l'église, à l'université, au prétoire, dans les chancelleries, alors que li romanz, le roman, n'était accepté que dans la vie quotidienne et dans la littérature de divertissement, c.-à-d. la poésie d'amour, les chansons de geste, les romans (qui ont reçu leur nom de l'idiome dans laquelle on les a écrits), les nouvelles, les pièces de théâtre. Ce ne fut qu'à la Renaissance qu'on commença à considérer les langues populaires comme comparables au latin, Dante pour l'italien, les auteurs de la Pléiade pour le français, et en 1539, avec l'Édit de Villers-Cotterêts, François Ier (1515-47) ordonna le remplacement du latin par le français comme langue de juridiction partout dans le royaume de France. On distingue dans l'évolution du français quatre stades. 1. l'ancien français (842-v. 1350), 2. le moyen français (v. 1350-v. 1600), 3. le français classique (v. 1600- v.1800) et 4. le français moderne. Du point de vue de la lingustique historique, les langues romanes constituent un cas particulier, puisqu'on peut suivre assez exactement leur évolution depuis un point de départ, le latin, jusqu'aux points d'arrivée (français, espagnol, italien, etc.) Normalement, l'étude de l'histoire d'une langue implique la construction purement hypothétique des étymologies par la comparaison des formes actuelles, sans possibilité de vérification. En linguistique romane, les étymologies sont souvent là, dans le latin. Ceci n'exclut pas, évidemment, l'existence de “trous noirs”. Notamment, on ne sait pratiquement rien de précis sur ce qui s'est passé sur le plan linguistique entre 450 et l'apparition des premiers textes en français aux 9e, 10e et 11e siècles. La période obscure 450-850. De la basse latinité aux premiers textes français 400 ans séparent le latin vulgaire ou bas latin du premier texte en ancien français. La Gaule fut probablement complètement romanisée vers 400. La pénétration du latin est due à la classe possédante, qui imita l'aristocratie romaine et participa à la vie administrative, aux vétérans de l'armée, qui furent installés comme colons, et aux gens d'église. La langue gauloise, appartenant à la famille des langues celtes, disparut sans pratiquement laisser de traces, sauf quelques mots isolés appartenant surtout à la vie quotidienne, par exemple *camisa ® 'chemise', *camino® 'chemin', *blato® 'blé', *bracas® 'braies', *carro® 'char', cf 'charpente', 'charrue', *multone® 'mouton', *sudia® 'suie, mais dont l'étymologie est presque toujours discutable. En tant que substrat, l'influence du gaulois sur le latin parlé en Gaule est en général incertaine. Il est cependant possible que la prononciation de la voyelle longue u [ū] en latin, [y] en français soit due à l'influence du gaulois. Il y a de bonnes raisons de croire que jusque vers 450, la population ait été capable de comprendre le latin vulgaire, par exemple de suivre la messe. Sur la sermo vulgaris (le parler vulgaire, c.-à-d. le latin vulgaire), on sait assez peu de choses. Nous n'avons que quelques inscriptions avec des fautes d'orthographe et de grammaire révélatrices, quelques mises en garde contre les fautes de langage, la traduction de la Bible, dite La Vulgate par Saint Jérôme, terminée en 405, et la Peregrinatio Aetheria ad locam sanctam, où une religieuse espagnole Éthéria où Egéria fait un récit vivant de son voyage à Jérusalem à la fin du 4e siècle. Voici un exemple où Éthéria décrit les difficultés linguistiques rencontrées lors d'une messe pascale à Jérusalem sur le tombeau présumé du Christ. XLVII. 3. uploads/Litterature/ l-x27-ancien-francais.pdf
Documents similaires










-
47
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 10, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.8519MB