Madame Madeleine-V. David Le président de Brosses et les cultes de l'ancienne É
Madame Madeleine-V. David Le président de Brosses et les cultes de l'ancienne Égypte In: Journal des savants. 1969, N° pp. 158-172. Citer ce document / Cite this document : David Madeleine-V. Le président de Brosses et les cultes de l'ancienne Égypte. In: Journal des savants. 1969, N° pp. 158-172. doi : 10.3406/jds.1969.1201 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jds_0021-8103_1969_num_3_1_1201 LE PRÉSIDENT DE BROSSES ET LES CULTES DE L'ANCIENNE EGYPTE Le terme de « fétichisme » désigne une forme de culte ou, de plus, une théorie de la succession des formes de religion — succession qui s'avère solidaire des transformations intervenues dans les modes de vie, les idées et les structures sociales. Cette théorie est inséparable de la notion de progrès conçue par l'époque des lumières, et de l'histoire en son acception la plus large. C'est dans l'œuvre du Président de Brosses (qui fut, rappelons-le, l'un des membres les plus actifs de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), Du culte des dieux fétiches (1760), que la théorie du fétichisme initial, appuyée sur une somme d'observations et de comparaisons, a trouvé sa première et pleine expression. L'époque de ce livre — le milieu du xvm* siècle — fut déterminante pour l'histoire de l'écriture, et donc, pour la future égyptologie. Dans un précédent travail, nous avons décrit le tout premier essai d'application de la notion de déchiffrement à une écriture morte — celle des Égyptiens — , ainsi que les antécédents de la tentative, due à l'abbé Barthélémy x ; y ont été étudiées également les vues générales de l'Anglais Warburton sur les écritures 2, ayant succédé à celles de Nicolas Fréret3. Or le développement de l'histoire des religions décèle, dans le même temps, de globales analogies avec les conditions d'apparition d'une histoire de l'écriture. Au premier plan, deux catégories de faits originaires d'une même antiquité et objets d'appréciations constamment contradictoires : les hiéro glyphes d'Egypte, dont la nature et la fonction étaient inconnues ; les cultes égyptiens, en leur déconcertante diversité. En profondeur : urgence d'une critique des témoignages et des opinions ; et, des deux côtés encore, difficulté extrême d'une rencontre des idées et des faits. Un parallélisme relatif lie donc, au siècle des lumières, ces deux espèces de recherches ayant eu l'Egypte pour centre commun d'intérêt et pour 1. Voir M. V.-DAVID, Le débat sur les écritures et l'hiéroglyphe aux XVIIe et XVIIIe siècles (Bibliothèque générale de l'École pratique des Hautes Études, 6e section, 1965), chap. VIII (= Débat). 2. En français : Essai sur les hiéroglyphes des Égyptiens (t. I et II, 1744). Voir Débat, chap. VII. 3. Voir ib., chap. V et VI. LE PRESIDENT DE BROSSES ET L'EGYPTE 159 exemple-clé. Une histoire de la civilisation égyptienne est l'enjeu de cette partie — ou, du moins, d'abord, l'élaboration des méthodes et des critères pouvant conduire à cette histoire. Déjà les deux ouvrages du Président de Brosses dont il va être parlé s'inscrivent dans ce cadre. I. — Le Traité sur les langues. L'Histoire des navigations. Dès 1751, Charles de Brosses avait inauguré des investigations sur les composantes sensibles de tout langage humain, sur le développement des langues et sur celui des écritures \ Le Traité sur la formation mécanique des langues 5, paru en 1765, remporta un vif succès 6. En examinant la question des hiéroglyphes, l'auteur résume ses jugements sur l'Egypte, avec un naturel embarras : jugements prudents et critiques — non point seulement à cause des exagérations à rabattre, mais aussi du fait de l'ambiguïté foncière des premières civilisations, qu'il pressent. S'il est vrai que les Égyptiens furent un peuple « policé et de longue main exercé dans les arts » 7, « étonnant par la grandeur prodigieuse de ses entreprises », et fondateur des premières sciences, ils ne furent encore qu'un « peuple à demi-grossier » 8. Quant à leur écriture : « Je pense donc, avec Wilkins et Warburton, qui a excellemment traité cette matière9, que les hiéroglyphes ne sont qu'une invention imparfaite et défectueuse, convenable aux siècles à demi-sauvages, et à laquelle les Égyptiens ont eu recours dans le temps de la plus haute antiquité, à défaut de lettres alphabétiques dont l'invention n'était pas encore trouvée » 10. 4. Ses travaux avaient eu Salluste pour objet initial. Ils abordent, à partir de 1746, les peuples préclassiques, la chronologie et l'archéologie (Lettres sur l'état actuel de la ville souterraine d'Herculée, 1750; traduit en anglais et en italien). Cf. Lettres familières sur l'Italie, éd. Y. Bezard (1931) (= Lettres Italie), t. I, p. 464 et s. L'étude des traditions relatives aux origines — «temps incertains et fabuleux» — le conduisit aux religions. Et, à partir de 1751, il en vint aussi aux problèmes de langage et d'écriture. 5. T. I et II. Cf. Débat, p. 120 et s. (chap. IX) : résumé des positions adoptées par l'auteur à l'égard des problèmes de l'hiéroglyphe. 6. Traduit en anglais en 1772 ; en allemand en 1777. Cf. G. HARNOIS, Les théories du langage en France de 1660 à 1821, p. 53 et s. ; H. Arens, Sprachwissenschaft (Freiburg-Mùnchen, 1955), p. 53 et s.; G. MatorÉ, Histoire des dictionnaires français (1968), p. 89- 7. Traité, t. I, p. 305. 8. lb., p. 359. 9. Cf. ci-dessus, p. 158. 10. lb., p. 363 ; cf. p. 303 et 354 : la fixation de la parole par le moyen de lettres ne saurait avoir été invention première absolument, car « l'esprit humain ne fait pas tout d'un coup de si grands pas » — ceci à l'encontre de la priorité maintes fois attribuée à l'écriture hébraïque (cf. Débat, chap. II, p. 34). 160 MADELEINE V.-DAVID Si l'on entend ces paroles comme réaction à des préjugés, anciens ou alors actuels, il s'agit de replacer l'Egypte, avec sa singulière écriture, et tout ce qui la caractérisa si fortement, dans l'histoire. Dans son ouvrage de 1756, Histoire des navigations aux Terres australes n, le Président de Brosses s'était montré attentif aux connexions entre les mœurs des sauvages et telles données conservées par les historiens anciens. En ce livre — appel à la recherche et à l'action12, dont la portée surpassait celle d'un recueil de récits de voyages — éclatait la foi du xvine siècle dans le principe d'éducation. La théorie bien connue des « colonies » intervenait u : Phéniciens et Égyptiens sont regardés comme ayant été les maîtres des Grecs (ou, avant eux, des Pelages) 14. A l'échelle des peuples, cette éducation fait corps avec l'idée d'un progrès devant s'opérer sans restriction, en poussées successives à partir du plus inférieur, par toute la terre. La description de ce niveau premier s'accompagne de l'acte d'humilité d'un Européen conscient de la misère de ses lointains ancêtres, dont la condition différait peu de celle des actuels sauvages australiens 15. L'exemplaire de l'Histoire des navigations conservé à la Réserve de la Bibliothèque nationale 16 présente des annotations de l'auteur, en prévision d'une édition future : ce travail de premier jet révèle l'élan d'une pensée qui, par exemple, à la mention de cavernes servant d'abris aux habitants de la Magellanique, réagit en invoquant des témoignages concordants, empruntés à l'histoire de Sertorius, et en renvoyant à Salluste et à Plutarque17. Dans le texte imprimé — traitant de croyances, de langues et de mœurs aussi bien que de géographie — , on voit, au sujet d'objets sacrés, germer la théorie du fétichisme : « Ils [les « nègres » de Nouvelle-Guinée] adorent des pierres rondes, des troncs d'arbres et diverses autres espèces de fétiches, 11. T. I et II. Traduit en anglais en 1766, en allemand en 1767. 12. Par lequel furent suscitées les explorations d'un Bougainville. 13. Ce terme, l'une des catégories de la pensée historienne à l'époque classique, subsume toute expansion de peuples ayant atteint un niveau élevé, relations de commerce incluses ; et implique les répercussions de cet établissement sur la vie indigène, souvent sous la forme d'apport durable et civilisateur. 14. Cf. Hist, navig., t. II, p. 373 et traité, t. I, p. LII. Sur ce thème, voir, par exemple, Fénelon, Dialogues des morts, discussion de Socrate et de Confucius (cité par R. Étiemble, Les Jésuites en Chine, p. 160), et déjà S. BOCHART, Chanaan (1646). Cf. le Second mémoire du Président lui-même (1755), Mém. Acad. lnsa., t. 27, p. 3, et 11 et s. 15. Autrement dit, les habitants de toutes les Terres australes. On voit combien cette idée du sauvage inculte infirme les conceptions rousseauistes ; cf. lettre de 1757, dans Y. BEZARD, Le Président de Brosses et ses amis de Genève (1939), p. 43 et s., et 138 et s. 16. Signalé par A. C. Taylor, Le Président de Brosses et l'Australie (1937), p. 55, n. 4, et 68. 17. Voir l'exemplaire précité de Hist, navig., t. I, p. 297. En marge, conclusion : « Les nations sauvages et troglodytes sont connues par l'histoire ancienne comme par les relations modernes. » LE PRÉSIDENT DE BROSSES ET L'EGYPTE 161 ainsi que les Nègres africains 18 ; mais ils ont ceci de commun avec les plus anciens peuples de la terre, uploads/Litterature/ madeleine-david-le-president-de-brosses-et-les-cultes-de-l-x27-ancienne-egypte.pdf
Documents similaires








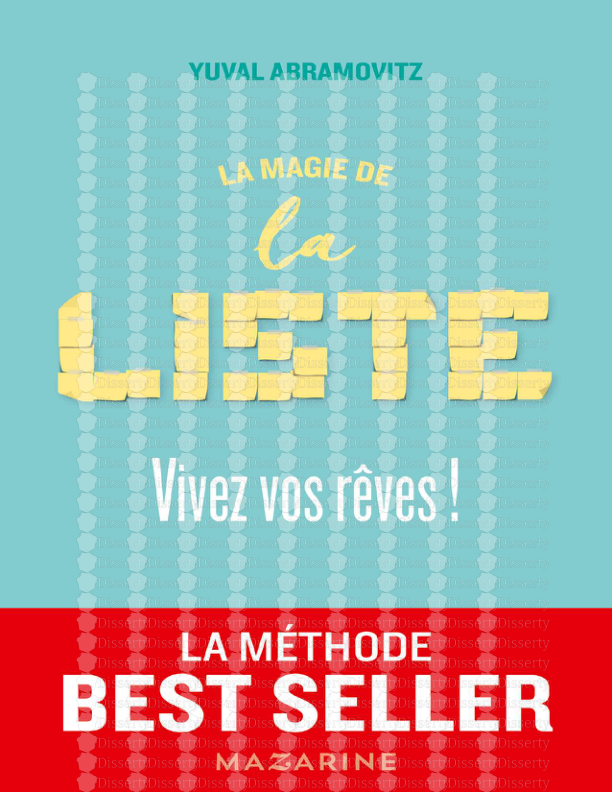

-
87
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 22, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 1.1545MB


