BARBEDETTE Mathilde EHESS. Master 1 d’histoire. Séminaire de Catherine Maire (2
BARBEDETTE Mathilde EHESS. Master 1 d’histoire. Séminaire de Catherine Maire (2008-2009) : « L’Eglise et l’Etat des Lumières à la Révolution » Etude du chapitre « Preuves des droits du Roi » extrait de l’Histoire du droit public ecclésiastique français (1737) attribuée au marquis d’Argenson et au Père de la Motte : Antiromanisme gallican Et Anticléricalisme politique. 1 René-Louis de Voyer, marquis d’Argenson (1694-1757), a été secrétaire d’Etat aux affaires étrangères sous Louis XV de novembre 1744 à janvier 1747 mais il est resté célèbre surtout pour son traité politique que nous connaissons sous le titre de Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France. En réalité, le marquis d’Argenson a beaucoup écrit mais l’intégralité de ses manuscrits a été brûlée au moment de l’incendie de la bibliothèque du Louvre dans la nuit du 23 au 24 mai 1871. Cependant en 1976, Marc-René de Voyer de Paulmy d'Argenson, 9ème marquis d'Argenson, dépose les archives privées de sa famille à la Bibliothèque Universitaire de Poitiers. Ces archives étaient auparavant conservées au château des Ormes dans la Vienne qui appartient à la branche cadette du marquis d’Argenson –celle issue du frère du marquis d’Argenson, Marc-René, comte d’Argenson, ministre de la guerre de Louis XV. Elles contiennent des copies d’ouvrages majeurs du marquis d’Argenson inédits ou en partie inédits vraisemblablement réalisées au début du XIXème siècle par Charles-Marc-René d’Argenson, arrière-petit-neveu du marquis d’Argenson, d’après les manuscrits originaux. Quelles sont donc les sources à notre disposition pour traiter de la question qui nous intéresse ici, à savoir la conception du marquis d’Argenson de la nature du rapport que devait entretenir le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel ? Tout d’abord, le marquis d’Argenson nous a laissé un volumineux journal qu’il a tenu régulièrement à partir du milieu des années 1720 jusqu’à sa mort en 1757. La publication la plus fidèle aux manuscrits du marquis d’Argenson a été effectuée de 1859 à 1867 pour le compte de la Société de l’Histoire de France par Emile-Jacques-Benoît Rathery, bibliothécaire au Louvre où sont alors conservés les manuscrits de d’Argenson. A plusieurs reprises, dans son journal, le marquis d’Argenson fait référence à des affaires qui concernent l’Eglise comme par exemple l’impôt du vingtième que Machault veut imposer à tous y compris aux ecclésiastiques mais il fait référence aussi aux libertés de l’Eglise gallicane, aux appels comme d’abus... Dans les Mémoires pour le testament politique de Son Eminence le Cardinal de Fleury, publié par Rathery à la fin du premier volume du journal du marquis d’Argenson, on trouve quelques vues intéressantes à la rubrique « La Religion ». Dans les Remarques en lisant et les Pensées sur la Réformation de l’Etat, qui n’ont été publiées que très partiellement par l’arrière-petit-neveu du marquis d’Argenson dans le cinquième volume de l’édition de 1855-1857 des Mémoires du marquis d’Argenson, édition par ailleurs fautive, on trouve aussi des considérations du marquis d’Argenson sur la religion. Pour cette étude, nous nous sommes intéressés au traité de l’Histoire du droit public ecclésiastique français. Ce traité fut composé en partie par le marquis d’Argenson dans le 2 cadre de ses activités au club de l’Entresol qu’il fréquenta de 1725 à 1731, date à laquelle le club fut interdit par Fleury. Dans le journal du marquis d’Argenson, nous en apprenons davantage sur la composition de ce traité. Le 10 décembre 1731, le marquis d’Argenson consacre en effet un article de son journal au club de l’Entresol peu après son interdiction. « Je fus d'abord chargé du droit public en général, sur quoi je donnai des sommaires de matières dès la seconde séance où j'assistai ; puis, cela se trouvant trop étendu, on me restreignit au droit ecclésiastique de France que j'ai assez avancé, et de quoi j'ai lu plusieurs fois »1. Puis, le 12 mars 1750, il revient sur l’histoire de la composition de ce traité. « Il a paru en 1737 un livre qui a pour titre Histoire du Droit ecclésiastique français. J'avoue que plus de la moitié est de ma composition »2. Il explique pourquoi il s’est penché sur cette question. A cette époque, il était chargé au conseil du roi du bureau des affaires ecclésiastiques avec l’abbé Bignon. « Ce bureau ecclésiastique était alors comme le parlement des parlements, à cause des affaires de la Constitution qui nous attiraient quantité d'évocations des plus grandes affaires de cette espèce. J'étais jeune et chaud ; je me remplis infiniment l'esprit des droits du roi sur l'Église et du peu de droit du pape »3. Après avoir bien avancé ce traité, il s’en détourna pour se consacrer à d’autres affaires et commissions. Ce fut le Père de la Motte, qui avait été préfet du marquis d’Argenson au collège des Jésuites de Louis le Grand, qui termina l’ouvrage. Le marquis d’Argenson lui envoya ses manuscrits, le plan du traité qu’il avait établi et des livres qu’il avait réunis en vue d’écrire ce traité. Le père de la Motte envoyait ses cahiers au marquis d’Argenson au fur et à mesure. Le marquis les arrangeait et continuait à les lire lors des séances du club de l’Entresol. Le Père de la Motte s’enfuit ensuite en Hollande et y vécut sous le nom de M. de la Hode. Ce traité a été publié à Londres chez Samuel Harding en 1737. Cette publication a été suivie par d’autres éditions, toujours à Londres, en 1740, 1750 et 17514. L’édition de 1750 est augmentée de la Dissertation sur le droit des souverains touchant l’administration de l’Eglise de Delpech de Mérinville déjà publiée en 1734. Il s’agit en fait d’une adaptation du Traité de l'autorité des rois touchant l'administration de l'Église de Le Vayer de Boutigny publié en 1700. A cette nouvelle édition de l’Histoire du droit public ecclésiastique français est aussi ajoutée l’Histoire du droit canonique, déjà publiée en 1729, de Jean-Louis Brunet, avocat au Parlement de Paris et spécialiste du droit canon. L’histoire du droit public ecclésiastique français est publiée sous le nom de Du Boulay, avocat et canoniste à qui l’on va longtemps attribuer ce traité. Cependant, le marquis 1 Journal et mémoires du marquis d'Argenson publiés pour la première fois d'après les manuscrits autographes de la Bibliothèque du Louvre, pour la Société de l'histoire de France, par E. J. B. Rathery, Paris, Vve de J. Renouard, 1859-1867, t.1, p. 97. 2 Ibid., t. 6, p. 167. 3 Ibid., t. 6, p. 168. 4 Pour les différentes éditions, cf. la bibliographie p. 17 de cette étude. 3 d’Argenson écrit : « Il transpire dans le monde que ce livre est de moi, et je ne l'ai pas absolument désavoué à quelques amis qui l'ont dit à d'autres »5. Dans son Essai sur les mœurs et esprit des nations et sur les principaux faits de l’histoire de Charlemagne jusqu’à Louis XIII, Voltaire – qui était l’ami de d’Argenson avec qui il entretenait une correspondance suivie- assure que le marquis d’Argenson a collaboré à l’Histoire du droit public ecclésiastique français6 et dans ses Questions sur l’Encyclopédie, à l’article « esclave », Voltaire affirme que le marquis d’Argenson a eu la meilleure part à l’Histoire du droit public ecclésiastique français7. L’Histoire du droit public ecclésiastique prend place dans le Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes d’Antoine-Alexandre Barbier à l’entrée numéro 80238. Barbier y mentionne les propos de Voltaire. Dans l’ouvrage intitulé Bibliothèque historique de la France : contenant le catalogue des ouvrages, imprimés & manuscrits, qui traitent de l'histoire de ce royaume ou qui y ont rapport, à l’entrée numéro 6973, on apprend que la faculté de théologie de Paris a décidé le 17 août 1751, la censure de 19 propositions qu’elle avait extraite du traité ; mais cette censure n’a pas été rendue publique car « elle contenait elle-même des choses répréhensibles ».9 Dans le fonds d’Argenson des archives de Poitiers, on trouve un mémoire rédigé par le marquis d’Argenson intitulé « Réflexions faites sur quelques propositions extraites du livre intitulé Histoire du droit public ecclésiastique français et canonique et du gouvernement de l’Eglise que la Sorbonne veut condamner ». Dans ce mémoire, le marquis d’Argenson présente en vis-à-vis de chaque proposition que la Sorbonne veut faire censurer, « les réflexions que l’on a cru convenables aux différentes interprétations dont est susceptible chaque proposition ». L’histoire du droit ecclésiastique a été composée au moment de la querelle qui agite le Parlement à propos de l’enregistrement de la bulle Unigenitus qui devient finalement loi d’Etat en 1730. Le traité est réédité en 1750 alors que Machault d’Arnouville veut imposer l’impôt du vingtième qui reposerait sur tous les propriétaires y compris le clergé. Dans ce contexte, la réédition de l’histoire du droit public ecclésiastique français qui réclame justement que l’exemption de charges sur les biens ecclésiastiques soit levée, fait polémique. Dans son journal, à la date du 12 mars 1750, le marquis d’Argenson rapporte qu’ « on dit que cela fait beaucoup ma cour au gouvernement, qui y voit ses prétentions canonisées contre le clergé ; mais il y a aussi à craindre les uploads/Litterature/ mathilde-barbedette-quot-l-x27-histoire-du-droit-public-ecclesiastique-francais-de-d-x27-argenson-quot.pdf
Documents similaires








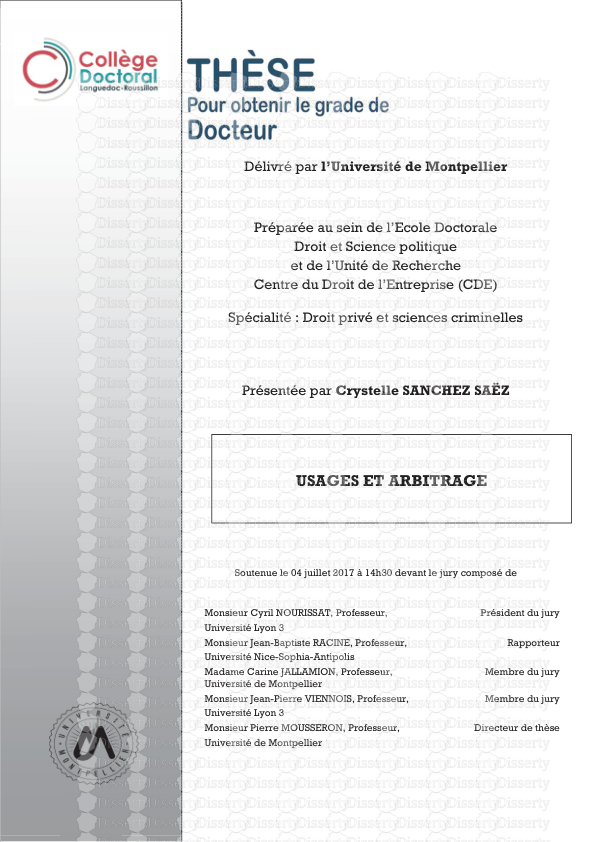

-
70
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 17, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1505MB


