Tous droits réservés © Département des littératures de l'Université Laval, 1980
Tous droits réservés © Département des littératures de l'Université Laval, 1980 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ Document generated on 02/17/2022 5:42 a.m. Études littéraires Narration et actes de paroles dans le texte dramatique Jeannette Laillou Savona Théâtre et théâtralité : essais d’études sémiotiques Volume 13, Number 3, décembre 1980 URI: https://id.erudit.org/iderudit/500528ar DOI: https://doi.org/10.7202/500528ar See table of contents Publisher(s) Département des littératures de l'Université Laval ISSN 0014-214X (print) 1708-9069 (digital) Explore this journal Cite this article Savona, J. L. (1980). Narration et actes de paroles dans le texte dramatique. Études littéraires, 13(3), 471–493. https://doi.org/10.7202/500528ar NARRATION ET ACTES DE PAROLE DANS LE TEXTE DRAMATIQUE jeannette laillou savons Les travaux portant sur la narratologie ont récemment progressé selon deux directions de recherche maintenant solidement établies : l'une se concentre sur le niveau de «la fable» ou de l'« histoire» qu'elle analyse selon une perspective formelle ou structurale (Propp, Greimas, Eco, Brémond, Todorov, etc.) ; l'autre, en se plaçant au niveau des «motifs» ou du «récit», s'attache à élucider les problèmes posés par renonciation narrative (Lubbock, Stevick, Booth, Genette, Lotman, etc.). L'étude que nous nous proposons d'entre- prendre ici suivra la deuxième ligne de recherche qui se situe au niveau de la narration, domaine où on a lieu d'être étonné par le retard et la pauvreté des travaux portant sur le texte dramatique. Pourtant, il faut reconnaître que l'ouvrage d'Anne Ubersfeld sur le texte théâtral et sur son discours a ouvert de nouvelles perspectives à la méthodologie du théâtre et il est certain que notre propre réflexion sur renonciation narrative du texte dramatique s'en est trouvée grandement stimulée et enrichie1. Dans le travail qui va suivre nous nous situerons au niveau exclusif du texte écrit de la pièce de théâtre que nous tenterons d'abord de décrire en fonction des notions d'histoire, de récit et de narration2. Le texte écrit comporte les dialogues et les didascalies3. Par didascalies on entendra tous les discours qui proviennent directement du scripteur de la pièce : le titre, la liste des personnages ou «Dramatis Personae» (souvent juxtaposée à celle des acteurs de «la première»), le nom du personnage précédant chacune des répliques et les notations dites «instructions de scène» dont la typographie diffère de celle des dialogues. Au premier abord, on pourrait supposer que le scripteur de la pièce raconte son histoire à l'aide de deux techniques narratives : l'une directe, les didascalies, qui rappelleraient par leur contenu les récits extradiégétiques à la troisième ÉTUDES LITTÉRAIRES — DÉCEMBRE 1980 472 personne du roman, l'autre indirecte, les dialogues, qui seraient comme autant de récits diégétiques à la première personne. Mais cette description rudimentaire n'est guère satisfaisante car elle ne correspond que très approxima- tivement aux phénomènes étudiés. En réalité, la didascalie possède un statut narratif émi- nemment ambigu qui souligne son altérité par rapport aux portraits, descriptions, ou résumés romanesques. D'une part, ses discours, bien que n'étant censés s'adresser qu'aux lecteurs du texte écrit, désignent leurs propres allocutaires comme étant surtout les spectateurs, mais aussi les acteurs et les autres interprètes du spectacle éventuel de la pièce. D'autre part, ils dénotent tantôt la diégèse : personnages, lieu et temps de l'intrigue, tantôt les signifiants matériels de la mise en scène potentielle du texte écrit : acteurs, décors sceniques et temps de la représentation. La didascalie pose donc avec acuité le problème des relations entre les deux niveaux du récit théâtral qu'elle tend à intégrer l'un à l'autre et à amalgamer. On voit qu'il est difficile d'utiliser ici le mot « récit » au sens étroitement linguistique où Genette l'emploie, puisque le niveau mimétique de la représentation désignée par la didascalie est à la fois histoire et récit, récit dont les narrateurs seraient le metteur en scène, le décorateur, les acteurs, etc., et dont le «langage» serait les dialogues ainsi que les divers systèmes de signes visuels et auditifs du spectacle. Mais à partir du texte écrit, la représentation n'apparaît que comme un discours narratif très schématique et incomplet qui n'est pas du tout le même que celui d'une mise en scène précise. En effet, dans une représentation réelle, grâce à des procédés de transcodages multiples, la didascalie est remplacée par des signifiants de substance non linguistiques dont les signifiés cessent de coïncider avec ceux du texte écrit. En fait, le discours narratif constitué par le texte sémiotique de la représentation réelle est si peu homo- logue au récit du texte écrit que la fable n'est pas forcément la même, quand on passe d'une forme à l'autre. C'est pourquoi la représentation dont nous parlerons à partir du texte écrit est un récit diégétique et non mimétique, un récit de la représentation scénique potentielle et non réelle de la pièce. On remarque que dans les deux types de récit mentionnés — représentation scénique diégétique fondée sur le texte écrit NARRATION ET ACTES DE PAROLE 473 et représentation réelle —, le statut narratif des dialogues reste à peu près le même : ils sont comme englobés dans l'histoire racontée (par la didascalie ou les signes de la mise en scène), en même temps qu'ils tiennent lieu de récits. En tant que récits, leur forme les différencie radicalement des récits romanesques homodiégétiques à la première personne. C'est sans doute leur survivance intégrale sous une forme à peine transcodée (celle du discours oral) au sein de la mise en scène réelle qui explique leur ressemblance morphologique et syntaxique avec la parole dialoguée des discours réels : la prédominance de la deuxième personne sur la troisième (et même parfois sur la première), l'omniprésence des déictiques temporels et spatiaux et le triomphe du présent, du futur, du passé composé et de l'impératif sur le passé simple ou sur l'imparfait du subjonctif sont comme autant de marques qui signalent une imitation des dialogues naturels qui, eux, cependant, ne racontent que rarement une histoire longue et complexe aux diverses possibilités de signification. Comme les dialogues quotidiens, les dialogues dramatiques paraissent profondément ancrés dans une sorte de présent dévorant qui est celui de l'instance de leur discours — la représentation potentielle — et qui affecte au plus haut point le passé ou le futur de leurs énoncés. D'autre part, on constate que les allocutaires mis en évi- dence par les dialogues sont les personnages ou interlo- cuteurs fictifs du texte, si bien que les allocutaires externes (lecteurs/spectateurs) s'y trouvent rarement mentionnés et souvent même totalement occultés. Si ce dernier phénomène s'applique fréquemment aussi au récit romanesque ou ciné- matographique, ce qui paraît plus remarquable c'est que les discours des locuteurs puissent se répondre selon un continuum dont la logique interne est nécessairement double : d'un côté, en tant que récits, les dialogues obéissent à la dialectique énonciatrice du discours oral qui fait que le contenu propositionnel de chaque phrase se trouve pour ainsi dire orienté et informé par la charpente des actes de parole qui se succèdent logiquement ; de plus, en tant que segments de la fable, il est possible de les traduire en énoncés narratifs, eux-mêmes convertibles en fonctions dont la succession est soumise aux mêmes lois de causalité que toutes les histoires racontées. Comme on le voit, une telle situation rend les ÉTUDES LITTÉRAIRES - DÉCEMBRE 1980 474 concepts de fonctions et d'énoncés narratifs, qui sont relati- vement simples dans les contes ou dans les romans à narrateur unique ou même dans les didascalies, beaucoup plus difficiles à cerner dans les dialogues, puisque ces notions doivent forcément passer par ces rapports de force que les discours, aidés des didascalies, créent entre eux et qui modifient sans cesse le sens même de leurs énoncés. C'est cette importance primordiale de renonciation à l'œuvre dans tous les discours dialogiques du théâtre qui nous a incitée à tenter d'utiliser la théorie des Actes de Parole, développée par les philosophes anglophones du langage — notamment Austin et Searle4 — et fondée sur une étude pragmatique des mécanismes de la parole opérant clans des situations sociales réelles. Searle a analysé succinctement le statut des actes de parole littéraires. Selon lui, dans l'œuvre fictive, le locuteur (auteur, narrateur ou personnage) fait semblant d'accomplir un acte illocutoire tout en obéissant à toutes les règles habituelles du discours. Cette «feinte» des narrateurs obéirait elle-même à une convention de la parole ludique qui ferait que sa valeur illocutoire réelle ou ses effets perlocutoires vrais sont suspendus5. Mais, à l'intérieur du jeu instauré par le discours littéraire, il semble que toutes les règles logiques du conditionnement et de l'agencement des actes de parole restent les mêmes6. Même si la référence du contenu propositionnel des dialogues de théâtre est fictive, nous supposerons donc ici que leurs actes de parole fonctionnent, au niveau imaginaire, de la même façon que les uploads/Litterature/ narration-et-actes-de-paroles-dans-le-texte-dramatique-jeannette-laillou-savona.pdf
Documents similaires






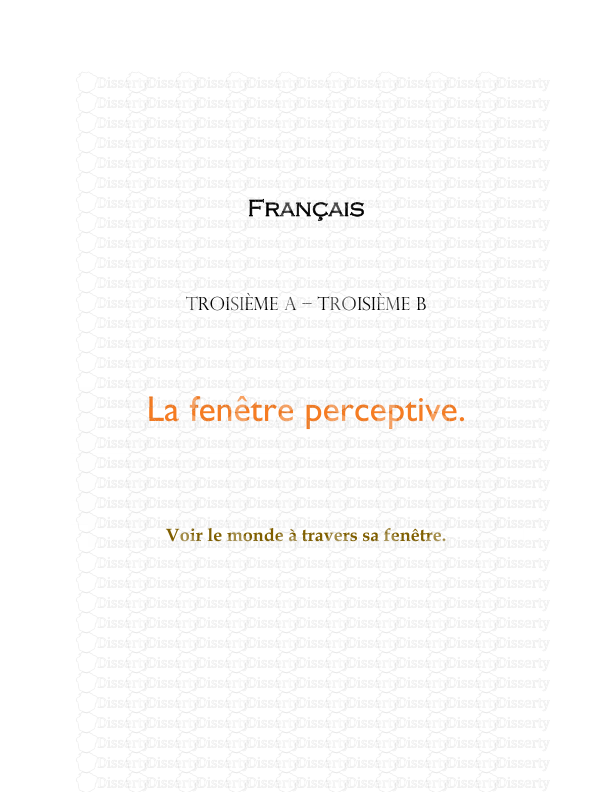



-
47
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 18, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 1.9594MB


