MARC ANGENOT La querelle des «nouveaux réactionnaires» et la critique des Lumiè
MARC ANGENOT La querelle des «nouveaux réactionnaires» et la critique des Lumières Discours social volume XLV – 2014 Discours social est une collection de monographies et de travaux collectifs relevant de la théorie du discours social et rendant compte de recherches historiques et sociologiques d’analyse du discours et d’histoire des idées. Cette collection est publiée à Montréal par la CHAIRE JAMES-MCGILL D’ÉTUDE DU DISCOURS SOCIAL de l’Université McGill. Elle a entamé en 2001 une deuxième série qui succédait à la revue trimestrielle Discours social / Social Discourse laquelle avait paru de l’hiver 1988 à l’hiver 1996. Discours social est dirigé par Marc Angenot. VOLUME XLV Marc Angenot La querelle des «nouveaux réactionnaires» et la critique des Lumières Un volume de 179 pages. Prix de vente : € 14.00 — $ 18.00 PARUTIONS RÉCENTES : Fascisme, totalitarisme, religion séculière : trois concepts pour le 20e siècle. Notes pour un séminaire d’histoire conceptuelle en 4 volumes : Vol. 1. Catégories et idéaltypes — Fascisme, volume 37, décembre 2013. 515 pages. Vol. 2 : Le siècle des religions séculières, volume 38, août 2014. 489 pages. Vol. 3 : Totalitarisme, volume 39, sortie prévue à la fin de l’hiver 2015. ### Les «nouveaux réactionnaires» et la critique des Lumières Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude ! Habe Muth dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Immanuel Kant – Beantwortung der Frage : Was ist Aufklärung? Berlinische Monatsschrift, Dez. 1784. Rhétorique des polémiques intellectuelles Que ce soit dans le domaine des sciences, dans celui de la philosophie, dans les institutions académiques, les mondes artistique et littéraire, partout et constamment, éclatent des polémiques et se déclenchent des controverses qui, très souvent aussi, quittent l’empyrée des spécialistes pour aboutir sur la scène publique et devenir de véritables événements sociaux et politiques. Or, il fallait constater jusqu’à tout récemment l’absence en langue française de travaux de problématisation, de discussion des enjeux, de théorisation de cette histoire des controverses intellectuelles et des polémiques publiques. L’Apologie de la polémique de Ruth Amossy est venue heureusement combler en partie cette lacune.1 Néanmoins, l’histoire des controverses demeure limitée à quelques bons échantillons en français. Elle forme au contraire un secteur de l’histoire intellectuelle particulièrement développé et académiquement identifié en domaine allemand. Il a fallu du reste que ce soit un chercheur suisse alémanique, Jürg Altwegg qui esquisse avec érudition une histoire des polémiques entre lettrés en France du 18e siècle à 1989 dans son Republik des Geistes.2 Il existe sans nul doute de nombreux livres et pamphlets qui sont parties prenantes de tel et tel débat d’idées, mais l’approche de ces débats en historien des idées fait grandement défaut. 1. Paris: PUF, 2014. 2. Altwegg, Querelles de français [Traduit de l’allemand, Republik des Geistes]. Paris : Grasset, 1989. . 3 Dans un essai d’hommage au théoricien de la nouvelle rhétorique, Chaïm Perelman, Pierre-André Taguieff a proposé un correctif à la rhétorique consensuelle qui est celle du philosophe bruxellois en mettant de l’avant un aspect inhérent, à son sentiment, à tout échange rhétorique, «les éléments de ce que j’appellerai, dit-il, une polémologie discursive». Taguieff retient la polémicité parmi les traits par lesquels l’argumentation rhétorique se distingue de la démonstration logique. C’est un amendement essentiel. Je n’ai cessé de travailler dans ce sens et ce n’est pas par hasard que ce sont des historiens des idées qui se rencontrent pour mettre de l’avant ce critère: toute histoire des idées fait apparaître continûment des affrontements de thèses irréconciliables, des «dialogues de sourds», des controverses interminables entre des positions défendues bec et ongle. 3 Je propose de contribuer à cette problématique négligée: je vais élaborer dans les notes qui suivent l’historique d’une controverse intellectuelle récente (et même à de certains égards toujours en cours), — historique accompagné d’une herméneutique de ses enjeux et de sa portée.4 Looking Backward : 1974-2002 Si l’on veut rendre compte – et rendre raison en le situant dans la durée – du violent mais fugace épisode polémique qui s’est déclenché en 2002 autour du pamphlet de Daniel Lindenberg, Le rappel à l’ordre, sous-titré Enquête sur les nouveaux réactionnaires – polémique qui connaîtra de nombreuses résurgences, notamment en 2009 avec Le procès des Lumières du même auteur, – il faut, à mon sens, remonter d’un bon tiers de siècle en arrière. La polémique de 2002 m’apparaît comme un après-coup, comme le combat d’arrière-garde d’une longue bataille déjà largement perdue par le camp où Lindenberg vient s’inscrire, quoiqu’elle ait à plusieurs reprises changé de terrain. 3. . «L’argumentation politique. Analyse du discours et Nouvelle Rhétorique. A la mémoire de Chaïm Perelman, 1912-1984», Hermès, 8-9, 261. 4. Ces notes représentent la version longue – très longue – d’une conférence donnée au colloque Les «Nouveaux Réactionnaires»: genèse, configurations, discours, colloque tenu à l’Université de Liège, les 10-12 décembre 2014. Les directeurs du colloque étaient Pascal Durand et Sarah Sindaco. Je leur dédie ces notes. 4 La vie intellectuelle française5 est scandée par de vives et amères controverses, à la fois savantes et «publiques», des querelles successives qui la polarisent à tout coup en deux camps – avec une ligne de faille et une répartition chaque fois différente, mais qui creuse pourtant les sillons déjà tracés et «avive les plaies». Querelles qui s’engagent et se terminent dans l’incompréhension réciproque et l’indignation «morale», qui se réduisent donc régulièrement à des dialogues de sourds.6 Je considérerai rétrospectivement quatre épisodes qui vont de 1974 à la fin du siècle, épisodes particulièrement intenses qui ont divisé ... on n’oserait dire «la gauche» puisque l’enjeu sous-jacent de toutes ces controverses était précisément de déterminer qui est justifié à se dire «de gauche» et qui doit être écarté et rejeté dans l’«autre camp» – quelque nom qu’on lui attribue.7 Les controverses les plus âpres et interminables (ne) portent souvent (que) sur les mots avec lesquels on classe et on désigne, avec lesquels on se désigne et on qualifie par antonyme son adversaire — l’âpre débat sur les dénominations démarre au quart de tour.8 Ces «querelles de mots» avec leurs enjeux souvent peu compréhensibles à qui n’est pas «dans le coup», à qui par exemple ne relève pas de l’Hexagone ou à tout le moins de la Francophonie, sont de très grand poids et la défense par chacun de son propre vocabulaire et de ses propres classements est ressentie comme vitale. Prenons plus de recul tant qu’à faire. La question de savoir et de décider qui est en droit de se réclamer du «progrès», des Principes de 1789 et des Lumières, et qui doit au contraire être rejeté dans les ténèbres extérieurs, a fait l’objet de controverses incessantes depuis deux siècles – semper eadem 5. J’y inclus à divers égards la Francophonie européenne. C’est une notion et une problématique qu’il faudrait creuser. 6. Je renvoie à mon livre de 2008: Dialogues de sourds. Traité de rhétorique antilogique. Paris: Mille et une Nuits. 7. Le critère traditionnel qui précisément se trouve mis à mal au milieu des années 1970 était que toute critique trop vive de l’URSS et du «socialisme réel» faisait de vous un «anti- communiste» et donc ipso facto un ennemi de la Gauche. 8. Je renvoie ici à mon étude, «La rhétorique de la qualification et les controverses d’étiquetage» dans Argumentation et Analyse du Discours, 13: 2014, mis en ligne le 20 octobre 2014. 5 sed aliter disent les latinisants, toujours pareille et toujours changeante – ce qui m’amènera à remonter bien plus haut dans le cours de cet exposé, jusqu’aux temps romantiques et aux années de la Monarchie du juillet. I. Les «nouveaux philosophes» et la querelle du totalitarisme Je me situe d’abord au milieu des années 1970 où s’affrontent une première fois, autour du concept de «totalitarisme», deux regroupements et deux visions incompatibles de la «gauche». Avec à chaque coup, le soupçon véhément, exprimé ici et là, que l’un des «camps» agit contre la gauche, une gauche transcendante et indivise, et, la trahissant, a cessé de pouvoir s’en réclamer.9 Paradoxe apparent et fait lourd de conséquences dans le dernier tiers du 20e siècle: les socialistes français dirigés par François Mitterrand, alliés aux radicaux de gauche et aux communistes, sont venus enfin10 au pouvoir en 1981 avec des projets, des idées, un Programme commun de gouvernement non seulement «périmés», sapés par le mouvement intellectuel de la décennie précédente, mais rendus profondément suspects. C’est en effet plusieurs années avant 1981 que la gauche intellectuelle française a subi une mutation presque intégrale. L’hégémonie communiste qui avait été pesante est alors en voie d’effondrement. Du coup, la «Rupture avec le capitalisme» promise, les conceptions étatistes du Programme commun de gouvernement,11 l’économie dirigée détaillée dans ce programme se sont trouvé jugées ringardes – et dangereuses si appliquées – par des dizaines uploads/Litterature/ querelle-des-nouveaux-reactionnaires.pdf
Documents similaires


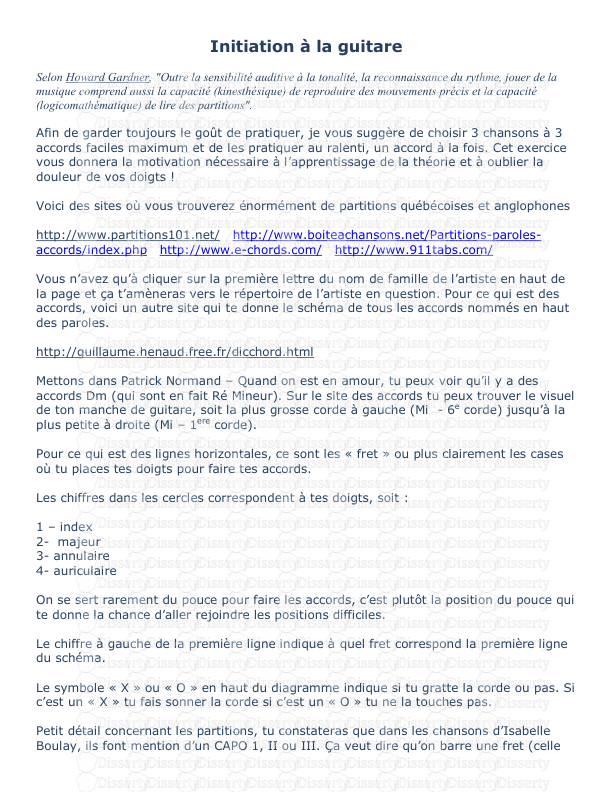







-
69
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 27, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 1.0699MB


