1 S Se ec ct te eu ur r f fr ra an nç ça ai is s Qu’est-ce que la lecture ? La
1 S Se ec ct te eu ur r f fr ra an nç ça ai is s Qu’est-ce que la lecture ? La lecture peut être définie comme une construction de sens résultant de la rencontre, dans un contexte particulier, entre un sujet et un texte écrit. Cette interaction permet la construction de significations (compréhension1 et interprétation2) et l’appréciation. 1. Le contexte Physique : le lieu et le moment de la lecture On ne lit pas de la même manière un même texte à 12 ans ou à 40 ans, dans un moment de loisir ou dans un temps contraint ; on ne lit pas de la même manière un même texte à la maison, dans le bus ou à l’école… Psychologique : le projet de lecture On lit aussi toujours un texte pour quelque chose : pour se distraire, pour rechercher ou vérifier une information, pour apprendre…Chaque intention de lecture nécessite de la part du lecteur une stratégie de lecture adéquate. À l’école, des projets de lecture variés qui dépassent la seule vérification de l’exécution de la tâche ou de la compréhension permettent de donner du sens à la lecture. Social Lecture individuelle ou collective, avec ou sans professeur, libre ou imposée, lecture pour soi ou à partager … 1 La compréhension relève des droits du texte. Le texte dit effectivement cela et il y a consensus entre lecteurs. 2 L’interprétation relève des droits du lecteur. Le lecteur peut faire dire cela au texte sans qu’il y ait de consensus entre lecteurs. « Après qu’un texte a été produit, il est possible de lui faire dire beaucoup de choses, mais il est impossible de lui faire dire ce qu’il ne dit pas. » (ECO U., Les limites de l’interprétation, Paris, Grasset-Fasquelle, 1992). Texte Instructions Construction de sens et appréciation Traitement Lecteur Contexte Intention 2 S Se ec ct te eu ur r f fr ra an nç ça ai is s 2. Le lecteur Les composantes affectives du lecteur : ses appétences Celles-ci sont faites d’attitudes et de valeurs attribuées par le lecteur à la lecture, à lui-même comme lecteur, à tel type ou tel genre de texte, à telle langue, à tel contenu ou à telle forme… Elles sont une sorte de préalable à l’apprentissage de la lecture qui n’est guère possible sans un attrait pour la lecture ni une attitude positive à son égard. Ces attitudes et valeurs sont fort tributaires de l’histoire personnelle de chaque individu et de la culture à laquelle il appartient. Un non-lecteur est souvent quelqu’un qui a de bonnes raisons de ne pas lire. La lecture n’est en effet pas seulement un acte technique, mais aussi un acte social et culturel. Par exemple, si les milieux cultivés valorisent l’écrit face à l’oral, d’autres milieux adoptent une attitude différente. L’écrit y est vécu comme la simple transcription insécurisante et trompeuse de la parole. Seule celle-ci permet de dire le vrai des choses, des émotions et des expériences. De même, pour certains milieux, la lecture n’a souvent de sens que dans son intention fonctionnelle, utilitaire et pratique. C’est ce qui fait dire à certains élèves que « La lecture de poèmes, c’est pour les poètes professionnels ! ». Les composantes cognitives du lecteur : son savoir et son savoir-faire ♦ Les connaissances Si jeune est-il, un lecteur dispose de connaissances générales sur le monde. Elles sont déterminantes pour la compréhension du texte. De nombreuses études ont montré qu’à savoir- faire égal de lecture, des lecteurs comprennent mieux, lisent plus vite et retiennent mieux un texte s’ils disposent de connaissances relatives à son contenu. Sans connaissances appropriées du contenu, même un bon lecteur peut se trouver dans l’impossibilité de comprendre le texte. Selon certains chercheurs, il faudrait posséder 80 % des informations du texte pour pouvoir prétendre le comprendre. C’est dire si l’encyclopédie personnelle du lecteur est sollicitée dans la lecture. Ces connaissances générales doivent s’accompagner de connaissances linguistiques (code graphique du français, lexique, syntaxe, orthographe, ponctuation…), textuelles (grammaire du texte) et littéraires (caractéristiques des genres, lieux clés des textes, références littéraires ou culturelles...). Augmenter les connaissances de l’élève, nourrir sa culture, c’est donc nourrir sa lecture. Si la culture est un moyen d’accès à la lecture, la lecture est aussi un moyen d’accès à la culture. Le déficit de connaissances peut expliquer en partie les difficultés rencontrées chez certains lecteurs. 3 S Se ec ct te eu ur r f fr ra an nç ça ai is s ♦ Les processus de lecture3 Un bon lecteur est quelqu’un qui mobilise ses connaissances par une série de processus : Lire, c’est Prélever de l’information Décodage : saisie des mots par l’œil Traiter l’information Identification de mots : accéder au lexique mental et choisir une signification pertinente, faire des hypothèses sur le sens de mots inconnus Prédiction : faire des hypothèses sur la suite du texte à partir d’indices visuels et linguistiques (objet-livre, paratexte, texte), les valider ou les réajuster en cours de lecture Repérage d’informations explicites Inférence : déduire l’implicite ou le non-dit de ce qui est explicitement dit, c’est-à-dire combler les blancs du texte en opérant des liens logiques, en identifiant les référents des substituts, en suppléant aux ellipses, en interprétant les actions ou sentiments non explicités, en identifiant les interlocuteurs non explicitement mentionnés, en interprétant des métaphores… Mise en relation entre les éléments verbaux et non verbaux (typographie, illustration…) Stocker et intégrer les informations Construction du sens global (de parties du texte au tout) présupposant la sélection des informations pertinentes, leur intégration en unités de sens de plus en plus larges et leur mémorisation Lire, c’est mémoriser, pendant un bref instant, dans sa mémoire à court terme, le petit nombre d’informations qu’on prélève avant de l’envoyer former un tout (en mémoire à long terme) avec le stock des informations déjà traitées. La mémoire de travail ne peut cependant retenir toutes les informations de manière littérale sans quoi elle serait saturée au bout de quelques lignes. Elle doit donc sélectionner l’information et la réduire en unités globalisantes de plus en plus larges. Contrôler la lecture Métacognition et contrôle : anticiper la tâche par le choix d’une stratégie de lecture adéquate au projet et au texte, contrôler et réguler la lecture Apprécier Réagir affectivement et intellectuellement au texte, apprécier le travail de l’écrivain sur la langue et évaluer les réponses données par le texte au projet initial Ces processus mentaux interactifs s’exercent à tous les niveaux du texte : des unités les plus locales (mots, phrases…) aux plus globales (paragraphes, chapitres, parties…). Chez un bon lecteur, la majorité des processus sont automatisés et inconscients sauf en cas de difficultés. Chez un faible lecteur, ils sont peu automatisés ou conscients, ce qui provoque une surcharge cognitive. Chez les très faibles lecteurs, toute l’attention est quasi monopolisée par les processus d’identification de mots et de décodage. Ceci empêche ces lecteurs d’activer les autres processus de construction de sens. 3 Pour une description détaillée de ces processus et des difficultés qu’ils posent aux lecteurs précaires, consulter FESEC, Français, Boite à outils n° 4 Parcours de lecture « L’huile d’olive ne meurt jamais » de S. CHERER, 2e degré de qualification, 2003. 4 S Se ec ct te eu ur r f fr ra an nç ça ai is s ♦ Les stratégies de lecture Les stratégies sont des manières de lire adoptées par le lecteur en fonction de l’intention de lecture et du genre de texte : la recherche d’informations dans un annuaire téléphonique ou dans une encyclopédie ne nécessite pas la même stratégie que celle déployée dans la lecture-plaisir d’une œuvre de fiction. Des stratégies de lecture ♦ lecture avec mouvements des lèvres ou à voix haute ♦ lecture silencieuse ♦ lecture linéaire (de gauche à droite) ♦ lecture tabulaire (dans de multiples directions) ♦ lecture intégrale avec ou sans pauses et retours en arrière, ♦ lecture survol ♦ lecture sélective ♦ relecture(s) … À ces stratégies générales de lecture, s’ajoutent des stratégies ciblées sur certains processus, comme l’identification du sens d’un mot lors de la rencontre d’un mot inconnu. Faire des hypothèses sur le sens d’un mot en ♦ stimulant ses connaissances antérieures sur ce mot ♦ observant la structure du mot (suffixe, préfixe, racine) ♦ observant le sens du contexte (thème et atmosphère) général de la partie du texte où se trouve le mot ♦ observant la phrase, l’expression sur le plan sémantique et syntaxique ♦ recourant à une aide (personne ou dictionnaire) Une compétence est constituée à la fois d’une capacité à faire et d’une réflexion sur ce faire. Cette dernière, faisant particulièrement défaut aux lecteurs précaires, sera favorisée par un enseignement explicite des stratégies et des processus de lecture. 3. Le texte Si le texte est un « mécanisme paresseux » qui réclame la collaboration de son lecteur, il lui donne simultanément une série d’instructions. Tout texte programme en quelque sorte sa lecture. Un annuaire n’est pas fait pour être lu comme une poésie. Il fait appel à une lecture sélective et uploads/Litterature/ questcequelalecture-pdf.pdf
Documents similaires




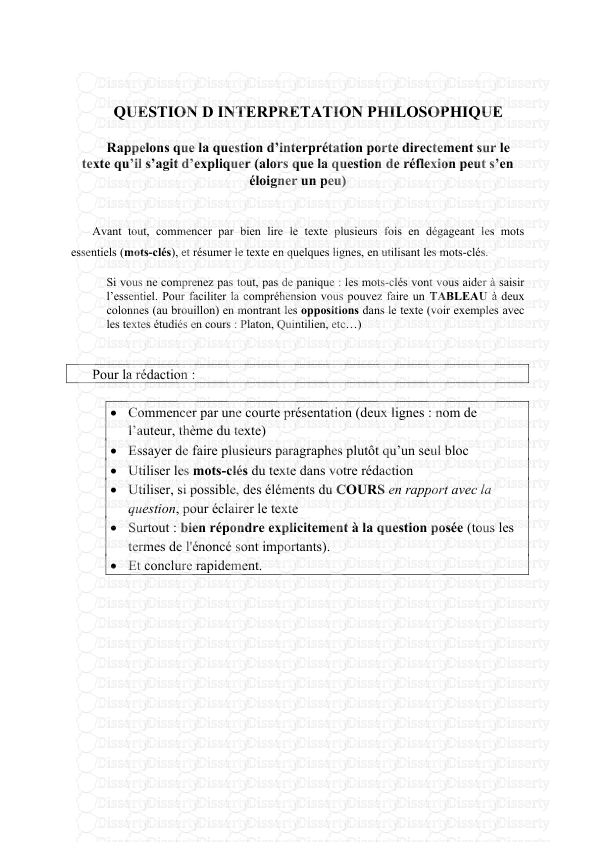





-
48
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 06, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0493MB


