Imaginaires du simulacre. Cahier du Centre de Recherche su l’image, le symbole
Imaginaires du simulacre. Cahier du Centre de Recherche su l’image, le symbole et le mythe 2 (1997). —- = DESTRUCTION DU RÉEL ET DISSOLUTION DU SUJET CHEZ BORGES Roland QUILLIOT L'œuvre de Borges ne se réduit assurément pas à Fictions. S’il est vrai que c’est ce recueil qui lui a tout d’abord assuré la célébrité internationale, à partir de sa traduction au début des années soixante, on n’a cessé depuis cette époque de découvrir la richesse et la diversité des facettes du talent de son auteur. On a pu constater par exemple qu’à côté des contes baroques et vertigineux de sa période de maturité, il était capable aussi d’écrire des récits d’une facture plus sobre et plus classique, dans le style de Kipling, ceux qu’on trouve par exemple dans Le rapport de Brodie ou Le livre de sable. À côté du narrateur, on a découvert par ailleurs l’essayiste d’Enquêtes, le critique littéraire, le conférencier, le causeur, l’auteur même de précis d’initiation au Bouddhisme ou aux ancienneslittératures germaniques. Et surtout on a progressivement compris que sa vocation artistique fondamentale était, autant et plus que celle d’un prosateur, celle d’un poète: les magnifiques recueils de la vieillesse, L'autre, le même, L'or des tigres, Eloge de l'ombre, La rose profonde, qui réinventent la poésie métaphysique avec une qualité de pathétique probablement sans équivalent à notre époque, ne font que porter à son point d'achèvement un lyrisme dont les premiers textes borgésiens, écrits quarante ou cinquante ans plus tôt, ceux par exemple de Ferveur de Buenos-Aires, avaient déjà donné de beaux exemples. Bref, on a peu à peu appris à mieux connaître un écrivain d’une grande complexité, qu’il ne faut surtout pas prendre pour un esthète cérébral et déshumanisé, alors que son originalité est au contraire de conjoindre, en un alliage absolument neuf, l’intelligence logique et la passion subjective, le goût de la discussion esthétique ou philosophique et le sens du tragique existentiel. Il reste malgré tout que la lecture de Fictions est aujourd’hui encore l’une des meilleures portes d’entrée dans l’univers borgésien. Et que c’est de ce recueil si insolite qu’il faut partir pour comprendre la logique qui organise cet univers. Si donc on veut essayer de caractériser l’effet que produisent les textes qui le composent, les premiers mots qui viennent à l’esprit sont sans doute ceux d’étrangeté, et même plus profondément d’irréalité: en les lisant, nous sommes troublés, nous avons l’impression de ne plus savoir où nous sommes, ni qui nous sommes, de sentir se fissurer nos certitudes concernant la réalité du monde dans lequel nous vivons. Cet effet est bien sur entièrement voulu. L’expression de destruction du réel qui apparaît dans le titre de cet exposé n’est ni une métaphore ni une exagération. Le projet de Borges, du moins du Borges de Fictions, est bel et bien, non sans doute d’anéantir la réalité extérieure en tant que telle, mais de la rendre impensable. C’est un projet qu’il ne faut pas seulement qualifier d’irréaliste, mais d’antiréaliste : c’est-à-dire qu’il ne vise pas seulement à rendre vraisemblable ce que nous savons impossible dans notre monde, commele font généralement les écrivains fantastiques, mais à rendre la réalité de ce monde même invraisemblable. A la limite, il s’agit bel et bien de démontrer par la littérature une métaphysique de type idéaliste, affirmant qu’il n’y a pas de différence entre le réel et la fiction, ou, si l’on veut conserver malgré tout une réalité indépendante, qu’elle obéit à des lois totalement différentes de celles que nous avons l’habitude d’accepter. Ce projet de destruction du réel, on peut le trouver décrit dans la première nouvelle de Fictions, qui évoque allégoriquement le programme que se donne à un certain moment Borges. Dans Tlôn, Ugbar, Orbis tertius, nous avons, on le sait, affaire à une société secrète qui se donne pour tâche d’inventer une planète, et d’en décrire méthodiquement, dans une immense encyclopédie, tous les aspects, depuis les espèces végétales et animales qui la peuplent, jusqu'aux langues qu’on y parle et aux philosophies qu’on y pratique. Le sens de cette entreprise est de type métaphysique. Il s’agit explicitement, pour le « fondateur mégalomane de la secte, de prouver au Dieu inexistant que les mortels sont capables de concevoir un monde ». Mais à peine réalisée, cette première phase de l’entreprise apparaît insuffisante. Ce que veulent désormais les membres de la confrérie, c’est substituer le monde qu’ils ont inventé et rationnellement construit à celui dans lequel nous vivons. Et ce projet tend lui aussi à se réaliser progressivement à la fin du récit. Subjugués par ce cosmos ordonné, qu'ils ont découvert au moment où les volumes de l’encyclopédie de Tlôn ont été divulgués, les hommes adoptent volontairement les langues et les coutumes. Bientôt, écrit le narrateur, « l’anglais, le français, et même l’espagnol disparaîtront de la planète. Le monde sera Tlôn ». Si l’on ajoute que la caractéristique essentielle de la vision du monde des habitants de cette planète imaginaire est d’être strictement idéaliste, d'ignorer la notion de matière, et de réduire le monde à une série de perceptions subjectives, on voit que la réalité a été doublement détruite. Un univers totalement fictif, et dans lequel l’idée d’un réel indépendant de l’esprit n’a de surcroît aucun sens, l’a remplacée. La signification de ce conte étrange semble (au moins) double. Ecrit au plus fort de la tourmente des années 40, il a incontestablement pour but de dénoncer les fantasmes démiurgiques qui sont parfois à l’origine des projets de reconstruction utopiste et totalitaire de la société. Mais d’une certaine façon,il est aussi aux yeux de Borges une représentation symbolique de sa propre entreprise littéraire, qui pour être, elle, absolument innocente, n’en est pas moins d’une extrême radicalité. Il faut cependant ajouter ici une précision essentielle: c’est que cette entreprise borgésienne de dissolution du réel a quelque chose d’héroïque et de désespéré. Quels que soient en effet les efforts pour nous suggérer que la vie est un songe, pour rendre indiscernables la réalité et la fiction, l’écrivain argentin ne se fait aucune illusion sur le résultat effectif que peut atteindre son travail de déstabilisation du sens commun. Le texte le plus significatif sur la nature de son projet se trouve à cet égard à la fin de l’essai intitulé Nouvelle Réfutation du temps. Après avoir développé les arguments les plus brillants pour démontrer, dans la tradition de Sextus Empiricus, l’irréalité de ce temps dont la métaphysique a de fait toujours tendu à faire une illusion et une simple image mobile de l’éternité, notre auteur y laisse in extremis échapper l’aveu suivant, combien révélateur : « and yet, and yet.» Nier la succession temporelle, nier le moi, nier l’univers astronomique, ce sont en apparence des sujets de désespoir, et en secret, des consolations. Notre destin (à la différence de l’enfer de Swedentorg et de celui de la mythologie thibétaine) n’est pas effrayant parce qu’il est irréel ; 1l est effrayant parce qu’il est irréversible, parce qu’il est de fer. Le temps est la substance dont je suis fait. Le temps est un fleuve qui m’entraîne, mais je suis le temps ; c’est un tigre qui me déchire, mais je suis le tigre; c’est un feu qui me consume, mais je suis le feu. Pour notre malheur, le monde est réel, et moi, pour mon malheur, je suis Borges. | En entendant ces phrases, on réalise que l’auteur de Fictions est en fait plus qu’un autre conscient de l’opacité d’une réalité extérieure qui le déborde et l’écrase. Pourquoi alors s’emploie-t-1l à la rendre impensable ? Pour deux raisons. Son premier but est sans doute de rappeler que cette réalité est toujours au-delà des représentations que nous pouvons nous en faire. Le réalisme imitatif naïf tend toujours à nous faire confondre les choses avec les mots par lesquels nous les nommons, ou les images par lesquelles nous les représentons. L’idéalisme borgésien vise au contraire à marquer radicalement la différence entre le réel et les symboles au travers desquels nous l’atteignons. Cela d’abord pour inciter la littérature à prendre conscience de son caractère de fiction et d’artifice — et en ce sens, les contes de notre auteur sont des contes du deuxième ordre, qui proposent la théorie de l’activité dont 1ls sont le résultat —. Cela ensuite aussi pour proposer du réel la définition la plus radicale possible: celle qui le conçoit comme ce qui échappe par essence à ce que nous pensons de lui. Très significatif est à cet égard le poème intitulé L'autre tigre. Borges s’y représente en train d’imaginer un tigre dans la jungle, cet animal qui dans sa mythologie personnelle, symbolise le mélange de grâce et de violence qui caractérise le dynamisme vital sous ses formes les plus spontanées; à peine a-t-1l commencé à laisser son imagination vagabonder, qu’il réalise que ce qu’il a pris pour le tigre réel n’est autre que son symbole. Mais en effectuant cette distinction entre le tigre représenté et le tigre réel, il s’engage dans une régression à l’infini, puisque ce qu’il appelle le tigre réel s’avère à uploads/Litterature/ quilliot-roland-destruction-du-reel-et-dissolution-du-sujet-chez.pdf
Documents similaires



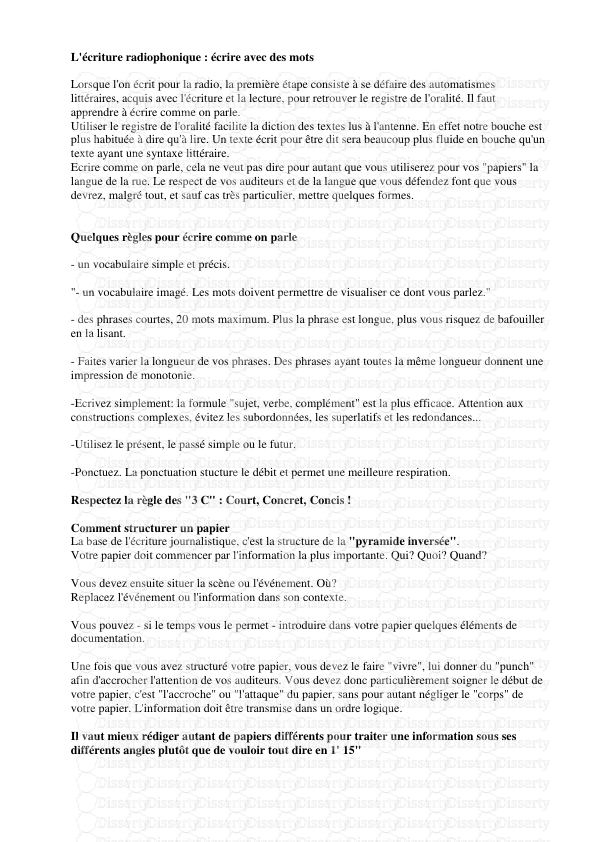




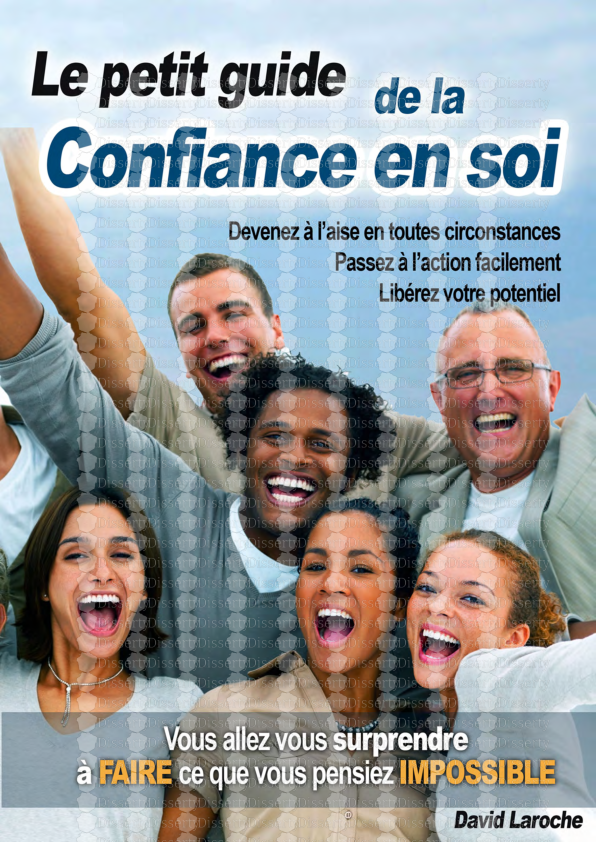

-
79
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 21, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 8.7115MB


