Université « Babeș-Bolyai » L’institut des études doctorales L’école doctorale
Université « Babeș-Bolyai » L’institut des études doctorales L’école doctorale d’études linguistiques et littéraires PROJET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE Ière année Prof. Coordonnateur : Maître de conférences Simona Jișa Doctorant : Constantin-Ciprian Onofrei CLUJ-NAPOCA 2021 Sujet de thèse Titre : Une mythologie du Mal : Imago pestis dans la littérature française du XXIe siècle Mots clés : peste, image littéraire, mal, démythisation/remythisation Argumentaire : Depuis l’Antiquité, l’homme a pensé que son existence est gouvernée par deux principes indicibles, le Bien et le Mal. Si le Bien incarne tout ce qui est bénéfique à l’être humain et qui se trouve en relation avec la Divinité, synonyme de la morale, alors le Mal ne représente que l’opposé. Il reflète toutes les actions et toutes les pensées humaines néfastes qui ne sont pas subjugués à la morale et au dogme religieux. Cela se note plutôt dans le cas des représentants de la philosophie grecque ancienne, comme les Épicuriens et les Stoïciens, qui essayaient de définir et d’expliquer le concept de Bien, négligeant son antagoniste. Pour eux, la beauté et la vertu étaient des concepts-clés pour définir le Bien, tandis que la maladie, la punition et la mort représentaient des notions appartenant au champ lexical du Mal, par le simple fait qu’elles faisaient peur. Il faut ajouter que le terme « maladie » englobait, d’une manière générale, toutes les infections et toutes les affections du corps humain, étant retrouvé, jusqu’au XIVe siècle, sous la forme latine de pestis, qui signifiait « maladie contagieuse ». C’est dans cette situation que la maladie qui frappera Athènes en -430 prendra le nom de « peste » et sera connue comme une des premières épidémies de l’Antiquité, associée au Mal à cause des pertes de vies humaines qu’elle a générée. En tout cas, la conception du Mal changera radicalement au Moyen Âge chrétien, où la maladie ne sera plus considérée comme quelque chose de mauvais, devenant l’expression d’un châtiment d’ordre divin envoyé sur la terre afin de punir les pécheurs. Il s’agit plutôt de la première pandémie de peste de 541 à 549, nommée « la Peste de Justinien » et de la deuxième pandémie, nommée « la Mort Noire » qui commence en 1347 et s’éteint à la fin du XIXe siècle, 2 avec plusieurs épisodes à l’échelle mondiale, considérées par les chrétiens et les institutions religieuses comme des anticipations de l’Apocalypse et des manifestations de la colère divine. La tentative de définition de cette maladie change totalement avec la découverte du bactériologiste franco-suisse, Alexandre Yersin, qui, le 20 juin 1894, élucide, le mystère de la peste, en trouvant le responsable du fléau, la bactérie microscopique Yersinia pestis. Par l’intermédiaire du premier testimonial de Yersin, on assiste à un véritable succès médical du domaine bactériologique : « Je reconnais [dans la peste] une véritable purée de microbes tous semblables. Ce sont de petits bâtonnets trapus, à extrémité arrondie »1. En effet, ce moment place la peste, sous le signe du réel, d’un petit organisme qui a décimé la vie des millions des gens. Ainsi, cette maladie complétement diabolique, du point de vue médical et historique, acquiert de nouvelles significations aux yeux des croyants et des hommes de science, qui ont essayé et essaient encore de découvrir les méandres cachés de l’épidémie de peste. Dans mon projet de recherche je m’intéresserai à l’image de la peste d’une perspective littéraire, telle qu’elle ressort de la littérature française du XXIe siècle. Ma recherche a comme but la mise en exergue de différentes formes et significations qu’on attribue à la pandémie de peste, à travers des romans contemporains que je considère comme significatifs, appartenant à des typologies différentes : le roman policier, historique, de science-fiction (SF), biographique, le thriller et le roman poétique. Mon intention sera de mettre en évidence les différentes significations et fonctions que la peste acquiert, lorsque la réalité historique passe par un filtre littéraire. Je me propose aussi de contester l’idée, soutenue par Jacques Rougeon, conformément à laquelle « dans l’imaginaire du lecteur, la peste éveille la mémoire d’une souffrance ancienne et terrible »2, en démontrant que le récit de la maladie représente d’un côté, une mythification de la réalité, la colère divine et le Mal-Mort qui cherche de punir les êtres humains et de l’autre côté, il s’agit d’une remontée à l’origine de l’homme afin de mieux connaître sa vraie nature, le Mal, envisagé par le dogme chrétien sous le nom de péché originel. Ensuite, ayant comme point de départ des épisodes de peste réels, historiquement attestés et en analysant son évocation au cadre du roman du XXIe siècle, j’essaierai de réaliser une sorte de dichotomie entre le corps et l’esprit malade, de la maladie provoquée par le bacille Yersinia Pestis. Au cas de la représentation du corps affecté par la peste, les chroniques historiques et les rapports cliniques nous donnent beaucoup d’informations sur ses symptômes, 1 Cité par Jean Vitaux dans Histoire de la Peste, Paris, Presses Universitaires de France, 2010, p. 78. 2 Jacques Rougeon, La peste d’Albert Camus, Paris, Gallimard, 1947, p. 13. 3 les éléments récurrents étant les ganglions lymphatiques enflés et douloureux (les bubons), les tâches noires sur la peau, la fièvre, les frissons et l’odeur de pourriture du corps. Les agents pathogènes réels responsables pour la diffusion de la peste sont les rats qui portent des puces infectées par des bactéries pestiférées et qui affectent seulement le corps humain. En ce qui concerne la partie immatérielle de l’homme, son esprit, j’essaierai de montrer au cours de ma thèse qu’il peut être aussi affecté, pas par des agents pathogènes réels comme les rats et leurs puces, mais par des signes distincts comme les mots et les récits littéraires qu’ils constituent. À l’intérieur du récit romanesque sur la maladie, l’esprit devient lui aussi « malade » parce que le virus, imaginaire ou mieux dit fictionnel, « se propage » dans le langage littéraire et dans le cœur du lecteur qui accompagne les personnages tout au long du récit. Dans cette situation, le corps du lecteur n’est pas « affecté », l’esprit étant le bouclier qui absorbe le pouvoir et les effets de la « maladie » créée par recours à l’illusion romanesque. De même, dans ma thèse je m’intéresserai aussi à la création de l’image littéraire de la peste et à ses fonctions au sein des romans français du XXIe siècle. Même si la pandémie de peste semble un événement facile à raconter et à présenter, au cadre du récit romanesque l’évocation de la maladie joue un rôle très important. Le lexique, la description minutieuse de l’affection, la mise en contexte et la vraisemblance, en se rapportant aux études cliniques, représentent des éléments indispensables dans mon analyse qui me permettront d’identifier le rôle et les buts littéraires de la maladie. Tous ces éléments m’aideront à trouver la réponse à une question qui se trouve à la base de ma thèse : Pourquoi écrire sur la peste au XXIe siècle ? Cependant, il faut mentionner que, pour moi, cette ressuscitation de la pandémie au sein du récit littéraire ne fait que créer l’impression d’un voile mystique qui entoure les œuvres romanesques, élément qui m’a fait réfléchir à une sorte de mythisation de la peste dans le roman du XXIe siècle. Étant attiré par le domaine mythologique qui parfois trouve son écho dans l’interprétation allégorique, je pense que la maladie, invisible aux yeux humains, ne représente qu’une image de la grande peur de l’homme, la mort. Une mort menée à rappeler et à punir l’origine vitiosa de l’être humain : le péché originaire ou le premier mal. Le concept de Mal se reflète dans le titre de mon projet de recherche « Une mythologie du Mal : Imago pestis dans la littérature française du XXIe siècle » où la notion de Mal semble être subordonnée au concept de mythe, même si la mythologie représente une étude systématique des mythes et le Mal incarne plutôt un élément qui tient de l’éthique et de la morale. En réalité, il ne 4 s’agit pas d’un rapport de subordination entre le mythe et le Mal, mais plutôt d’une relation d’interdépendance. Selon moi, le Mal, un élément qui tient du niveau conceptuel et qui n’a pas une forme matérielle proprement dite, peut se concrétiser dans l’espace réel et littéraire, non pas seulement par les actions des hommes, mais aussi à travers la mythologie, domaine qui permet l’explication d’un événement « inexplicable » à travers des images sacrées ou profanes. Par exemple, dans l’Antiquité les gens ne pouvaient pas s’expliquer d’où vient la pluie, le tonnerre, la foudre, en les mettant sous le signe d’un Dieu ou d’une divinité protectrice et en leur attribuant des significations diverses. C’est dans cette situation que l’épidémie de peste et ses manifestations inexplicables au Moyen Âge, représentait une sorte d’incarnation du Mal sur la terre, ou dans l’acception chrétienne, le pouvoir de Dieu qui apporte le Jugement Dernier, sous la forme de l’enfer terrestre. Du point de vue de la raison, l’épidémie de peste devient uploads/Litterature/ raport-i-final-corectat.pdf
Documents similaires


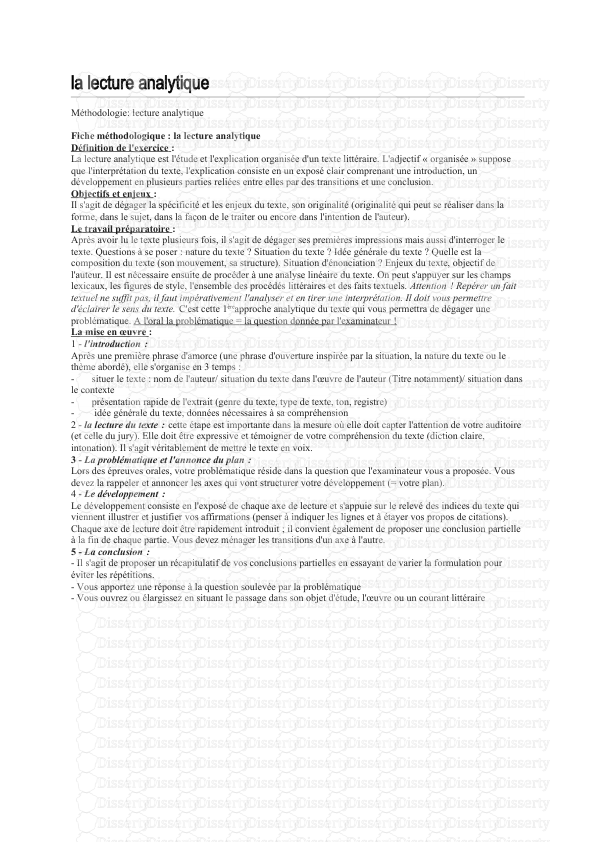







-
136
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 20, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3531MB


