REA, T. 115, 2013, n°2, p. 445 à 461 * EHESS, Paris ; roccorm@ehess.fr LA GLOIR
REA, T. 115, 2013, n°2, p. 445 à 461 * EHESS, Paris ; roccorm@ehess.fr LA GLOIRE D’ALCESTE À ATHÈNES. À PROPOS D’EUR., ALC., 445-454. Rocco MARSEGLIA* Résumé. – Dans cet article, l’auteur analyse les difficultés interprétatives que posent les vers 445-454 de l’Alceste d’Euripide, à savoir la pertinence de l’opposition entre les « chants sur la lyre » et les « chants sans lyre » et de l’évocation de Sparte et Athènes comme les endroits où la gloire d’Alceste sera perpétuée par le chant des poètes. L’auteur suggère de lire dans ce passage une allusion au dithyrambe. En effet, les « chants sans lyre » renvoient à des chants exécutés sur d’autres instruments, tels que l’aulos et, en parlant d’Athènes, le chœur utilise l’épithète λιπαραί que Pindare avait utilisé dans un dithyrambe chanté à Athènes et rendu célèbre. Le festival des Thargélies aurait pu représenter un contexte idéal pour la célébration du mythe d’Alceste. Abstract. – In this paper, the author analyzes the problems related to the interpretation of verses 445-454 of Euripides’ Alcestis, and in particular the pertinence of the opposition between « songs accompanied by a lyre » and « lyre-less songs » and the evocation of Sparta and Athens as places where Alcestis would be glorified by the poets. The author suggests interpreting this passage as an allusion to dithyramb. So the « lyre-less songs » would refer to songs accompanied by wind instruments, like the aulos, and the chorus, by calling Athens λιπαραί, uses the epithet that Pindar used and made famous in a dithyramb to Athenians. The festival of Thargelia would have been an ideal context for the celebration of this myth. Mots-clés. – tragédie, Euripide, Alceste, interprétation, mythe d’Alceste, dithyrambe, Carnéennes, Thargélies. 446 rocco marseglia Le deuxième stasimon d’Alceste a posé et continue de poser aux interprètes de nombreuses questions 1. Dans cet article, après une présentation générale du caractère et du contenu du chant choral en question, nous allons nous intéresser en particulier à la première antistrophe et aux deux principales questions d’interprétation qu’elle pose, à savoir la pertinence et la signification de l’opposition entre les « chants sur la lyre » et les « chants sans lyre » et le sens de l’association entre les cités de Sparte et Athènes, que le chœur évoque comme les endroits où la gloire d’Alceste serait perpétuée par le chant des poètes. Nous présenterons les diverses solutions et interprétations proposées par les savants et nous suggérerons de lire l’allusion aux « chants sans lyre » et l’évocation d’Athènes comme une allusion aux chants dithyrambiques. En conclusion, et seulement sous forme d’hypothèse, nous essaierons de reconstituer un contexte possible dans lequel des chants dithyrambiques rappelant l’histoire d’Alceste et en célébrant la gloire auraient pu trouver leur place dans la ville d’Athènes. Le deuxième stasimon se situe juste après la mort d’Alceste et la monodie du petit Eumélos. Le cadavre d’Alceste est transporté à l’intérieur de la maison et Admète se prépare à conduire le cortège funèbre. Entre temps, il a demandé aux citoyens qui forment le chœur d’« entonner un péan en réponse à Hadès » 2. Cette expression en oxymoron prend dans l’ensemble de la tragédie un sens particulier : le « péan d’Hadès » reflète les ambiguïtés et la duplicité qui parcourent cette tragédie tout entière, le thrène et le péan se confondent, le chant du chœur, bien plus que de déplorer la mort d’Alceste, en célèbre la gloire impérissable. Commencé juste après la mort d’Alceste, le chant du chœur s’achève sur l’arrivée d’Héraclès à la porte d’Admète. C’est dire donc la place centrale que ce chant occupe à l’intérieur de la structure de la tragédie : il la divise en deux parties, dont la première est centrée sur la mort d’Alceste et la deuxième sur l’arrivée d’Héraclès et sur le retour d’Alceste que cet hôte extraordinaire saura réaliser. Ainsi, le « péan » entonné par le chœur non seulement célèbre Alceste et la gloire poétique qui lui permet d’atteindre l’immortalité, mais débouche aussi sur l’apparition d’Héraclès, qui sera le sauveur et le libérateur de la reine 3. Cette double tension qui anime ce chant choral et qui en fait un point de jonction idéal entre les deux mouvements essentiels de la pièce, ressort de manière évidente de l’analyse de son contenu et de sa structure. En s’adressant directement à Alceste à la deuxième personne, le chœur lui souhaite d’habiter heureuse la maison d’Hadès et n’oublie pas de rappeler à Hadès et à Charon que c’est la « meilleure des femmes » (v. 442 : γυναῖκ᾽ ἀρίσταν) qu’ils vont accueillir. Dans la première antistrophe, le chœur annonce la gloire qu’Alceste ne manquera pas d’obtenir grâce au chant des poètes. La deuxième strophe revient sur l’excellence d’Alceste, introduit le thème de la résurrection (v. 455-457 : εἴθ̓ ἐπ̓ ἐμοὶ μὲν εἴη, / δυναίμαν δέ σε 1. Je tiens à remercier Giorgio Ieranò, qui m’a suggéré d’approfondir l’idée qui est à la base de ce texte et qui m’a permis d’enrichir cette démonstration grâce à ses précieuses remarques. 2. Vers 423-424 : πάρεστε καὶ μένοντες ἀντηχήσατε / παιᾶνα τῷ κάτωθεν ἄσπονδον θεῷ. 3. Cette fonction de jonction a bien été remarquée par D. J. Conacher, Euripides. Alcestis, Warminster 1993, p. 173 : « And so this ode, though its main function is to look back on Alcestis’ noble death, provides as well anticipatory hints of the “Pheres scene” and of the “resurrection scene” to come ». la gloire d’alceste à athènes. à propos d’eur., alc., 445-454. 447 πέμψαι / φάος) et rappelle la promesse qu’Admète a faite de ne pas se remarier. La deuxième antistrophe résume brièvement l’histoire du sacrifice d’Alceste : elle a été la seule à accepter de se sacrifier pour son mari, ce que même les vieux parents d’Admète n’ont pas voulu faire. 1. – PROBLÈMES D’INTERPRÉTATION : « CHANTS SUR LA LYRE ET CHANTS SANS LYRE » Parmi les nombreuses difficultés que ce deuxième stasimon pose aux lecteurs d’Euripide, nous ne nous intéresserons ici qu’aux problèmes d’interprétation de la première antistrophe, sans aborder les différents problèmes d’établissement du texte et de responsio métrique 4 qui ne concernent pas le passage que nous examinons 5 et qui, en tout cas, ne modifient aucunement le sens général du chant. Comme nous l’avons rappelé, dans cette première antistrophe, le chœur annonce la gloire que le chant des poètes va assurer à Alceste : πολλά σε μουσοπόλοι μέλψουσι καθ̓ ἑπτάτονόν τ̓ ὀρείαν χέλυν ἔν τ̓ ἀλύροις κλέοντες ὕμνοις, Σπάρτᾳ κυκλὰς ἁνίκα Καρνεί- ου περινίσεται ὥρα μηνός, ἀειρομένας παννύχου σελάνας, λιπαραῖσί τ̓ ἐν ὀλβίαις Ἀθάναις. τοίαν ἔλιπες θανοῦσα μολ- πὰν μελέων ἀοιδοῖς. Les serviteurs de la Muse vont te chanter à maintes reprises sur la lyre aux sept cordes et même en chants sans lyre, à Sparte, lorsque le mois Carnéen revient et la lune est haute dans le ciel pendant toute la nuit, et dans la magnifique et heureuse Athènes : telle est la matière de chant que, par ta mort, tu as laissée aux poètes (v. 445-454). Le chœur préfigure la gloire d’Alceste, qui sera célébrée, assure-t-il, tant au son de la lyre que par des ὕμνοι ἄλυροι. Mais comment faut-il interpréter cet adjectif ? Il pourrait en effet désigner aussi bien des compositions poétiques dépourvues de tout accompagnement musical 4. Pour toutes les questions métriques, on pourra se reporter à la discussion approfondie qu’en fait récemment L. P. E. Parker, Euripides. Alcestis, Oxford 2007, p. 143-147. 5. Pour ce qui concerne le problème de la correspondance entre les vers 436 et 446, les différentes solutions proposées touchent toujours au vers 436. À ce propos, on pourra se reporter à la discussion du passage chez J. Diggle, Euripidea. Collected Essays, Oxford 1994, p. 199-200 et L. P. E. Parker, op. cit., p. 145-146. Pour ce qui concerne les vers 448-449, où la plupart des manuscrits présentent deux nominatifs (κύκλος et ὥρα), nous adoptons la correction κυκλάς, la solution la plus économique proposée par Scaliger. En tout cas, quelle que soit la solution textuelle, le sens n’en est pas affecté. Pour une discussion des différentes solutions envisagées par les savants on renvoie à L. P. E. Parker, op. cit., p. 150-151. 448 rocco marseglia que des chants exécutés à l’aide d’un instrument autre que la lyre, c’est-à-dire d’un instrument à vent. Deux oppositions pourraient donc se dessiner : si l’on accepte la première explication, le chœur opposerait poésie récitée (ou, peut-être même, prose) et poésie chantée ; si l’on préfère la deuxième solution, l’opposition porterait sur l’instrument d’accompagnement, lyre d’une part et instruments à vent de l’autre. La première solution est suggérée par la scolie au vers 447, qui glose : μετὰ λύρας <καὶ ἄνευ λύρας>. καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Αἴαντι Λοκρῷ ‘καὶ πεζὰ καὶ φορμικτά’. καὶ πεζαὶ δέ τινες ἑταῖραι λέγονται, αἳ χωρὶς ὀργάνου εἰς τὰ συμπόσια φοιτῶσιν. Avec et sans lyre. De même, chez Sophocle, on peut lire dans l’Ajax Locrien « paroles prosaïques et paroles accompagnées de la lyre ». Et on appelait « uploads/Litterature/ rocco-marseglia-rea-115-2013.pdf
Documents similaires









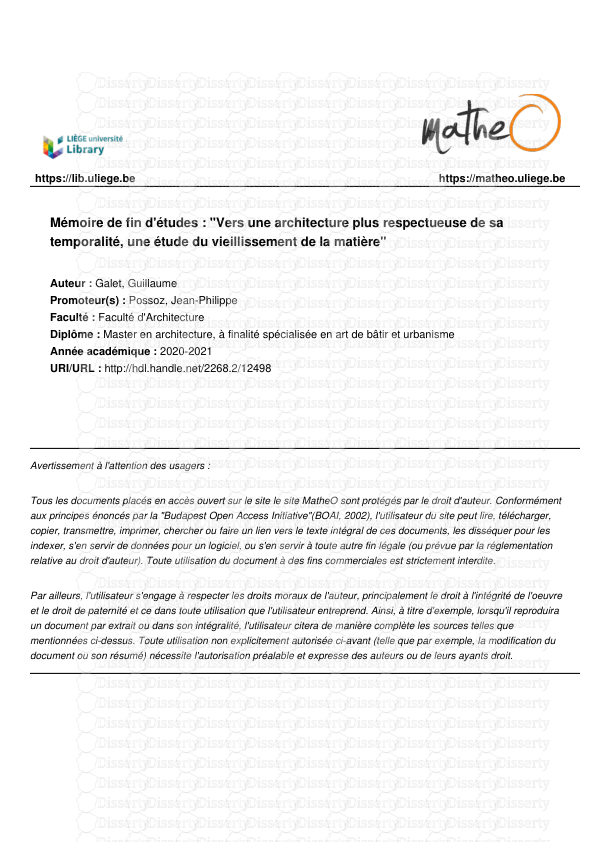
-
67
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 17, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2982MB


