LITTÉRATURES J ulia Kristeva a toujours aimé le risque. Etudiante arrivée de Bu
LITTÉRATURES J ulia Kristeva a toujours aimé le risque. Etudiante arrivée de Bulgarie à la fin de 1965, elle est vite remarquée par Roland Barthes et se lie au groupe Tel Quel. Décidant de rester en France, elle aurait pu se contenter d’être une sémiologue promise à une brillante carrière uni- versitaire. Mais elle a voulu devenir aussi psychanalyste, et, là encore, elle s’est imposée. Intellectuelle reconnue, ensei- gnant en France et à l’étranger, auteur d’une vingtaine d’essais, elle semblait n’avoir plus rien à prou- ver. Or, en 1990, elle a choisi de prendre le risque du roman. Le pre- mier, Les Samouraïs, traçant le par- cours de « la génération Tel Quel », a été bien reçu ; les deux autres Le Vieil Homme et les loups et Posses- sions (1) ont été l’objet de critiques assez rudes, blessantes parfois. Ce qui a conduit Julia Kristeva à relever le défi et à s’engager davan- tage, avec Meurtre à Byzance, un polar intellectuel et historique, qui est aussi son roman le plus autobio- graphique, le plus politique – et c’est une réussite. Un texte protéi- forme et polyphonique entremê- lant polar métaphysique et quête d’identité, ouvrant sur un récit histo- rique doublé d’une histoire d’amour et d’un voyage onirique dans sa Byzance. Le tout sur fond de globalisation et de corruption – à Santa Barbara, métaphore du villa- ge planétaire. Après ces années de relation ten- dues avec la presse littéraire, on imaginait Julia Kristeva méfiante. C’est au contraire une femme cha- leureuse et attentive qui s’explique sur son rapport au roman, et singu- lièrement au roman policier, moyen idéal d’aborder, de biais, des sujets douloureux. « Le roman est ma façon de jouer avec le silence, le rythme des ellipses ouvrant à une plénitude paradoxale, sans illusions. Cette plénitude au-delà du silence concerne des états de douleur. Après Les Samouraïs, j’ai écrit pour faire le deuil de mon père. La forme du roman policier s’est imposée alors pour approfondir une gravité et ce qu’il y a de plus ina- bordable : la pulsion de mort. Le thriller permet de rester dans l’ouvert car l’enquête est une version de l’opti- misme, pour moi la seule. On n’éradi- que pas le mal, mais on peut savoir d’où vient ce mal radical qu’est le meurtre. » Explorer et questionner les « états infernaux de la person nalité », tout en restant dans l’ouverture, c’est là que se tient la romancière – sans cacher sa dette envers la psychanalyse : « A force de travailler cet entre-deux, l’abîme et le partageable, j’ai trouvé le coura- ge d’aborder le roman. » Pour trou- ver une langue « en deçà et au-delà du langage, dans le sens, l’humeur, l’ironie, c’est mon véritable “habitat” ». Et dépasser ses blessu- res : la perte du père, la difficulté d’être mère (Possessions), puis le deuil de sa mère autour duquel s’est cristallisé Meurtre à Byzance, avec une interrogation qui traverse son œuvre, théorique comme romanes- que : « Où est-on quand on est nulle part ? » – explorée de manière pas- sionnante dans Etrangers à nous- mêmes (2). C’est en partant de son nom (« de la croix » en bulgare) que Julia Kristeva a commencé une enquête, « savante et onirique », qui lui a fait découvrir Anne Comnène (« une femme extraordinaire »), et l’a menée du Puy-en-Velay, point de départ de la première croisade (1096-1099), aux lieux de son enfan- ce en Bulgarie. « J’ai commencé en 1995, mais cela a pris du temps car il fallait lire, se documenter et mûrir ce sujet. Je ne voulais pas faire un simple récit histo- rique mais le tisser avec mon histoire, et le présenter comme un voyage dans le temps, qui nous fait rêver tous, surtout aujourd’hui avec la réu- nification de l’Europe, la mondialisa- tion, les nouvelles croisades… Puis, il y a eu le 11 septembre et le décès de ma mère, qui a été un choc très éprouvant. Comme s’il fallait soudain payer une dette aux origines. » Aux premières lignes de Meurtre à Byzance, ce rêve prend tout d’abord les allures d’un cauchemar pour le commissaire principal Northrop Rilsky, avec la découverte du corps d’un haut dignitaire du Nouveau Panthéon, septième victi- me du « Purificateur » ; puis la dis- parition du professeur Sebastian Chrest-Jones. Quel lien peut-il y avoir entre un serial killer affichant une volonté d’éradiquer la corrup- tion à Santa Barbara, et un universi- taire, spécialiste d’histoire des migrations, qui, secrètement, mène des recherches sur la première croi- sade et Byzance ? C’est ce que va tenter d’élucider Rilsky, flic méloma- ne aux allures de Clint Eastwood, aidé par son amie (bientôt amante), Stéphanie Delacour, héroïne récur- rente et double de la romancière. Dépêchée par L’Evénement de Paris, la journaliste délaisse vite la piste du serial killer pour suivre celle de Chrest-Jones, bâtard en quête de filiation, parti en Bulgarie sur les traces de son ancêtre. Hap- pée par le périple de ce migrant bles- sé, Stéphanie Delacour ne tarde pas à être fascinée, comme lui, par Anne Comnène, « rêveuse stendha- lienne », qui devint historienne par amour pour son père, Alexis I er. Nourrie d’hellénisme, de mythe et de byzantinisme, fine observatrice et stratège, elle retraça le règne de ce père aimé dans l’Alexiade. A partir des extraits de ce texte méconnu et du regard de cette chro- niqueuse visionnaire, Julia Kristeva, plus byzantine que jamais, relate la croisade et dessine le portrait de sa Byzance intime et moderne. Une Byzance qu’exalte, avec une ironie désabusée, Stéphanie Delacour : « Les ravages des iconoclastes et les images sanctifiées des iconodules sans lesquels le monde n’aurait jamais connu la télévision, les Guy Debord, Loft Story et un Ben Laden (…) ; la première guerre de religion sur le Vieux Continent, ces légendai- res Croisades qui inspirent doréna- vant le président Bush, avec pogro- mes, saccages de trésors, tentative ratée (déjà !) d’unification européen- ne (…) c’est encore et toujours par Byzance que ça passe. De ce point de vue, (…) Byzance c’est l’Europe dans ce qu’elle a de plus précieux, raffiné et douloureux, que les autres lui envient et qu’elle a du mal à assu- mer, à prolonger, à moins que… qui sait ? Faute de quoi, Santa Barbara s’étale (…) partout où des étrangers comme vous et moi essaient de survi- vre, errants inauthentiques mais à la recherche d’on ne sait quelle vérité (…) dans ce polar généralisé qu’est le spectacle dénommé encore – mais jusqu’à quand ? – une “société”. » Ce serait une gageure de résumer ce récit ambitieux où tous les gen- res sont convoqués : thriller méta- physique, autobiographie, satire politique et sociale, amour cour- tois… D’autant qu’au-delà du jeu narratif tenu par un style fluide, Julia Kristeva reprend les thèmes qui lui sont chers : l’étrangeté – « il n’y a pas d’étrangers heureux » –, la maternité, les rapports hommes/femmes… Et, dans un esprit digne de la Renaissance, elle embrasse tous les savoirs pour donner à voir et à com- prendre l’envers de ce « polar géné- ralisé » qui est le nôtre. Au risque du roman total, Julia Kristeva offre un livre stimulant et jubilatoire. En un mot, un grand roman byzantin. (1) Tous chez Fayard, repris en « Folio » et au Livre de poche. (2) « Folio essais », n o 156. e Signalons aussi Sur les traces des croisades, photographies et texte de Charles Henneghien (La Renaissance du Livre, 192 p., 49,50 ¤). LIVRES DE POCHE APARTÉ Ardente et abandonnée ESSAIS W. G. Sebald. Une biographie de Joseph Roth. Gregor von Rezzori. Anton Kuh. pages III et IV VOUS POUVEZ tout faire, pen- ser ou croire, posséder toute la science du monde, si vous n’aimez pas, vous n’êtes rien. Ce n’est déjà pas très facile d’enten- dre l’injonction de saint Paul : il y a tant d’atermoiements, de rai- sons qui s’opposent, retardent, relativisent… Et puis, qu’appel- le-t-on « aimer » ? Mais déjà il faut aller plus loin, ou plutôt pousser l’affirmation jusqu’à ses dernières conséquences. Dans la première élégie de Duino, Rainer Maria Rilke exalte les amoureu- ses « abandonnées », « tellement plus aimantes que les satisfai- tes ». Et plus loin : « N’est-il pas temps qu’aimant nous nous déta- chions de ce que nous aimons et l’emportions tremblants ? » Un court récit ardent et mira- culeux – il aurait pu ne jamais exister, ou rester secret –, écrit durant l’hiver 1930, donne à entendre la voix de l’une de ces sublimes délaissées, Marcelle Sauvageot (1). Mais surtout Com- mentaire (titre que lui donna l’auteur) est l’admirable démons- tration que l’amour est une connaissance qui conduit l’amoureuse, ou l’amoureux, au-delà de lui-même et de l’ob- jet de son sentiment. Patrick Kéchichian Lire la suite page VIII (1) Laissez-moi (Commentaire), de Marcelle Sauvageot, Phébus, 126 p., 10 ¤. Julia Kristeva, la Byzantine A la fois polar, récit historique et autobiographique, « Meurtre uploads/Litterature/ sup-livres-040205 1 .pdf
Documents similaires


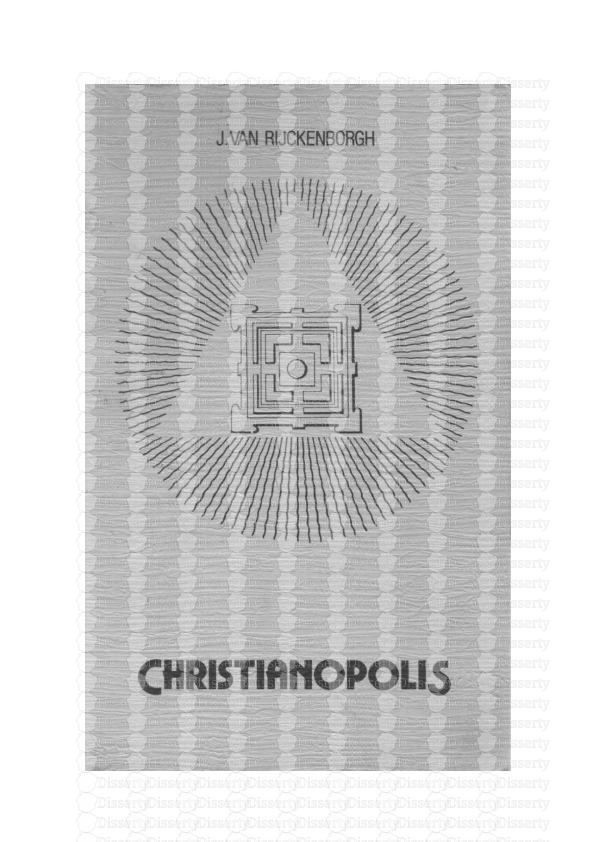







-
91
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 27, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 2.1544MB


