Traductions de la Bible en français 1 Traductions de la Bible en français L'art
Traductions de la Bible en français 1 Traductions de la Bible en français L'article ne retient que les traductions de la Bible en français complètes. Avant l'imprimerie • 1226-1250, traduction de Jean Le Bon de l'Université de Paris Inachevée et poursuivie au XIVe siècle par Jean de Sy et les Dominicains, Jehan Nicolas, Guillaume Vivien, et Jehan de Chambly. • 1297 la Bible historiale de Guyart Desmoulins ou Guyart des Moulins Traduction et compilation des Histoires scholastiques de Pierre le Mangeur, la plus grande partie de la Bible (d'une traduction libérale), et un assemblage de gloses et d'autres matériaux de plusieurs sources. Le contenu des manuscrits est variable, et des versions successives semblent y ajouter des livres de la Bible qui manquaient à la traduction de Guyart. • 1377, Bible de Charles V Traduction de Raoul de Presles dédiée au roi Charles V Après l'imprimerie Traductions du XVe siècle 1476, le Nouveau Testament Imprimé par Le Roy, Guillaume; traduit à partir de la Vulgate latine: Pierre Farget (éditeur) et Julien Macho (éditeur) (trad. Guyart des Moulins), Nouveau Testament, Lyon, Buyer, Barthélemy (libraire), 1476, [304] f. non signés. p. 1487, la Bible de Jean de Rély Imprimée pour la première fois à Paris et rééditée au moins dix fois dans les cinquante années qui suivirent. Il s'agit d'une Bible historiée, comme il est écrit au folio 353, éditée à partir d'un manuscrit tardif de la Bible historiale de Guyart des Moulins ou Desmoulins. Traductions du XVIe siècle • 1523, Nouveau Testament de Jacques Lefèvre d'Étaples • 1528, Ancien Testament de Jacques Lefèvre d'Étaples. À partir de la Vulgate, imprimé à Anvers 1530, 1534, 1541. Révisée par Nicolas de Leuze (Anvers, 1548). Il s'agit de la première traduction intégrale des écritures hébraïques en français. • 1535, Bible d'Olivétan : première traduction réalisée à partir des textes originaux hébreu et grec. Il introduit le mot Éternel pour rendre le tétragramme. Pierre Robert, dit Olivétan, est probablement un cousin de Jean Calvin, qui préface en latin l'ouvrage. La traduction est accompagnée de nombreuses notes d'érudition. Le Nouveau Testament suit le texte grec « majoritaire » compilé par Erasme de Rotterdam. • 1551, Bible en latin et 1555 en français de Sebastian Castellion : à partir de l'hébreu et du grec. Traduction condamnée par Jean Calvin. • 1560, Bible de Genève de Jean Calvin : en suivant la Bible d'Olivétan. • 1588, Révision de la Bible de Genève (Bible de « l'Epée ») par Théodore de Bèze et Corneille Bertram. Traductions de la Bible en français 2 • 1550‑1608, La Bible de Louvain : révision de la bible de Lefebvre d'Étaples suspectée d'hérésie. • 1566, traduction de René Benoist : à partir de la Vulgate (Paris). Suspectée de calvinisme, elle soulève de nombreuses controverses. Traduction du XVIIe siècle • 1667, Nouveau Testament d'Antoine et Isaac Lemaître de Sacy "Selon l'édition Vulgate, avec différences du grec" ; les différences sont décrites dans d'abondantes notes marginales. Imprimé à Amsterdam sous le nom de Gaspard Migeot libraire à Mons. • 1696, Traduction effectuée à l'abbaye de Port-Royal de Paris (abbaye janséniste), édition élaborée entre 1657 et 1696. Blaise Pascal, et des écrivains influents tels que Robert Arnauld d'Andilly, Pierre Nicole, Pierre Thomas du Fossé, sous la férule du maître d'œuvre Louis-Isaac Lemaître de Sacy ont participé à la traduction de la Bible, traduction dite de Port-Royal (voir Logique de Port-Royal pour l'influence sur la syntaxe et la grammaire de la langue française). • 1696, Le Nouveau Testament de David Martin : révision de la Bible de Genève accompagnée de notes. Traductions du XVIIIe siècle • 1702, Nouveau Testament de Richard Simon, oratorien qui a consacré sa vie à de nombreux travaux d’exégèse et de recherche critique sur le texte de la Bible. Il pratiquait le grec, l’hébreu, l’araméen (langue du Christ), connaissait les méthodes d’exégèse traditionnelle du judaïsme. • 1707, La Sainte Bible de David Martin : révision de la Bible de Genève accompagnée de notes. En ligne sur Martin 1707 [1] • 1707-1726, La Sainte Bible de Augustin Calmet : commentaire littéral sur tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament ; 1707 : la Genèse, 1726 : l'Apocalypse. • 1741, Bible de Charles de Cène, pasteur réfugié aux Provinces-Uies, • 1744, Révision de Jean-Frédéric Ostervald de la Bible de Genève. • 1744, Révision de la version de David Martin par le pasteur Pierre Roques Traductions du XIXe siècle • 1820‑1824, Sainte Bible (traduction nouvelle), par Antoine Eugène Genoud (dit l'abbé de Genoude), Paris, Imprimerie royale. • 1831‑1851, La Bible, Traduction Nouvelle par Samuel Cahen : Bible juive, édition bilingue hébreu et français. • 1843, Sainte Bible de Jean Jacques Bourassé et Pierre Désiré Janvier, appelée aussi Bible de Tours traduite à partir de la Vulgate. Éditée en 1866 en version de luxe illustrée par Gustave Doré, ré-éditée en 1985 chez Jean de Bonnot. • 1847, Ancien Testament, H.-A. Perret-Gentil : en 2 vol., d'après le texte hébreu • 1855, Révision de La Sainte Bible de David Martin • 1859, La Sainte Bible de John Nelson Darby (à l'origine de la doctrine du dispensationalisme) : à partir du grec et de l'hébreu. J.N. Darby a également traduit la Bible en anglais et en allemand. Elle fait partie des Bibles en français dont le texte est actuellement dans le domaine public. Très littérale[2]. • 1860, Ancien Testament de Lazare Wogue : avec la collaboration de Ben Baruk de Crehange, ou B. Mosse d'Avignon. • 1872, le Nouveau Testament de Jean-Hugues Oltramare : qui présente la particularité de donner dans ses notes toutes variantes de l'édition grecque Nestlé-Alland et de les soupeser. Traductions de la Bible en français 3 • 1872, l'Ancien Testament par Pierre Giguet : traduction d'après la Septante. • 1873, La Sainte Bible par Jean Baptiste Glaire, commentaires de F. Vigouroux : traduction d'après la Vulgate, ré-éditée en 2002 aux éditions DFT. • 1874, L'Ancien Testament de Louis Segond. Traduction précise[2]. • 1877, Le Nouveau Testament selon la Vulgate : traduit en français avec des notes par l'abbé Jean Baptiste Glaire, P. Didot. • 1880, Le Nouveau Testament et La Bible de Louis Segond : cette version originelle est devenue introuvable puisqu'elle a subi une révision en 1910 (après le décès de Louis Segond). La nouvelle version (Segond-1910) a été (et continue d'être) la plus largement utilisée par les protestants francophones[2]. Elle fait partie des Bibles en français dont le texte est actuellement dans le domaine public. • 1881, Bible de Reus de Edouard Antoine Reus, traduction inspirée des traductions allemandes. • 1881, Sainte Bible d'Antoine Arnaud à partir de la Vulgate destinée aux séminaristes. • 1885, Ancien Testament de John Nelson Darby (à l'origine du dispensationalisme) : à partir de l'hébreu et sans prétention scientifique mais avec le souci de rendre la langue originale le plus littéralement possible[3]. • 1886‑1896, Bible rationaliste par Eugène Ledrain : d'après les textes hébreu et grec, Paris. • 1887, Les Saints Évangiles, traduction nouvelle : par Henri Lasserre. Revêtue de l'imprimatur. • 1899 L'ancien et le nouveau Testament avec une traduction française en forme de paraphrase par le R.P. de Carrières et les commentaires de Ménochius de la Compagnie de Jésus, Onzième édition, Lille, Edition A. Taffin-Lefort ; Paris, Éditions Roger et F. Chernoviz ; Édition X. Rondelet et Cie. • 1900, La Bible annotée Traduction et commentaire de l'Ancien Testament ; ouvrage collectif par une équipe de théologiens de Neuchâtel, sous la direction de Frédéric Godet (traduction de Félix Bovet). Traductions du XXe siècle • 1902, La Bible du Rabbinat de Zadoc Kahn : avec de nombreux collaborateurs. Éditée en bilingue hébreu–français. • 1904, La Bible Fillion de Louis Claude Fillion : Primitivement destinée aux séminaristes. « Fillion s’en tient à une lecture traditionnelle des textes bibliques. Il utilise un langage précis et sans ostentation, ce qui constitue un avantage certain[2]. » • 1904, La Bible du chanoine Augustin Crampon : « L'abbé Crampon conserva la transcription Jéhovah du tétragramme YHWH Il essaye de préserver « une exactitude savante et minutieuse qui reproduise jusqu’aux nuances[2]. ». L'édition originale comportait six tomes avec le texte latin de la Vulgate en regard de sa traduction française. Une version en un seul volume (sans le texte latin), destinée à un large public, fut publiée dès 1904 et rencontra un grand succès auprès des catholiques jusqu'en 1950 (le but poursuivi était de concurrencer la Bible du protestant Louis Segond). • Cette Bible en un volume fut entièrement recomposée typographiquement (l'imprimerie ayant été détruite durant la première guerre mondiale) et par la même occasion corrigée et légèrement révisée, ceci en 1923. Le nom de Dieu Jéhovah est remplacé par Yahweh dans cette nouvelle édition améliorée. C'est cette édition de 1923 qui fut rééditée en 1989 par les Éditions DFT (Argentré-du-Plessis) qui la maintiennent toujours en disponibilité (plusieurs retirages). • 1910, version synodale de la Société biblique française (fondée en 1818). • 1910, "La Sainte Bible", actuellement considérée comme la "Bible Segond", en fait une révision réalisée après la mort de Louis Segond. uploads/Litterature/ traductions-de-la-bible-en-francais.pdf
Documents similaires
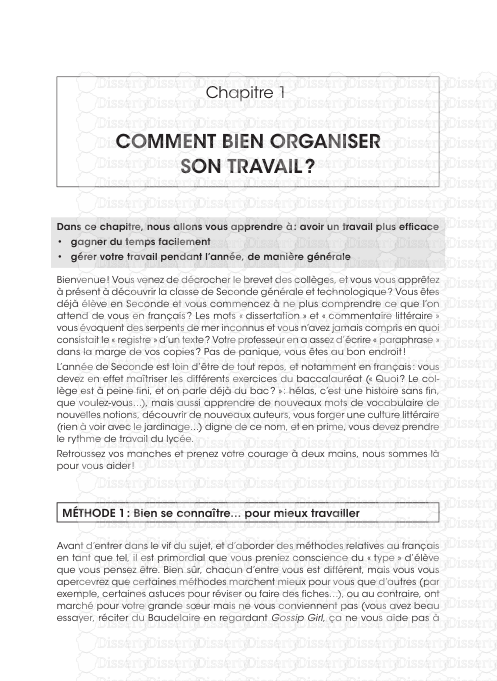









-
137
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 17, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2075MB


