Littérature française au XVIIe siècle La littérature française du XVIIe siècle
Littérature française au XVIIe siècle La littérature française du XVIIe siècle est liée aux multiples évolutions politiques, intellectuelles et artistiques. Il y a trop de mouvements entre 1598 et 1715, date de la mort de Louis XIV, le Roi-Soleil qui a imposé la monarchie absolue au royaume. L’un des faits dominants dans le domaine culturel est la forte consolidation du pouvoir royal. Une nouvelle vie se façonne autour de la Cour de Versailles. On voit l’émergence des maîtres du bon goût et l’apparition de la bourgeoisie qui commence à jouer un rôle dans le domaine des arts et de la littérature avec une diffusion plus large des œuvres et un développement de la lecture. Le XVIIe siècle est un siècle majeur pour la langue et la littérature française en particulier pour les œuvres du théâtre classique avec les comédies de Molière et les tragédies de Corneille et Racine, ou pour la poésie avec Malherbe. Le classicisme s’impose dans la seconde moitié du siècle sous le règne de Louis XIV. Il y a des chefs-d’œuvre comme les textes des moralistes et des fabulistes. Le genre du roman s’invente au cours de cette période avec les romans précieux. C’est le début des histoires comiques et des premiers romans psychologiques comme la Princesse de Clèves, ou encore de la poésie baroque de la période Louis XIII. Histoire : Pour la France, le XVIIe siècle en tant qu’unité historique peut être défini par deux dates : 1598 et l’édit de Nantes d’Henri IV qui met fin aux guerres de religion du XVIe siècle, et 1715, date de la mort de Louis XIV qui a imposé au cours de son très long règne la monarchie absolue au royaume qu’il a agrandi par de nombreuses conquêtes. Entre ces deux dates le pouvoir royal s’affermit par l’œuvre de Louis XIII secondé par Richelieu et durant la régence d’Anne d’Autriche grâce à Mazarin. Ce pouvoir royal intervient dans le monde des arts par le soutien qu’il apporte aux artistes instituant ainsi ce qu’on a appelé le « classicisme français » et par la création en 1635 de l’Académie française qui établit une norme pour le vocabulaire, la syntaxe ou la poétique comme le montre en 1637 la querelle du Cid. Ce souci de la codification du langage anime aussi les salons et les cercles littéraires : c’est par exemple la Grammaire de Port-Royal, élaborée par les Solitaires de Port-Royal des Champs, qui fixe pour la première fois les règles grammaticales et sert de base, jusqu’à nos jours, à la grammaire française. Si le XVIe siècle s’était occupé d’enrichir la langue française pour la rendre rivale des autres langues anciennes et si les auteurs accueillaient volontiers toute invention, le XVIIe siècle se charge de l’épurer et d’établir des règles comme avec Vaugelas. C’est à la fin du XVIIe siècle qu’apparaissent les premiers dictionnaires de la langue française avec Richelet (en 1680), Furetière (posthume, en 1690) et un peu plus tard l’Académie française (1698). En même temps, l’idéal social évolue avec le type de l’honnête homme, cultivé, sociable et ouvert, et le monde des idées poursuit son évolution avec le cartésianisme qui modifie les démarches intellectuelles en donnant une place primordiale à la Raison (Cogito ergo sum) et qui influera sur l’idéal classique par son souci d’ordre et de discipline. La philosophie de René Descartes (1596-1650), en érigeant le doute comme principe de son système métaphysique, débouchera à la fin du siècle sur les prémices des Lumières avec les remises en cause d’esprits novateurs comme Bayle ou Fontenelle en même temps que s’affirmeront, en Europe, les démarches scientifiques avec Kepler, Harvey, Blaise Pascal ou Newton. Le libertinage intellectuel, bien que sévèrement combattu par l’Église, pèse aussi peu à peu sur les esprits dans le sillage de Pierre Gassendi (1592-1655), matérialiste sensualiste qui ouvre des brèches encore timides à l’athéisme. En effet les considérations et les pratiques religieuses marquent aussi fortement le siècle avec la révocation de l’édit de Nantes par Louis XIV en 1685, qui met fin à la tolérance vis-à-vis des protestants, et le poids des Jésuites et des Jansénistes. La codification du langage : En relation avec les salons et les cercles littéraires, commence très tôt un mouvement de codification du langage. L’Académie française se propose de codifier le vocabulaire, la syntaxe, la poétique. Bien que la culture subisse les conséquences du centralisme politique, à la fin de la période commence à se sentir la contestation de l’imitation des Anciens et en même temps apparaissent une volonté de modernité et un désir qui tient davantage compte de l’évolution historique. Les courants : Les deux courants qui dominent le siècle sont le baroque et le classicisme. Le baroque domine l’Europe du XVIIe siècle. Peu agressif en France, il se développe sous l’influence avant tout de l’Italie, et représente souvent la tendance principale des années 1598 - 1630. Le baroque naît en réaction à l’austérité protestante. Il s'attache à une conception d’un monde instable, d’un monde en transformation incessante. Ce courant est avide de liberté et ouvert à la complexité de la vie. En littérature il comporte une multitude de tendances contradictoires mais peut se concentrer autour de quelques principes communs : goût de la sensualité, des extrêmes, de l’ornementation, du langage à effets. Le courant précieux ou la préciosité est un courant esthétique d’affirmation aristocratique marqué par un désir de se distinguer du commun. Cette volonté d’élégance et de raffinement se manifeste dans le domaine du comportement, des manières, du goût aussi bien que dans celui du langage. La société précieuse s’épanouit dans les salons dont les plus célèbres sont ceux de la marquise de Rambouillet et de Madeleine de Scudéry. D’abord aristocratiques, ces salons s’ouvrent peu à peu à des écrivains bourgeois après l’échec de la Fronde. La volonté d’élégance dans la conversation, la recherche de pureté du vocabulaire en proscrivant les jargons, les archaïsmes, le langage populaire et l’invention de termes nouveaux ou de périphrase remplaçant des noms d’objets réputés bas ou seulement trop ordinaires, conduisent à des abus dont se moquera Molière dans Les Précieuses ridicules. La littérature romanesque est un des sujets privilégiés de ces salons et les auteurs transposent dans leurs romans-fleuves ce monde raffiné qui revendique aussi une place centrale pour l’amour idéalisé. Avec précaution, on peut repérer une évolution du genre romanesque lié à cette esthétique particulière avec d’abord, au début du siècle, le roman pastoral et sentimental d’Honoré d'Urfé, L'Astrée, en 1607, puis les romans héroïques dont les traits communs sont la peinture des mœurs aristocratiques, les nombreuses aventures et l’étude des personnages en particulier dans la relation amoureuse. Le libertinage est un courant idéologique. Les libertins se détachent de la religion officielle, raillent les pratiques religieuses, manifestent leur indépendance de pensée et tendent à donner à l’existence humaine un sens uniquement terrestre. Ce courant assure ainsi la transition entre l’humanisme de la Renaissance et la philosophie du siècle suivant, celui des Lumières. Le registre comique et satirique : Le registre satirique et familier qui caractérise certaines œuvres narratives du XVIIe siècle est l’héritier d’un certain esprit « gaulois » présent dans les nouvelles du siècle qui cherchent à s’ancrer dans le réel pour créer à la fois le rire et la mise en cause. Influencé par le roman picaresque espagnol, ce courant non aristocratique est aussi produit par la réaction contre les excès idéalistes et sentimentaux des romans héroïco-précieux dont se moquent les auteurs satiriques avec des sortes de parodies comiques. Le classicisme Le classicisme, une des époques culturelles les plus brillantes de l’histoire de la France, est une expression idéologique et esthétique de la monarchie absolue. Il se développe pendant toute la première partie du siècle et atteint son apogée vers les années soixante. Le classicisme est en liaison étroite avec les courants philosophiques de l’époque, en premier lieu celui du rationalisme de Descartes dont il subit l’influence. Esthétique classique s’est élaborée au cours des années 1630-1660. Elle est fondée sur trois principes essentiels : rationalisme, imitation de la nature, imitation de l’Antiquité. Plus tard, en 1674, dans son Art poétique Nicolas Boileau fait une synthèse de tout ce qui constitue le style classique. Le classicisme établit la suprématie de la raison qui s’exerce par des règles. Peindre le beau et le vrai demeure la grande préoccupation des écrivains. Mais comme les créateurs s’adressent à un public précis, la Cour, l’idéal est d’inspirer le respect du régime royal, le beau est ce qui est conforme à la morale chrétienne. Pour eux, peindre le vrai c’est peindre la nature humaine, peindre l’homme. La peinture des passions humaines, leur analyse, confèrent un caractère psychologique à la littérature classique. Le classicisme répugne à introduire le laid, le bizarre, le fantastique et réduit par là son domaine d’observation. Le beau seul devait être imitable. Pour leur imitation les écrivains ont besoin de modèles et de maîtres. Pour eux ce sont les Anciens. Et là, tous les grands classiques sont solidaires, tous affirment la nécessité de s’inspirer de leur exemple, de suivre leurs préceptes uploads/Litterature/ tuem-dosyalar 1 .pdf
Documents similaires







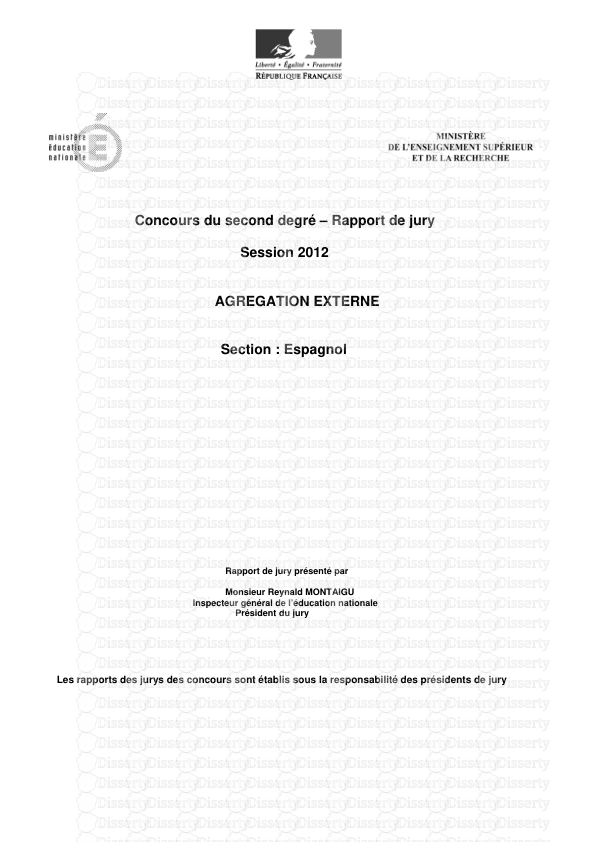


-
43
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 07, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.5985MB


