LITTÉRATURE AFRICAINE littérature d'un pays du continent africain La littératur
LITTÉRATURE AFRICAINE littérature d'un pays du continent africain La littérature africaine remonte à la plus haute Antiquité avec les écrits de l'Égypte antique, 4500 ans environ avant le présent. Les épopées, les histoires et les contes traditionnels témoignent d'une importante tradition orale (aussi apte à la description du monde, à l'expression de soi, à la persuasion d'autrui, etc.), répandue à travers le continent, tandis que le patrimoine littéraire écrit se développe considérablement au xxe siècle. Les langues anglaise, française et portugaise, héritées de la colonisation, ou la langue arabe répandue en Afrique du Nord, sont couramment employées par les écrivains africains, mais la littérature écrite en langues africaines s'affirme peu à peu. Littératures antiques en Afrique Scène de Livre des morts des Anciens Égyptiens. Inscriptions coptes et arabes dans une église du Vieux Caire. Stèle montrant l'alphabet phénicien, Tophet de Carthage, Tunisie. Littérature de l'Égypte antique Article détaillé : Littérature de l'Égypte antique. La littérature de l'Égypte antique, en égyptien ancien, avec écriture hiéroglyphique, pendant au moins deux millénaires, de l'époque pharaonique jusqu'à la fin de la domination romaine. Aujourd'hui, cette langue survit avec la langue copte, qui est restée la langue liturgique de l'Église copte. Ainsi, la littérature égyptophone d'Afrique du Nord est-elle, après la littérature sumérienne de Mésopotamie, la plus ancienne du monde. La pierre de Rosette est la clé de la redécouverte de l'égyptien ancien, dont la connaissance était perdue depuis la fin de l'époque romaine. Il s'agit d'un fragment de stèle en granodiorite qui montre le même texte en hiéroglyphes, en écriture démotique et en alphabet grec. Découverte en 1799, pendant la campagne d'Égypte de Bonaparte, elle est traduite en 1822 par le français Jean-François Champollion. Parmi les œuvres les plus connues, se trouvent le livre des morts des Anciens Égyptiens, les Textes des pyramides, et le livre de la vache du ciel. En général ces livres sont écrits en scripte hiéroglyphique ou hiératique sur des rouleaux de papyrus, ou bien gravés en scripte hiéroglyphique sur des murs de pierre dans les monuments d'Égypte. Littérature copte, philosophie copte (en), coptologie, alphabet copte Littératures phénicienne, grecque et latine La civilisation carthaginoise fut un grand empire à l’emplacement de la Tunisie actuelle. Sa littérature disparait après les guerres puniques, avec la destruction des bibliothèques de Carthage. Cette littérature s'écrivait en phénicien et en grec ancien. Les auteurs les plus connus sont les tardifs Diogène Laërce et Clitomaque de Carthage, ou encore Sanchoniathon, selon Philon de Byblos : Littérature phénicio- punique (es)[1]. La Cyrénaïque antique (Est de la Libye) est longtemps colonisée par des cités grecques : Cyrène fondée en -630 par des colons de Théra (Santorin), Barkè, Taucheira (Arsinoé, aujourd'hui Tokra), Barca (Ptolémaïs), et enfin Euhespérides (Béréniké, aujourd'hui Benghazi) : Libye antique Pendant la dynastie lagide (dite dynastie des Ptolémées), alors que l'Égypte est une colonie grecque, la bibliothèque d'Alexandrie devient la plus célèbre bibliothèque de l'Antiquité. Selon Ibn Khaldoun, Amr ibn al-As détruit cette bibliothèque en 642 sur l'ordre du calife Omar ibn al-Khattâb[2]. Après les guerres puniques, Rome est le pouvoir principal en Afrique du Nord. L'Afrique romaine produit de nombreuses œuvres littéraires en latin. Parmi les auteurs d'expression latine les plus connus, figurent Térence, Apulée, Florus, Tertullien, Sulpice Apollinaire, Nonius Marcellus, ainsi que des grammairiens comme Terentianus dit le Maure, Fronton, Marius Victorinus ou Atilius Fortunatianus. Le philosophe et théologien Augustin d'Hippone, auteur des Confessions, était aussi un auteur latino-berbère. Il se définit lui-même comme un écrivain punique[3], mais la langue maternelle de ce Père de l’Église catholique était probablement le latin. Pendant le Moyen Âge, les universités musulmanes collectionnent, protègent et traduisent en arabe de nombreux textes grecs et latins. Sans cette préservation en Afrique, puis la transmission, il est probable que plusieurs œuvres auraient disparu. Littérature latine d'Afrique romaine, Littérature byzantine Âge d'or de l'Islam, Traductions arabes du IXe siècle Traductions latines du XIIe siècle, Renaissance du XIIe siècle, Renaissances médiévales Science et technologie byzantines, Apports byzantins à la Renaissance italienne Littérature en amharique Bible éthiopienne du xxe siècle. Article détaillé : Littérature éthiopienne. L'Éthiopie possède une très ancienne tradition littéraire, utilisant le système d'écriture guèze, remontant à son époque axoumite. La littérature ancienne, dominée par l'enseignement religieux, est essentiellement morale dans son contenu. La littérature amharique commence à se développer vers le xiiie siècle, au cours de la dynastie Zagwe. On peut distinguer trois périodes majeures dans le développement de la littérature amharique moderne du xxe siècle ; la période de l'occupation italienne (1935-1941), la période post-indépendance (1941- 1974) et la période post-révolutionnaire (1974-aujourd'hui)[4]. La philosophie écrite éthiopienne s'étend sur douze siècles de production littéraire[5]. Elle connait une période de traduction littéraire, dominée par Le Fisalgwos (Le Physiologue) et Biä’afä Mikael (Le Livre des philosophes). Littérature en berbère Article détaillé : Littérature berbère. Écritures tifinaghs anciennes près d'Essouk au Mali. Il existe plusieurs langues berbères. La famille des langues berbères comprend les langues suivantes : tamazight, chleuh, kabyle, rifain, chaoui, chenoui et d'autres. Elles s'implantent principalement au Maroc, en Algérie, au Mali et au Niger. Le touareg (langues touarègues), une langue berbère du Sahara s'écrit avec l'alphabet ⵜⵉⵊⵉⵏⴰⵗ tifinagh depuis le iiie siècle av. J.-C. qui est l'une des plus anciennes écriture de l'Afrique, elle utilise aussi l'abjad arabe depuis l'époque médiévale et l'alphabet latin est aujourd'hui officiel au Mali et au Niger. Depuis les années 1960, il existe enfin une écriture néo-tifinagh, ainsi que d'autres propositions de modernisation. Pendant le Printemps berbère (Tafsut Imazighen) de mars 1980, plusieurs berbérophones en Kabylie et à Alger manifestent pour l'officialisation de la langue tamazight en Algérie. En 2002, ils réussissent. Au xxe siècle, on constate une renaissance de la littérature berbérophone[6]. Littérature en arabe Ibn Battûta, un explorateur berbère célèbre pour ses récits de voyages. Article détaillé : Littérature de langue arabe. La conquête musulmane de l'Égypte et du Maghreb, à partir des années 600, entraîne une diffusion de la langue arabe en Afrique. Les centres de scolarisation les plus importants sont, à l'époque, au Caire et à Alexandrie, en Égypte, ainsi qu'à Tombouctou au Mali, où se trouve l'ancienne université Sankoré. Même aujourd'hui on estime qu'il y aurait au moins 300 000 manuscrits cachés dans les bibliothèques et les collections privées à Tombouctou, dont la plupart en arabe, avec quelques manuscrits en peul et en songhaï[7]. Parmi les écrivains d'expression arabe, les plus célèbres sont l'explorateur médiéval berbère Ibn Battûta et l'historien Ibn Khaldoun. Pour l'époque contemporaine, Naguib Mahfouz, d'expression arabe, reçoit le prix Nobel de littérature en 1988[8]. Listes d'écrivains égyptiens, syriens, tunisiens, algériens, marocains, mauritaniens, soudanais, somalis, Littérature musulmane Âge d'or de l'Islam, Sciences arabes, Scientifiques arabo-musulmans Littératures orales et écrites subsahariennes La littérature orale Griot (1910) avec un xalam. Articles connexes : Griot, Mvett, Orature, Épopée bambara de Ségou, Geste de Ham-Boɗeejo, Fumo Liyongo et Épopée de Silâmaka et Poullôri. En Afrique de l'Ouest, la littérature est souvent orale et transmise par les griots. Le récit est accompagné de musique[9]. Les griots suivent une formation spécialisée et parlent des langues nigéro-congolaises. Cette littérature orale est en prose ou sous forme de poésies. La prose est souvent mythologique ou historique dans son contenu. La poésie, souvent chantée, prend la forme de l'épopée narrative, de la poésie rituelle, des épigrammes, des proverbes, des énigmes. La poésie peut être adressée aux rois et autres dirigeants, et il existe une tradition de chansons d'amour ou de travail[9],[10]. Parmi les œuvres principales se trouve l'Épopée de Soundiata, relative à Soundiata Keïta (1190-1255), empereur du Mali. À côté de l'épopée Mandingue, il existe d'autres genres d'épopées. On trouve par exemple chez les Fangs d'Afrique Centrale l'épopée du Mvett, un récit en plusieurs épisodes, qui voit s'opposer deux peuples, celui des mortels d'Oku et les immortels d'Engong. Cette culture orale trouve des prolongements dans l'écrit. Pour l'aire francophone, l'un des fondateurs de la négritude, Léopold Sédar Senghor, se déclare explicitement inspiré par la poésie orale de son pays et, pour une période plus récente, d'autres écrivains revendiqueront cette filiation, tel Jean-Marie Adiaffi, dans les années 1980[11]. La littérature écrite Au xxe siècle, Solomana Kante invente le n'ko pour transcrire les langues mandingues. Il écrit une Méthode pratique d'écriture n'ko et un Traité de sciences en n'ko, vers 1960. En plus de l’ajami (écriture arabe) et des alphabets dérivés de l’alphabet latin, l’Afrique possède ainsi plusieurs écritures qui lui sont propres : bamoun, mandombe, alphabet n’ko, tifinaghs (écriture des touareg, également subsahariens), vaï, winanckôkrousè… Esclavage et colonialisme L'esclavage en Afrique est ancien, et se développe avec les réseaux commerciaux non-africains et l'introduction de langues (et cultures) non africaines. Le partage de l'Afrique (1880-1910) entre les diverses puissances coloniales occidentales impose l'usage de langues occidentales (allemand, anglais, espagnol, français, portugais, etc.), du moins dans les relations commerciales et administratives : anglophonie, francophonie, hispanophonie, lusophonie, etc. Littérature en français [12]Pour le lecteur francophone, il s'agit du premier aspect de la littérature africaine accessible, en dehors des traductions. La littérature francophone est la littérature d'expression française née pendant la colonisation française dans divers pays d'Afrique, au Maghreb dès la première moitié uploads/Litterature/litterature-africaine.pdf
Documents similaires








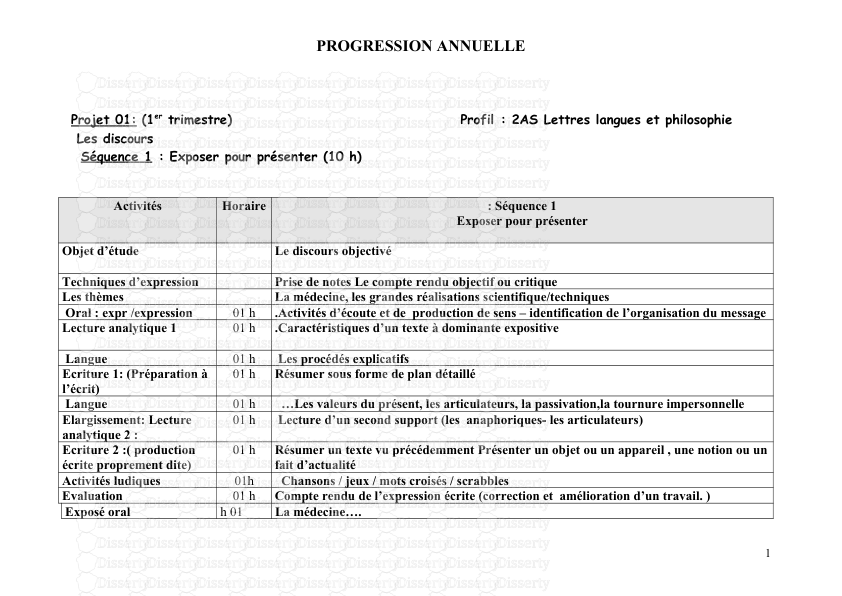

-
40
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 10, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0865MB


