10 / 06 / 2014 Page 1 sur 43 M2OS / IMdR I M d R Groupe de travail Management,
10 / 06 / 2014 Page 1 sur 43 M2OS / IMdR I M d R Groupe de travail Management, Méthodes, Outils, Standards (M2OS) Fiches méthodes 10 / 06 / 2014 Page 2 sur 43 M2OS / IMdR INTRODUCTION Depuis son origine à l’ISdF (Institut de Sûreté de Fonctionnement *1 ) puis à l’IMdR (Institut de Maîtrise des Risques) le groupe de travail M2OS (Management, Méthodes Outils, Standards) fort d’une vingtaine de membres s’est donné pour tâche de publier des ouvrages destinés à servir de références aux personnes soucieuses de Sûreté de Fonctionnement et de Maîtrise des risques. Ceux–ci peuvent être débutants afin les aider à démarrer dans le métier ou plus chevronnés pour se rappeler tels ou tels éléments techniques. Dans la lignée des ouvrages qu’il a élaborés, M2OS propose ici au lecteur un ensemble de fiches méthodes. Cet ensemble ne se veut pas figer mais évolutif en fonction de son enrichissement, en nombre de fiches, ajout d’annexes (exemples…). Pour ce faire, il vous invite à y participer, un modèle de fiche vierge éditable est disponible sur le site de l’IMdR. Il vous est possible d’adresser tous commentaires sur l’existant, proposer de nouvelles fiches par le moyen de votre choix en l’adressant par courriel au coordinateur du projet : prlecler@club-internet.fr . Actuellement l’ensemble comprend les fiches suivantes: 1. Caractérisation du profil de vie d’un produit 2. Analyse Fonctionnelle (A.F.) 3. Blocs Diagrammes de Fiabilité (B.D.F.) – Reliability Block Diagram (R.B.D.) – 4. Allocation de fiabilité 5. Evaluations prévisionnelle de fiabilité 6. FIDES 7. Estimations de fiabilité à partir d’essais ou du retour d'expérience 8. Fiabilité Prévisionnelle en Mécanique 9. Fiabilité en Mécanique – la méthode Contrainte – Résistance 10. Choix et application des méthodes d’analyse de la SdF du logiciel Mise à jour 11. SdF du logiciel: Les normes Nouvelle 12. SdF du logiciel: Les moyens, outils et analyses Nouvelle 13. La démarche bayésienne en fiabilité 14. Analyse Préliminaire de Risques (A.P.R.) Nouvelle 15. Analyse des Modes de Défaillance et de leurs Effets (A.M.D.E.) – Failure Mode Effect Analysis (F.M.E.A.) – 16. Graphe d’état Arbre de défaillances, arbre d’événement, arbre de causes, ne confondons pas ! 17. Analyse par Arbre de Défaillances (A.A.D.) – Fault Tree Analysis (F.T.A.) – 18. Analyse par arbre d’événements (A.A.E.) 19. Analyse par arbre de causes 20. Arbres de Maintenance et d’Aptitude à la Maintenance 21. Etude de danger et d’exploitabilité – Hazard and Operational Study (HAZOP) 22. Analyse des Risques, PoInts Critiques pour leur Maîtrise (A.R.P.I.C.–M.) – Hazard Analysis Critical Control Point (H.A.C.C.P.) – 23. Analyse de zone 24. Maintenance Basée sur la Fiabilité (M.B.F.) – Reliability Centered Maintenance (R.C.M.) – 25. Intégration Conception et Soutien (I.C.S.) 26. Plans d’expériences 27. Essais accélérés de durée de vie 28. Essais aggravés 29. Epreuves de déverminage 30. Logique de Traitement des Incidents et Actions Correctives (L.T.I.–A.C.) 31. Coût de Cycle de Vie (C.C.V.), Coût Global de Possession (C.G.P.) Glossaire Mise à jour 10 / 06 / 2014 Page 3 sur 43 M2OS / IMdR * 1 – « SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT » et « DEPENDABILITY » Selon l'acception retenue en France (RG – AERO – 0040), la « Sûreté de Fonctionnement » (SdF) est l’ensemble des aptitudes d’un produit qui lui permettent de disposer des performances fonctionnelles spécifiées, au moment voulu, pendant la durée prévue, sans dommage pour lui-même et son environnement. La SdF se caractérise généralement par les quatre paramètres suivant : Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité, Sécurité. Dans certains cas, on peut y inclure d’autres paramètres tels que : Durée de vie, Survivabilité, Invulnérabilité. Les traductions les plus communes de « Sûreté de Fonctionnement » sont « R.A.M.S. » (Reliability, Availability, Maintainability, Safety », « Dependability », « Dependability and Safety ». Cependant aucune d'entre elles ne rend compte parfaitement de la définition ci-dessus. Dans la version française des fiches méthodologiques, nous avons retenu « Sûreté de Fonctionnement », alors que dans la version anglaise, c’est le terme « Dependability » accompagnés d'une (*) renvoyant à la présente note. * 2 – Certaines fiches mentionnent des références non rééditées mais dont le contenu reste d’actualité et non remplacées. * 3 – L’accès direct aux fiches s’effectue en cliquant sur la désignation dans le sommaire ci-dessus. Le retour au sommaire s’effectue en cliquant sur le titre dans la fiche. Présidents du groupe M2OS: J.M. Cloarec (Bombardier) et Y. Mortureux (UIC/SNCF), Coordinateur du projet: P. R. Leclercq (R.I.S.) Membres actifs de M2OS pour le projet: Mme M.M. Oudin–Darribère (IMdR), MM. Y. Castellani (ESTP/IMdR), J.M. Cloarec (Bombardier), A. Delage (IMdR), R. Grattard (Systra), T. Jalinaud(CEA), J. Lafont (ESTP/IMdR), P. Leclercq (R.I.S.), D. Merle (IMdR), P. Moreau (DGA), D. Morel (DGA), Y. Mortureux (UIC/SNCF), J. Ringler (Ringler Consultant), J. Riout (CETIM), G. Sabatier (LGM), M. Testylier (GMAO Services) 10 / 06 / 2014 Page 4 sur 43 M2OS / IMdR Caractérisation du profil de vie d’un produit Objectif (à quoi ça sert ?) Assurer la validité et la complétude de la spécification d’un nouveau produit vis-à-vis de son profil de vie réel et fournir les entrées permettant de déterminer les marges de fonctionnement optimales vis-à-vis des performances opérationnelles attendues. Description (que produit la méthode et comment ?) La caractérisation du profil de vie réel d’un nouveau produit consiste dans un premier temps à analyser de manière détaillée l’ensemble des situations que pourra rencontrer ce produit depuis sa sortie d’usine jusqu’à sa mise au rebut ou son recyclage. Elle consiste, dans son second temps, à identifier les conditions de fonctionnement du produit (marche, arrêt, stockage…) et les agents d’environnement associés, en nature et en niveaux, sur chacune des situations identifiées. Le résultat de ces analyses sera consigné sur des organigrammes et des tableaux de synthèses adéquats. Conduite de la méthode (comment la met-on en œuvre ?) La démarche de caractérisation du profil de vie d’un produit fait appel à la synergie de différentes compétences : spécificateurs, concepteurs, spécialistes de la sûreté de fonctionnement. Elle prend naissance au stade de la faisabilité du nouveau produit afin de valider la spécification et se poursuit au-delà, en conception, en production et en exploitation de manière à cerner de plus en plus finement le profil de vie élaboré initialement. Cette démarche se traduit par la mise au point d’un document « vivant » qui s’appuiera successivement sur les résultats d’analyse, les résultats d’essais et les mesures éventuelles sur le terrain. De manière à atteindre ses objectifs, la démarche de caractérisation du profil de vie nécessite un déroulement d’activités en six étapes successives : 1/ Etablissement du graphe d’états du profil de vie : définir en phase de faisabilité des « états globaux » du système appelés « segments » correspondant à des catégories d’usage bien déterminées du produit (ex : sortie d’usine, stockage, utilisation client…). Eclater ces segments en états intermédiaires appelés « phases » (ex : transport par fer, roulage d’un véhicule…), puis en « sous-phases » (ex : roulage urbain pour un véhicule), jusqu’à atteindre un niveau de décomposition auquel pourront être associés un environnement et une configuration donnée (ex : freinage urbain pour un véhicule). Ce niveau de décomposition ultime est appelé « situation ». Ces situations intègrent des incidents ou des conditions réputées exceptionnelles identifiés par les analyses de risques. Il en résulte un graphe d’états du profil de vie du produit traduisant l’arborescence de ce produit, depuis les « segments » jusqu’aux différentes « situations » identifiées, 2/ Etablissement du tableau des occurrences : en phase de conception définir des indicateurs permettant de quantifier les durées typiques et/ou extrêmes des segments, phases, sous-phases et situations mis en évidence sur le graphe d’états du profil de vie. Dans les cas fréquents où ces événements présentent un caractère récurrent, il convient de définir le nombre d’occurrences attendues des différents états identifiés du produit sur l’ensemble de son profil de vie. Le résultat se traduit par un « tableau des occurrences » (durées, nombre d’occurrences) des différents états identifiés du produit sur son profil de vie, 3/ Etablissement du tableau des agents d’environnement par situations : préciser la nature (mais pas encore les niveaux) de tous les agents d’environnement (naturels et induits) auxquels sera soumis le produit dans chacune des situations identifiées. Initiée en phase de conception, cette étape est réalisée en phase de développement avec la prise en compte des événements induits. Il en résulte un tableau indiquant, pour chaque situation, les agents d’environnement concernés. Les agents d’environnement sont regroupés par catégories : climatique (ex : chaud, froid, humidité…), mécanique (ex : vibrations, chocs), électrique et électromagnétique (ex : cycles marche/arrêt, interférences…), chimique… 4/ Etablissement des fiches de situation : caractériser aussi finement que possible chacune des situations identifiées sur le graphe d’états. Elle s’élabore dès la phase de faisabilité, se poursuit en développement avec la connaissance des solutions techniques et des environnements induits. Les agents d’environnement identifiés sont caractérisés, pour chaque situation, en terme de valeurs, de fréquences et de durées. Chaque fiche de situation, dont le format est à adapter à la nature du produit, à son profil de uploads/Management/ analyse-fonctionnel.pdf
Documents similaires




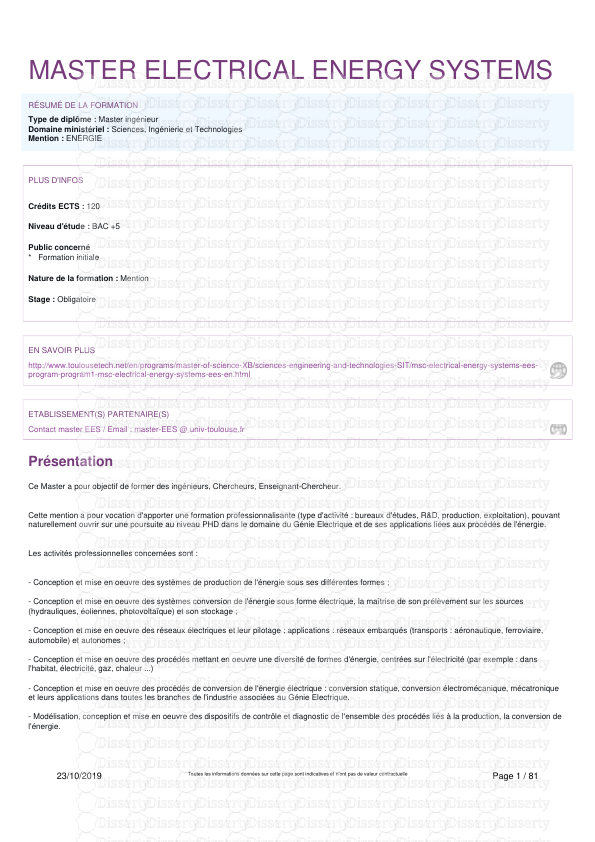





-
75
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 03, 2022
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 1.0807MB


