Points développés : Les enjeux de l’enseignement de l’oral Des objets d’enseign
Points développés : Les enjeux de l’enseignement de l’oral Des objets d’enseignement de l’oral Evaluer l’oral Journée du 5 décembre 2007 Education prioritaire et mise en œuvre du socle commun de compétences et de connaissances TITRE : ENSEIGNER L’ORAL 1 ère partie : Intervention de Madame Anne-Marie GARCON, IA-IPR, responsable du groupe de formation 1er degré - IUFM de Lorraine 1) Les enjeux de l’enseignement de l’oral : pourquoi faut-il « oser l’oral » ? Si les Instructions Officielles ont toujours fait de l’enseignement de l’oral une obligation, les dernières en date réaffirment fortement la nécessité de cet enseignement. a) L’enseignement de l’oral répond en grande partie à une demande sociale : - restaurer la civilité (politesse, respect) ; - réduire les risques de dérapages liés au langage (le langage support d’éducation citoyenne) ; - faciliter l’intégration des enfants issus de l’immigration ; - faciliter la communication intergénérationnelle (élèves/enseignants, enfants/adultes) ; - renforcer l’enseignement de savoirs lexicaux. Atelier enseigner l’oral page 1/6 b) Quelques arguments et thèses « discutables » - « Les élèves manquent de lexique. » à Le langage ne peut se limiter au vocabulaire. Parler, c’est notamment produire des types d’énoncés organisés. Les situations proposées doivent donc l’être en termes d’apprentissages langagiers. - « Inutile de penser une pédagogie de l’oral, puisqu’ apprendre à parler, c’est être capable d’imiter. » à Le moteur d’acquisition du langage, c’est l’interaction entre l’enfant et son environnement. L’étayage de l’adulte est donc une condition nécessaire à l’efficacité de l’apprentissage du langage. - « À l’école, l’enseignant représente le seul modèle langagier pour l’élève. » à Les échanges langagiers entre élèves sont eux aussi nécessaires à l’acquisition de la pensée de l’enfant. - « En classe, la leçon de langage est permanente puisque l’oral est très présent. » à Il est nécessaire d’inclure cette idée, mais il faut également la dépasser et penser réellement l’apprentissage du langage. c) Pourquoi faut-il « oser » l’oral ? À la question « Pourquoi faut-il oser l’oral ? », Jean-François HALTE répondait notamment : - que l’oral est le medium de la reconnaissance sociale ; - que les ¾ du temps scolaire sont des échanges de paroles, et que, de fait, c’est là que peut se jouer l’essentiel de l’apprentissage ; - qu’à l’oral, une activité langagière est en rapport avec une activité cognitive (les réponses de l’élève seront notamment fonction de sa compréhension de la demande) ; - que le déni de l’oral serait une erreur didactique majeure car à l’école, tout se développe à partir de l’oral (et notamment les différents types de langages) ; - que si les spécificités de l’oral ne se jouent pas au plan linguistique, c’est bien par la voix que passera l’oral, en opposition au geste graphique pour le langage écrit. De même, l’oral se déroule en temps réel, tandis qu’à l’écrit, les retouches sont possibles. Atelier enseigner l’oral page 2/6 d) Pourquoi est-il si difficile d’enseigner l’oral ? Le groupe de recherche de l’INRP, coordonné par Claudine GARCIA-DEBANC, a notamment mis en évidence qu’il est difficile d’enseigner l’oral pour des raisons multiples : - l’oral est une pratique transversale, d’où l’impression, parfois, que l’apprentissage de l’oral est effectif à tout moment dans la classe ; - l’oral implique l’ensemble de la personne (voix, corps, …) ; - l’oral est fortement marqué par les pratiques sociales de référence (l’orateur est en permanence évalué socialement par ses auditeurs) ; - l’oral est difficile à observer et à analyser, puisqu’il est difficile d’être observateur et acteur d’une situation. 2) Des objets d’enseignement de l’oral Plusieurs types d’oraux peuvent être distingués : - l’oral polygéré, dans le cadre d’un travail de groupe par exemple, est utile dans la vie citoyenne ; - l’oral monogéré (exposé) est une composante parmi d’autres de la réussite aux examens ; - la mise en voix d’un texte préexistant (récitation poétique) implique un travail d’acteur, qui est une composante de la communication orale. Ces types d’oraux répondent donc tous aux demandes institutionnelles. Nombre de situations qui les mettent en jeu sont d’ailleurs couramment présentes dans les classes. Cependant, l’équipe GARCIA-DEBANC met l’accent sur la nécessaire analyse des situations d’enseignement de l’oral proposées. Il convient de s’attacher tout autant à l’énoncé produit qu’au processus de production de l’énoncé. De même, il est important de permettre aux élèves de réussir les tâches demandées dans différents contextes. En se basant sur des situations personnelles de classe, il semble donc nécessaire qu’une séquence d’apprentissage de l’oral prenne en compte les trois composantes suivantes : - fréquence - répétition - progressivité Atelier enseigner l’oral page 3/6 Un exemple en maternelle : les élèves d’une classe ont effectué des plantations et sont amenés à verbaliser leur activité. a) verbalisation des actions sur le moment (objets présents, interlocuteurs présents lors de la plantation) ; b) verbalisation ultérieure, en classe (les objets ne sont plus présents, les interlocuteurs ont assisté aux plantations) ; c) récit des plantations à un adulte qui n’était pas présent (interlocuteur absent, mais qui possède des connaissances sur ce qui est rapporté) ; d) récit devant les élèves d’une autre classe (interlocuteurs absents, et qui ne possèdent pas forcément de connaissances sur le sujet). Ainsi, l’enfant est confronté à différents niveaux d’explicitation, et une progressivité est installée dans la maîtrise du discours. On voit bien ici également l’importance de l’étayage de l’adulte, très fort au début de la séquence d’apprentissage, puis progressivement réduit. 3) Evaluer l’oral Lorsqu’il s’agit d’évaluer l’oral, on pense souvent à la norme (demande sociale) et on cherche à mesurer des écarts à cette norme (l’expression « écarts de langage » est d’ailleurs très évocatrice à ce sujet). Mais quelle norme dans la classe ? L’enseignant ne représente-t-il pas (trop) systématiquement cette norme ? De nombreux modèles de grilles d’évaluation sont disponibles. Cependant, pour une réelle évaluation formative, il est nécessaire de didactiser le travail sur l’oral (évaluation diagnostique, préparation, progression, régularité des tâches, quelles tâches, quelles exigences, …). Evaluer l’oral renvoie inévitablement à interroger ce qui est mis en pratique. L’enjeu est aussi de montrer aux élèves ce que l’on cherche à faire. Atelier enseigner l’oral page 4/6 2 ème partie : Témoignages de pratiques et échanges 1) Les échanges dans le travail de groupe Comment aider les élèves qui ne prennent pas la parole dans un groupe, mais qui ont sans doute eux aussi des choses à dire ? Il semble nécessaire de partir d’une réelle évaluation diagnostique, afin de définir les vrais besoins des élèves. Ensuite, des groupes de langage peuvent être mis en place, des responsabilités peuvent également être données à certains élèves pour les amener à oser prendre la parole. Il ne faut pas oublier à quel point l’oral est une prise de risque. 2) La tendance à apprendre par cœur un exposé Lorsqu’ils doivent présenter un exposé, les élèves ont tendance à apprendre par cœur un texte qu’ils ont au préalable élaboré par écrit. La « peur du vide » est présente (Aurai-je assez de choses à dire ?). Oser improviser en classe n’est pas donné à tous les élèves et doit être un l’objet d’un apprentissage. Il est alors possible de travailler sur la production de l’oral en valorisant tout ce que l’on peut valoriser. Il faut aussi bannir tout ce qui peut donner à l’élève l’impression d’avoir « mal dit ». En arrière-plan, la question est de savoir comment trouver l’impression de « bien dit », et comment donner confiance à l’élève qui est soumis au regard de l’autre. 3) Le dialogue pédagogique Mettre l’élève en situation d’apprentissage de l’oral implique également de penser le dialogue pédagogique : questions souvent fermées posées aux élèves, et qui ne permettent pas de mettre l’oral pleinement en jeu. 4) Les débats philosophiques Ils peuvent permettre de viser également, à partir de situations orales, le développement de compétences civiques. Atelier enseigner l’oral page 5/6 BIBLIOGRAPHIE Collectif Groupe Oral/Créteil ENSEIGNER L’ORAL A L’ECOLE ELEMENTAIRE Hachette Education/IUFM de Créteil 1999 DECRET J.M. 2003 50 activités à l’école de l’oral du cycle 1 au cycle 3 SCEREN/Midi Pyrénées/CDDP Tarn et Garonne GARCIA-DEBANC C., PLANE S. Comment enseigner l’oral à l’école primaire Hatier 2004 JEANJEAN M.F., MASSONNET J. Pratiques de l’oral en maternelle Retz 2001 LE MANCHEC C. Pratiques orales de la langue à l’école : séquences didactiques Cycle 3 – liaison 6ème Plusieurs numéros de la revue REPERES LES CAHIERS PEDAGOGIQUES Numéro 400 OSER L’ORAL GARCIA-DEBANC C. Evaluer l’oral Revue PRATIQUES, n° 103-104 Atelier enseigner l’oral page 6/6 uploads/Management/ enseigner-l-x27-oral.pdf
Documents similaires

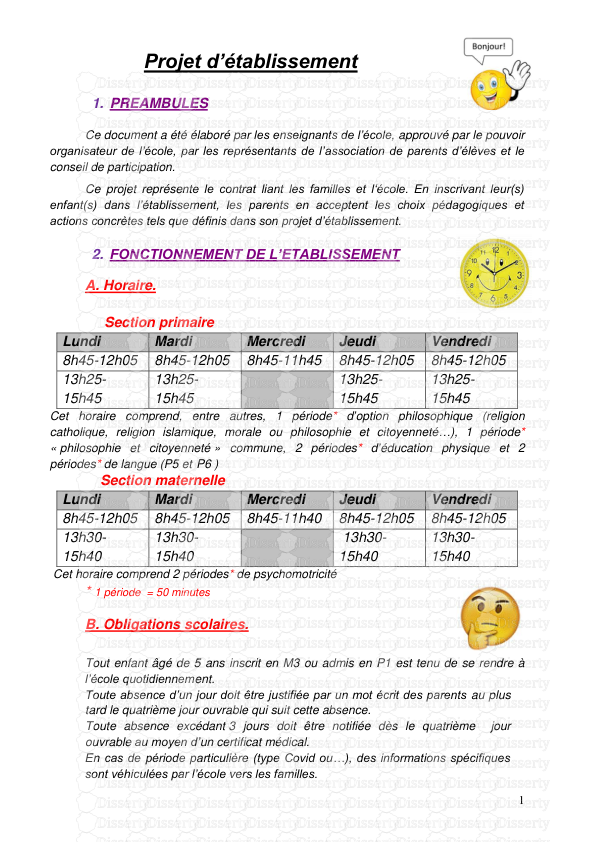








-
74
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 18, 2022
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 0.1394MB


