43 Harig Fatima Zohra MA Université d’Oran. 8. L’analyse linguistique du discou
43 Harig Fatima Zohra MA Université d’Oran. 8. L’analyse linguistique du discours Médiatique : théories, méthodes et enjeux Plan 1. Introduction 2. Théorie et Méthodes 3. Les enjeux 4. Bibliographie 1. Introduction Ce travail est au carrefour des analyses sociopolitiques et de la compréhension des phénomènes discursifs. Intéressé par tout ce qui concerne les relations d’interlocution, en analyste du discours. Qu’en est-il du discours médiatique ? La porte d’entrée, inspirée de Michel Foucault et de Jürgen Habermas, est d’observer les phénomènes langagiers pour y déceler les mécanismes de construction du sens social, dans l’espace médiatique. Cette machine médiatique, au sens de dispositif complexe et producteur d’information, est analysée sous ses trois pôles constitutifs : les conditions de production — instance d’énonciation —, les conditions d’interprétation — instance de réception —, et enfin le lieu d’élaboration du discours médiatique. L’approche multidimensionnelle est nette. Elle clarifie la complexité du discours médiatique. Le champ des analyses journalistiques s’est souvent concentré, s’agissant de la presse, sur les pages d’information. Si quelques rares travaux ont tenté d’élargir le domaine d’étude à des journalismes particuliers (le journalisme économique, le journalisme médical), force est de constater que fort peu de travaux se sont tournés vers la problématique du journalisme culturel, autrement dit vers cet espace journalistique que l’on nomme la critique. Or, limiter l’espace médiatique aux pages d’information nous semble fort dommageable dans ce sens que, tant du point de vue des producteurs que des récepteurs, les pages dites « culturelles » renferment d’importantes problématiques. Cette présentation a donc pour objet l’analyse d’articles dans des rubriques (éditorial, société, culture…) dans la presse Algérienne (plus précisément Le Quotidien, El-khabar, Le Soir, ElChourouk). Elle a pour but de mettre à jour les principales problématiques découlant d’une analyse d’un discours médiatique particulier : le discours critique. 2. Théories et méthodes Les conditions de production sont à la fois le cadre socio-économique et le cadre sémiologique ; d’une part, les médias visent un traitement de l’information de masse afin de maintenir leur position compétitive et de capter le plus grand nombre possible de « récepteurs », tout en ayant une exigence professionnelle et éthique d’informer, c’est-à-dire de choisir, d’évaluer, de problématiser l’information. On le voit, ces deux exigences sont en tension et peuvent constituer une injonction paradoxale. D’autre part, les producteurs de l’information médiatique eux-mêmes — les journalistes, les rédacteurs, les chefs de services — traitent l’information en fonction du public qu’ils visent et dont ils estiment les centres d’intérêt et les logiques. Ils font ainsi œuvre de représentation du monde et modulent ou modèlent leur production, leur pratique 44 professionnelle, leurs outils, leur mise en scène médiatique, etc., selon cette représentation du monde. Les conditions d’interprétation envisagent la « cible » choisie par chacun des médias aussi bien à travers ses centres d’intérêt, analysés par le marketing, que les processus cognitifs de perception, de compréhension, de mémorisation et d’évaluation des destinataires de l’information. C’est dire ici que l’approche sociologique est largement réductrice et peu opératoire pour guider les médias dans leur approche de la cible. La construction du discours consiste à composer ce matériau complexe, à dominante verbale mais comprenant aussi toutes sortes d’éléments visuels, graphiques, sonores, etc., assemblés en fonction de la façon dont les médias imaginent leur cible, ses centres d’intérêt et, en général, ses conditions d’interprétation. L’auteur indique : L’instance d’énonciation du discours (le journaliste) ne peut qu’imaginer le récepteur de façon idéale, c’est-à-dire le construire par hypothèse en destinataire supposé adéquat à ses intentions, et donc ne peut préjuger de l’activité interprétante réelle du récepteur ; comme d’autre part cette instance d’énonciation ne peut prétendre maitriser la totalité de sa propre intentionnalité du fait qu’en tant qu’être collectif elle draine avec elle plusieurs champs de signification dont elle n’a pas nécessairement conscience, force est de conclure que le texte produit est porteur de la co-intentionnalité qui s’établit entre énonciateur et destinataire (être de parole) Le concept de contrat de communication, qui unit le locuteur et l’interlocuteur autour d’éléments de référence connus et d’une intention d’échanger sur un espace accepté pour cela selon des conventions et un dispositif agréés. Travaillant sur l’analyse des textes médiatiques que nous avons entamée a été motivée par l’hypothèse d’une influence politique des critiques culturelles sur leurs lecteurs. Le choix de travailler sur des textes découlant de la presse nationale a donc été motivé par ce but sous-jacent : il s’agissait d’étudier un ensemble de textes lu par le nombre de lecteurs le plus large possible et surtout par des lecteurs n’étant pas particulièrement à la recherche d’une information culturelle (la motivation d’un quotidien reposant rarement sur les pages culturelles). Le fait de prendre la PQN ( presse quotidienne nationale) comme objet est donc lié à notre questionnement sur la potentielle influence des textes critiques : quelle influence peut avoir la critique culturelle sur un lecteur a priori dépourvu d’attentes particulières en terme culturel ? Nous avons donc sélectionné les trois plus grands journaux de PN du paysage algérien :Le Quotidien, Le soir et ElKhabar. Nous allons retenir la période entre 1994 et 2011. Une analyse sémio linguistique présente les principales conclusions en trois parties. La première rend compte du résultat de l’analyse sur le plan des représentations : partant de l’hypothèse que la critique ne véhicule pas seulement des représentations esthétiques, nous avons analysé les signes d’éventuelles représentations sociopolitiques. La deuxième présente les résultats de notre analyse portant cette fois sur la signification politique des représentations esthétiques : les prises de position artistiques des journalistes, leur travail d’écriture a une signification politique et sociale. La troisième partie enfin résume les principales conclusions ayant trait aux problématiques de la réception et à la question de l’influence des représentations véhiculées par la critique culturelle sur ses lecteurs. 45 3. Les enjeux Il s’agit dans notre exposé d’expliciter de la manière la plus claire possible les cadrages théoriques et méthodologiques d’une analyse linguistique de la presse écrite algérienne .Notre exposé propose l’étude de plusieurs articles et aborde la problématique des enjeux et des perspectives d’une analyse linguistique du discours journalistique. Ainsi, deux grandes questions se posent en tout cas : sur un plan théorique, quelle est la place d’une analyse linguistique au sein des sciences de la communication et des médias ; sur un plan « herméneutique », une analyse linguistique du discours journalistique est-elle nécessaire à la compréhension du fonctionnement et des fonctions sociales, politiques, et économiques des médias ? Cette analyse plaidera aussi pour un dialogue qui résonne et raisonne entre la linguistique et les médias. En prenant appui sur la notion de connivence, notre propos visera à interroger la distance entre l’instance émettrice – les médias – et l’instance réceptrice– les lecteurs, puisque nous prendrons pour cadre d’analyse la presse écrite. Cette problématique sera articulée au sein d’une herméneutique de la communication dont nous mentionnerons le cadre épistémologique. Cette interrogation sur le réglage d’une forme de proxémique, impliquant à des degrés divers une forme de connivence, convoque en creux une certaine image du journaliste dans son discours – un ethos – qui nous intéressera particulièrement. L’examen de différents genres de la presse écrite algérienne , ainsi que l’étude du paratexte de presse permettra d’abord d’interroger les différentes manifestations de la connivence et ensuite de montrer que certains aspects de la parole journalistique doivent interpeller le linguiste de la même manière que le linguiste mérite d’être entendu des journalistes. Deux grandes approches sont mises à contribution. La première voie s’appuie sur des « patrons » lexico-syntaxiques caractéristiques d’une relation sémantique donnée, comme deux indices de l’hyponymie en français .Dans la deuxième approche, l’objectif global est de trouver des « airs de famille » entre les mots. Pour rendre le texte traitable, une première étape est celle de la réduction, de la simplification des traits associés aux mots. C’est une optique distributionnelle qui prévaut : un mot est caractérisé par les contextes dans lesquels il figure. Bibliographie Bourdieu P., La Distinction, Paris, Les Editions de Minuit, 1979 Blandin C., « Les interventions des intellectuels de droite dans Le Figaro Littéraire. L’invention du contre engagement », in Vingtième Siècle, n°96, octobre-décembre 2007, p 170-194 Charaudeau P., La presse : produit, production, réception, Paris, Didier Erudition, 2000 Graña C., Bohemian versus Bourgeois, French Society and the French Man of Letters in the Nineteenth Century, New York, Basic Books, 1964 Lazarsfeld P., Berelson B., Gaudet H., The people’s choice, New York, Duell, Sloan and Pearce, 1944 Panofsky E., Architecture gothique et pensée scolastique, Paris, Les Editions de Minuit, 1967 Pourtier H. (Sous la direction), « La critique culturelle, positionnement journalistique ou intellectuel ? », Quaderni, n°60, printemps 2006 uploads/Management/ l-x27-analyse-linguistique-du-discours-mediatique-theories-methodes-et-enjeux.pdf
Documents similaires







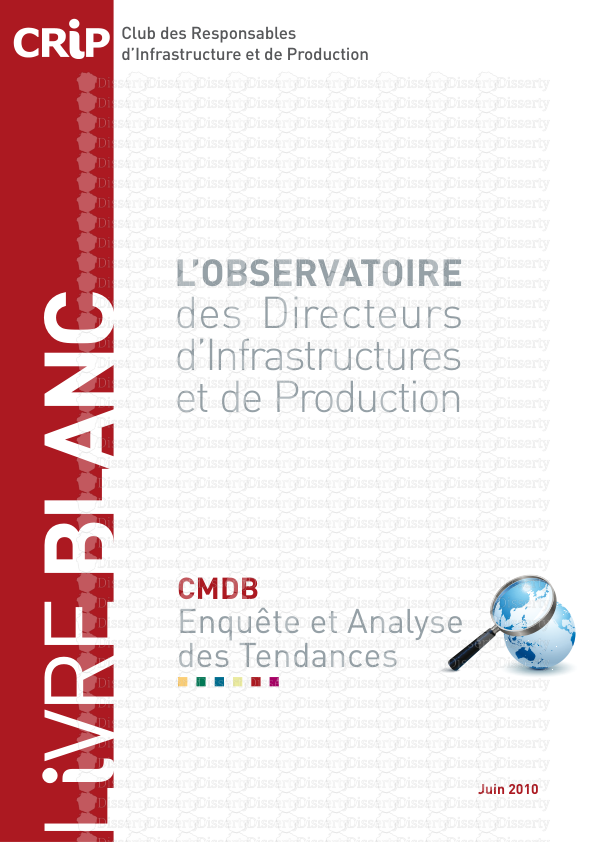


-
59
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 09, 2021
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 0.2034MB


