L’enseignement explicite de la compréhension 14 Février 2017 Emilie Fléchel – C
L’enseignement explicite de la compréhension 14 Février 2017 Emilie Fléchel – CPC Laurent Ronchail - IEN Objectifs de la formation • Connaitre les enjeux de l’enseignement de la compréhension, en se référant aux pratiques de classe. • Connaitre la démarche de l’enseignement explicite de la compréhension. • Explorer des supports d’enseignement explicite de la compréhension. Plan de la formation • Aujourd’hui 14 février : 2 heures o Analyser une pratique de classe courante : le questionnaire de lecture o Connaitre les mécanismes de la compréhension et les compétences mises en œuvre pour comprendre un texte o Faire un point sur les programmes o Connaitre la démarche de l’enseignement explicite de la compréhension o S’approprier des supports et les analyser pour ensuite les utiliser en classe • 20 mars : 1 h o Retour sur votre expérimentation de l’enseignement explicite de la compréhension o Présentation d’autres outils permettant un enseignement explicite o Faire le bilan de la formation Pour commencer… • Texte à trous d’André Gide • Par 2 ou par 3, comblez les trous et essayez d’expliquer vos stratégies pour y parvenir Résultats et analyse du questionnaire préalable : profil des classes et des pratiques liées à la compréhension • 27 réponses sur 42 enseignants inscrits (64 %) o 55 % des enseignants en cycle 2 o 30 % des enseignants en cycle 3 o 15 % des enseignants en cycle 2/cycle 3 • 52 % travaillent la compréhension de manière collective • 11 % travaillent la compréhension de manière individuelle • 11 % proposent les deux modalités • 96 % travaillent la compréhension sur tous types de textes. Résultats et analyse du questionnaire préalable : profil des classes et des pratiques liées à la compréhension • Des modalités de travail de la compréhension très diversifiées : o 22 % suivent uniquement le manuel et le guide du maitre o 11 % proposent uniquement des séances qu’ils ont construites eux-mêmes o 7 % proposent uniquement un entraiment spécifique à la compréhension o 11% s’appuient sur un manuel et sur des séances construites o 19% s’appuient sur un manuel et sur de séances d’entrainement spécifique o 22 % s’appuient sur leurs propres séances et un entrainement spécifique o 7 % s’appuient sur un manuel, sur leurs propres séances et un entrainement spécifique Résultats et analyse du questionnaire préalable : les activités proposées aux élèves • 89 % d’entre vous utilisent un questionnaire écrit de lecture A vous de réfléchir Pourquoi utilisez-vous un questionnaire de lecture ? Si l’élève a répondu juste à toutes les questions, a t-il pour autant compris l’histoire ? Le questionnaire de lecture (expérimentation de Goigoux, Cèbe et Thomazet) • À plat ventre sur la plus grosse branche de tilleul, Colin, immobile comme un chasseur à l’affût, observe le manège du chat Tibère. • Tapi sous un banc de l’allée où les miettes de pain font le régal des moineaux, Tibère attend patiemment que ceux-ci s’approchent suffisamment de lui pour bondir sur la proie qu’il convoite. • 1. Qui est dans l’arbre ? • 2. Que regarde Colin ? • 3. Qui est le chasseur de l’histoire ? • 4. Qui mange le pain ? • 5. Où est le chat ? Le questionnaire de lecture (expérimentation de Goigoux, Cèbe et Thomazet) • À plat ventre sur la plus grosse branche de tilleul, Colin, immobile comme un chasseur à l’affût, observe le manège du chat Tibère. • Tapi sous un banc de l’allée où les miettes de pain font le régal des moineaux, Tibère attend patiemment que ceux-ci s’approchent suffisamment de lui pour bondir sur la proie qu’il convoite. • Réponses et stratégies des enfants en difficulté • 1. Qui est dans l’arbre ? Début du texte + branche( tilleul) = arbre -> Colin • 2. Que regarde Colin ? Observe = regarde -> le manège du chat Tibère • 3. Qui est le chasseur de l’histoire ? 2ème ligne « chasseur », Colin avant et Tibère après -> 1 chance sur 2 • 4. Qui mange le pain ? Culture: les oiseaux mangent le pain • 5. Où est le chat ? Sous le banc ( le mot tapi n’est pas traité) • Bilan :4 ou 5 bonnes réponses sur 5 Le questionnaire de lecture Le questionnaire de lecture Le questionnaire de lecture Le questionnaire de lecture Le questionnaire de lecture Le questionnaire de lecture (Goigoux, Cèbe et Thomazet) • Quand ils sont mis face à des textes, les « petits lecteurs » tendent à adopter une attitude plutôt passive, attendant le plus souvent de disposer du questionnaire pour s’y intéresser véritablement. • Leur première lecture a une fonction de repérage thématique (« de quoi parle le texte ? »), rarement de construction problématique (« qu’est-ce que le texte veut dire ? Qu’est ce qu’il raconte, explique... ? Quel est le problème ? »). Le questionnaire de lecture ( Goigoux, Cèbe et Thomazet) • Ce repérage superficiel leur suffit bien souvent pour répondre aux questions. • Ils mettent en œuvre des procédures relativement rudimentaires qui demandent peu d’efforts : ils identifient un mot-clé dans la question (qui, quand, où, comment...) puis ils cherchent à localiser, dans le texte, un indice (une majuscule...) ou un segment textuel (un complément de temps, de lieu...) qui renvoie à ce mot-clé ou qui est en rapport avec lui. Ils recopient l’information trouvée (la plupart du temps celle qui est placée à droite du mot-clé) Le questionnaire de lecture • Cette stratégie de localisation rend des services et elle est sans doute renforcée au cycle II par le fréquent usage pédagogique de tâches pour lesquelles elle est pertinente, usage qui peut avoir, une double origine : • d’une part, les maîtres cherchent à mettre leurs élèves en position de réussite et ils utilisent pour cela les questions les plus faciles, les plus littérales (et ce bénéfice à court terme s’avèrera parfois contreproductif à moyen terme) ; • d’autre part, les faibles compétences de scripteur des jeunes élèves incitent les maîtres à privilégier les questions auxquelles on peut répondre en copiant quelques mots du texte. Le questionnaire de lecture • Il faut donc par la suite, apprendre les procédures efficaces pour répondre à des questions. • Trois procédures pour répondre aux questions • A. La réponse est écrite dans le texte : il suffit de la recopier. Pour la trouver, il faut parfois avoir reformulé la question. • B. La réponse n’est pas écrite mais toutes les informations sont dans le texte : il faut les réunir pour déduire la réponse. • C. La réponse n’est pas écrite : il faut la rédiger. Il faut raisonner à partir des informations du texte et de ses connaissances pour déduire la réponse. Il faut inférer. Comprendre c’est faire des inférences • L'inférence est une activité cognitive essentielle. • Elle permet de maintenir la cohérence de la représentation mentale échafaudée par le lecteur (ou l’auditeur) • Elle consiste : « à produire de nouvelles informations à partir d'informations venant de l'environnement et d'informations stockées en mémoire à long terme» • Ganier, F. & Heurley, L. in Goanac'h, D.& Fayol, M., 2010 • vidéo Les mécanismes de la compréhension • Modèle de Jacqueline Giasson, qui fait consensus chez les didacticiens de la lecture. • Plus la relation entre ces trois parties est grande, meilleure sera la compréhension Les mécanismes de la compréhension Les mécanismes de la compréhension Les difficultés rencontrées par vos élèves • 59 % d’entre vous pensent qu’elles sont liées au décodage • 89 % liées aux connaissances lexicales et syntaxiques • 44 % liées au texte (genre littéraire, chronologie, reprises anaphoriques, etc..) • 78 % liées aux stratégies pour comprendre un texte • 46 % liés aux attendus (élève lecteur /enseignant) • Ces difficultés sont à rapprocher des compétences mises en œuvre pour comprendre un texte . Les mécanismes de la compréhension • Compétences mises en œuvre pour comprendre un texte : Modèle de Maryse Bianco, 2016 Compréhension des textes Décodage Traitement du discours continu : - Cohérence globale et générale - - Inférences (fondées sur le texte et sur les connaissances) - - Stratégies ( auto-évaluation et régulation) Connaissances : - Vocabulaire - Générales ( du monde) - Syntaxe: et morphologie - Structures textuelles Efficience cognitive : - Attention - -Mémoire de travail, fonctions exécutives - - Raisonnement Donc enseigner la compréhension, c’est… • La compréhension est le fruit d’un effort conscient et réfléchi puisqu’elle fait appel à un certain nombre de compétences. • Les enseignants doivent les accompagner dans cet effort, en les aidant à s’approprier les stratégies et procédures à mettre en place pour comprendre un texte. • Pour s’approprier une stratégie, il faut la connaitre, la travailler plusieurs fois puis l’automatiser. L’enseignement explicite est un moyen d’y parvenir. Ce que disent les programmes: Compétences travaillées Cycle 2 Cycle 3 Comprendre et s'exprimer à l'oral Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte. Dire pour être entendu et compris. Participer à des échanges dans des situations uploads/Management/ l-x27-enseignement-explicite-de-la-comprehension.pdf
Documents similaires






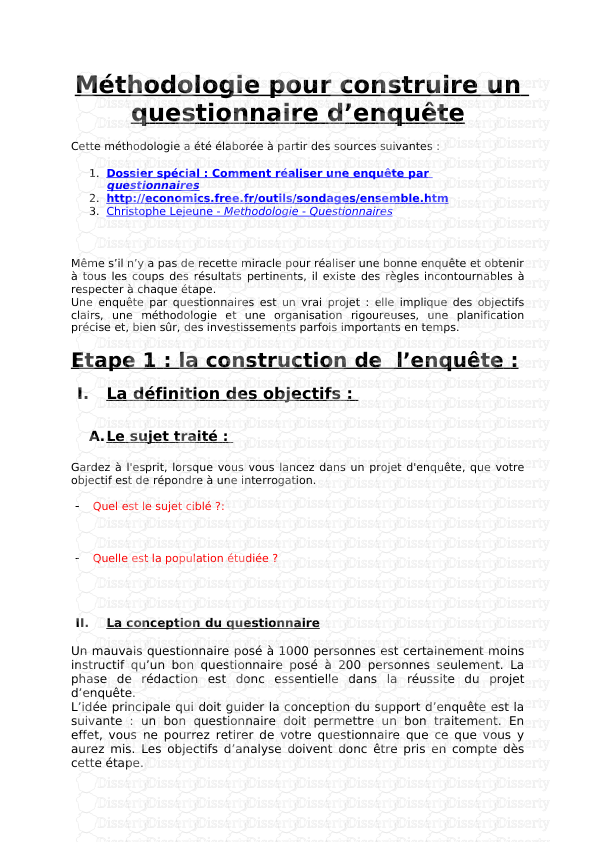



-
39
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 08, 2022
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 2.6435MB


