Haute Ecole Pédagogique / Vaud, filière MS2 Juin 2012 Auteur : Friederike Ilsch
Haute Ecole Pédagogique / Vaud, filière MS2 Juin 2012 Auteur : Friederike Ilschner Directeur : Prof. Ingo Thonhauser Membre du Jury : Prof. C. Bartholemy UER : Didactique des Langues et Cultures « Les élèves sont capables d’apprendre » : Techniques de mémorisation pour l’apprentissage du vocabulaire 1 1 TABLE DES MATIERES Introduction p. 2 I – La mémoire : De Mnémosyne au néocortex p. 5 II – Techniques et stratégies au service de la mémoire p. 10 La méthode des histoires p. 11 La méthode des lieux ou méthode loci p. 14 La méthode des mots-clés p. 16 La méthode des associations par images p. 18 La méthode du regroupement de mots p. 23 L’art de bien répéter, entre tradition et modernité p. 25 III – La mnémotechnique en pratique : Bilan des expériences faites en classe p. 29 Conclusion p. 38 Bibliographie p. 42 Annexes p. 43 2 INTRODUCTION « Acquérir plus que des savoirs, des savoir-faire ! »2 Sept milliards d’euros sur six ans : c’est la somme injectée par la Commission Européenne dans le programme dit « pour l’éducation et la formation tout au long de la vie ». 3 Un programme qui trouve son écho dans les objectifs d’apprentissage du règlement suisse pour la formation des apprentis employés de commerce. En effet, ce règlement national souligne à plusieurs reprises la nécessité pour les élèves de faire preuve d’une « aptitude à l’apprentissage », d’une « bonne méthode … pour continuer à acquérir de nouvelles … connaissances », d’une « [conscience] du fait que l’on apprend toute une vie » et d’une « gamme très étendue de techniques de travail ».4 Zoom enfin sur le canton de Vaud, qui reprend ces mêmes partis pris dans le plan d’étude pour écoles professionnelles. Les « savoir- faire » procéduraux y sont logés, pour chacune des branches, à la même enseigne que les savoirs déclaratifs et le savoir-être ; ils font partie de la même mission d’enseignement, ceci en vue de permettre aux élèves de « maîtriser de manière adéquate et avec succès des situations présentant un problème concret à résoudre. »5 Il semblerait alors naturel de retrouver chez les enseignants ce souci d’enseigner non seulement leur savoir disciplinaire, mais encore de donner goût à l’apprentissage en soi, de le faciliter en transmettant des méthodes de travail éprouvées, des stratégies rusées. Les cours de méthodologie, dispensés dans les écoles professionnelles commerciales aux élèves de première année, participent de cet effort. Mais si certains élèves bâtissent spontanément sur ces méthodes et stratégies, et les intègrent tout naturellement dans leurs apprentissages, d’autres y semblent plus réfractaires ou inaptes, et manquent régulièrement en efficacité ou échouent dans la réalisation de leurs tâches. Preuve, d’une part, que les facteurs de difficultés ou d’échec scolaire sont multiples et ne tournent pas uniquement autour des méthodes d’apprentissage. Signe, d’autre part, que le corps enseignant ne peut se reposer sur un cours de méthodologie générale, et que chaque maître a tout intérêt à intégrer dans ses cours des stratégies et méthodes spécifiques à sa branche, à son enseignement, aux tâches précises qu’il assigne.6 Travailler selon des méthodes connues et éprouvées, tester pour soi des stratégies plus subtiles et astucieuses, en faire une expérience concrète dans un contexte donné, les apprécier ou les critiquer, les adapter et s’adapter, les adopter ou les rejeter, peut-être même se trouver des ‘trucs’ très personnels, – apprendre à se connaître en tant qu’apprenant : telle est l’essence de ce précieux savoir-faire, l’apprendre à apprendre. 3 Indéniablement, la transmission de savoirs disciplinaires est la mission la plus visible des institutions scolaires, et les élèves sont généralement évalués – voire identifiés – à leur capacité de restituer les savoirs de type déclaratif (selon le plan d’études des écoles de maturité commerciale, pour l’anglais et l’allemand, « les connaissances linguistiques (vocabulaire et structures) »). 7 Mais cette capacité-là n’est-elle pas la pointe resplendissante d’un grand iceberg ? Et donc, à quel point est-ce qu’un enseignement obsédé par ce typique objectif de transmission de savoirs déclaratifs peut-il être efficace ? Il le sera, sans doute, pour des apprenants qui ont intégré un savoir-faire (« utilisation de stratégies ») et un savoir-être (« être motivé à parfaire ses connaissances », « se montrer ouvert et communicatif ») propice à la branche enseignée.8 Par contre, il risque aussi de laisser derrière lui une frange d’élèves qui n’ont pas eu l’initiative, ou la capacité d’intégrer des méthodes de travail qui leur sont profitables dans un contexte donné, et/ou qui se montrent donc peu motivés à parfaire leurs connaissances linguistiques. Constater que des connaissances ne sont pas acquises et sanctionner par l’échec n’est donc à priori ni suffisant, ni forcément pertinent. Le grain de sable qui bloque le rouage du progrès et de la réussite doit plutôt être recherché, et si possible retiré, dans des niches multiples. Ce, pour donner toutes les chances aux élèves, non seulement à l’école, mais aussi pour leur avenir. Car n’oublions pas que si la réussite immédiate des tâches scolaires, confirmée par une évaluation satisfaisante, est primordiale pour obtenir une certification de fin d’études, elle participe de ce projet plus fondamental et plus vaste qu’est la préparation des élèves à la vie qui les attend extra muros, – dans une autre école, en entreprise, ou à d’autres occasions. Et dans cette vie-là, ce n’est pas seulement la restitution des connaissances intellectuelles qui importe, mais aussi les compétences pratiques qui permettent de s’adapter à des problèmes nouveaux, inattendus, inconnus. Rester des apprenants tout au long de la vie, rester curieux, chercher à construire sur les acquis, à se débrouiller face à la difficulté, et à prendre plaisir à s’enrichir de connaissances et d’aptitudes nouvelles : elle est aussi là pour cela, l’école, – la scholé, que les anciens Grecs définissaient comme l’« arrêt de travail », ou encore comme « le loisir consacré à l’étude » !9 Si les votations fédérales de mars dernier nous rappellent que les Suisses ne sont pas prêts à arrêter de travailler, ils apprécient néanmoins l’efficacité et l’optimisation de leurs efforts. Préparer un café en deux gestes et 30 secondes grâce à Nespresso ; organiser en 5 minutes un rendez-vous entre amis aux agendas bien remplis avec Doodle ; couper, visser, tirer, décapsuler, ouvrir, grâce à un seul outil – le fameux couteau suisse… L’efficacité helvétique 4 ne serait donc pas qu’un mythe. Mais alors, est-ce qu’un Professeur Tournesol aux idées farfelues ne pourrait pas aussi passer dans les salles de classe, et aider les élèves à être aussi efficaces que performants ? Bien avant le Professeur Tournesol, Simonide de Céos, poète grec du 5ème siècle av. J-C, avait déjà répondu à un tel appel. Car si l’on s’en tient à la légende, il a innové en se servant de ce qu’on appelle de nos jours un moyen mnémotechnique, – un moyen d’optimiser son rendement mnésique, d’être performant et efficace dans la restitution d’un fait ou d’un savoir. D’après la légende, Simonide assistait à un grand dîner festif organisé par le noble Skopas. Alors qu’il recherchait deux hommes qui lui ont donné rendez-vous à l’extérieur du bâtiment, le toit s’effondra. Skopas et ses convives furent ensevelis sous les décombres. Pendant la fouille des décombres, Simonide fut appelé pour identifier les corps, à peine reconnaissables. Il parvint à le faire, en se rappelant la place que chacun occupa aux tables, grâce à une technique de mémorisation particulièrement efficace. Dès lors, divers écrits antiques le créditèrent volontiers de l’invention de l’« ars memoriae », cet art qui fascine et qui a souvent rendu service, notamment avant l’arrivée de ce substitut de mémoire qu’est Wikipédia, notre e-mémoire périphérique. Car la mémoire a toujours fasciné, surtout qu’elle était longtemps et pour beaucoup le seul moyen de transmission du savoir, et que l’art de bien la manier procurait un certain prestige, un certain pouvoir. D’ailleurs, depuis les orateurs romains jusqu’aux experts contemporains de la psycho-cognition, en passant par les intellectuels du Moyen-Âge, nombreux sont ceux qui ont étudié cette béquille contre l'oubli. Par ce travail, nous marcherons humblement sur leurs traces : comment comprendre le processus de mémorisation ? Comment le soutenir et l’optimiser ? Comment utiliser ces « béquilles contre l’oubli »? Ces questionnements, nous les mettons en lien avec l’enseignement du vocabulaire langue étrangère, dont nous refusons de considérer l’apprentissage comme une tâche uniquement domestique et individuelle. En effet, le vocabulaire s’apprend de mille et une façons, – seul devant une liste de mots ou un texte, mais aussi en interaction avec les camarades, les enseignants, et d’autres locuteurs L2. Chaque fois, l’enseignant peut proposer à l’apprenant un moyen de se parer contre l’oubli ; chaque fois, l’apprenant peut choisir de retenir l’information habilement. Ce, non seulement pour briller aux tests, mais surtout pour se réjouir de communiquer avec toujours plus de précision, de facilité et de naturel. Le plan d’étude vaudois insiste d’ailleurs sur ce point : L’enseignement des langues [doit donner] aux élèves les aptitudes linguistiques susceptibles de les faire participer uploads/Management/ les-eleves-sont-capables-d-x27-apprendre-techniques-de-memorisation-pour-l-x27-apprentissage-du-vocabulaire.pdf
Documents similaires
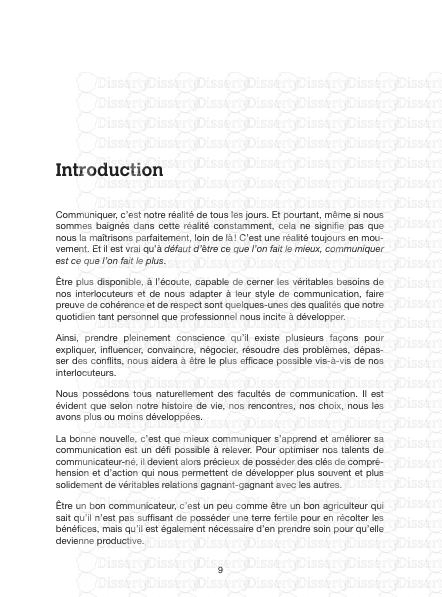









-
64
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 14, 2021
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 0.7116MB


