MOOc Cavilam Enseigner le FLE Module 1 : Connaître les principes et concepts cl
MOOc Cavilam Enseigner le FLE Module 1 : Connaître les principes et concepts clés de l’enseignement du FLE Leçon 1 : Qu’est-ce qu’apprendre ? Apprenant = la personne qui apprend. Pour mieux enseigner, partons de notre propre apprentissage : comment apprenions-nous du nouveau vocabulaire d’une LE ? Plusieurs méthodes : Prendre le dictionnaire et mémoriser quelques mots par cœur Répéter les mots à voix haute, les écrire, les écouter Écrire et classer les mots dans votre répertoire de mots nouveaux en fonction de thèmes dans des phrases toutes faites Jouer avec des flashcards en associant le mot et son image Si votre langue est à base latine, passer par votre langue maternelle pour en rechercher le sens ou la proximité de certains mots avec votre connaissance de l’anglais a aidé Faire des cartes mentales de familles de mots ? → Sans le savoir, on utilise des stratégies pour mieux apprendre. Par ailleurs, les stratégies sont utilisées dans tous les domaines. Stratégie = faire des actions pensées et coordonnées pour atteindre un but et si possible une victoire. Ici, la victoire est de réussir à apprendre à communiquer en français. Pour l’apprenant, une stratégie d’apprentissage est donc une technique ou une méthode qu’il utilise pour apprendre à communiquer en français. Il y a beaucoup de stratégies possibles… Ex : la façon de mémoriser quelque chose, de parler avec des amis francophones en leur demandant « s’il te plaît corrige-moi quand je fais des erreurs », mettre en contexte des mots nouveaux, faire des cartes mentales, travailler en groupe, s’autocorriger… Ces stratégies doivent aider l’apprenant à être plus autonome et indépendant dans son apprentissage. Grâce à elles, il apprend aussi en dehors de la salle de classe. Catégorisation des stratégies : Pour réaliser quelque chose, il faut développer des stratégies cognitives = manipuler mentalement ou physiquement la matière (ex : monter un meuble : lire la notice avant de le monter, regrouper les éléments à assembler, planifier les tâches, mettre les vis + faire appel à notre expérience de bricolage). des stratégies métacognitives = réflexion sur le processus, préparation, planification, autoévaluation (ex : Votre expérience du montage de meubles raté ou réussi vous aidera à planifier les tâches à effectuer et à évaluer votre montage). des stratégies socio-affectives = interagir avec une autre personne et contrôler la dimension affective accompagnement la réalisation (ex : demander de l’aide à quelqu’un, s’énerver sur la vis manquante). Pour apprendre le français, nous allons retrouver les mêmes types de stratégies. - les stratégies cognitives = manière de traiter les informations, les organiser et les mémoriser. Ex : Observer, Répéter, Souligner, Prendre des notes, Résumer, Créer des associations mentales, Utiliser des images et des sons, Comparer avec des langues connues, Utiliser la langue maternelle - les stratégies métacognitives = aptitudes à réfléchir sur leur apprentissage, pour apprendre plus efficacement ; la capacité à réfléchir sur ce qui se passe dans le processus d’apprentissage. C’est l’idée de planifier et de contrôler. Ex : Se fixer des objectifs, Réfléchir à sa propre façon de réfléchir, Tenir un journal personnel d’apprentissage, Chercher des occasions de pratiquer le français, S’autoévaluer. - les stratégies socio-affectives = l’interaction avec une autre personne + contrôler les sentiments et les émotions. Ex : Coopérer avec ses collègues, S’encourager mutuellement, S’ouvrir aux autres, Partager ses sentiments, Utiliser l’humour. ► De nombreuses stratégies peuvent être mises en place lorsqu’on apprend le français. Le rôle de l’enseignant est donc aussi d’aider ses apprenants à identifier les meilleures stratégies pour les aider à apprendre. Il s’agit de développer un bagage de stratégies qu’il utilisera dans la classe et en dehors de la classe. Leçon 2 : L’approche communicative Chaque enseignant va être amené à faire des choix, et ces choix vont déterminer d’une part, les contenus de son enseignement, et d’autre part, la façon dont il va les transmettre. Et pour cela, l’enseignant devra toujours avoir en tête ces 4 questions : Qui ? A qui j’enseigne ? Quoi ? Pour quoi faire ? Pourquoi ? Quoi enseigner ? Comment ? Comment enseigner ? On parle beaucoup de l'approche communicative dans l'enseignement des langues. Mais comment définir cette approche ? L’approche communicative est une méthodologie apparue dans les années 70. Elle s’est opposée aux méthodes précédentes qui mettaient surtout l’accent sur la forme et la structure des langues. Son objectif essentiel est d’apprendre à communiquer en LE. L’approche communicative a ainsi révolutionné l’enseignement et l’apprentissage des LE par le fait qu’elle a pris en compte la situation de communication. « Quand j’apprends une LE, de quoi ai-je besoin en premier lieu pour communiquer avec quelqu’un ? » C’est justement pour répondre à cette question qu’un inventaire d'actes de parole a été réalisé en 1976 : le niveau-seuil. Mais qu’est-ce qu'un acte de parole ? Quand vous dites « Pouvez-vous fermer la porte, s’il vous plaît ? », vous prononcez cette phrase, mais ce que vous faites, c’est « demander à quelqu’un de faire quelque chose », ici, fermer la porte. Un acte de parole, c’est donc un moyen utilisé par la personne qui parle (le locuteur) pour agir sur son environnement avec des mots. Avec l’approche communicative, la priorité est la communication entre des personnes dans un contexte précis, ex : acheter une baguette à la boulangerie, passer une commande au restaurant. L’enseignant introduit la grammaire et le lexique en fonction des besoins et des objectifs d’une situation de communication et non dans le but de faire apprendre des règles grammaticales par cœur ou de réciter des listes de mots. Comment intégrer cette approche en classe ou quel type de document l’enseignant doit-il privilégier ? Dans l’approche communicative, une place importante est donnée aux documents dits « authentiques » = tout document ou objet non élaboré à des fins pédagogiques. Ils permettent de faire entrer une réalité de la langue et de la culture. Ex :un article de presse, un extrait d’une émission de radio, une photo ou une brochure. Ces documents permettent de développer la curiosité et d’introduire une dimension de plaisir à l’apprentissage. L’objectif de l’enseignant est de développer les compétences de l’apprenant pour qu’il soit capable d’affronter avec succès les situations de communication. L’idée de faire entrer dans la classe une langue proche du « réel » suscite chez l’apprenant le désir d’apprendre une LE et de découvrir la culture liée à cette langue. ► La motivation est fondamentale dans tout apprentissage ! Leçon 3 : L’approche actionnelle Cette approche provient du Conseil de l’Europe, une organisation intergouvernementale, créée en 1949 et qui a pour mission de défendre les droits de l’homme et de mettre en valeur l’identité culturelle de l’Europe et sa diversité. Le Conseil de l’Europe travaille aussi dans le domaine de l’enseignement des langues pour favoriser la mobilité géographique des citoyens européens. C’est ainsi qu’en 2001, le Conseil de l’Europe a publié le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECRL). C'est une sorte de guide commun que l’on utilise pour l’élaboration de programmes, d’examens et de formations en LE, ayant comme objectif d’harmoniser les systèmes éducatifs européens. Ce guide est utilisé et sur d’autres continents. Le CECRL propose 6 niveaux de compétences en LE. Quelques descripteurs correspondant à chacun d’entre eux. - Au niveau A1, le locuteur a des connaissances linguistiques de base. Il peut communiquer de manière simple, parler de lui-même et de son environnement immédiat. - Au niveau A2, il peut échanger des informations simples sur des sujets familiers et habituels. - Au niveau B1, il peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage, raconter un événement, une expérience, défendre un projet ou une idée. - Au niveau B2, il peut communiquer avec aisance et spontanéité dans les situations habituelles. Il est assez autonome pour développer des arguments, pour défendre son opinion, expliquer son point de vue et négocier. - Au niveau C1, il est autonome. Il peut s’exprimer couramment et spontanément. Il peut sans hésitation tenir un discours clair et bien construit. - Au niveau C2, il peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il lit ou entend. ► Pour chaque niveau, le CECRL décrit des compétences en distinguant 5 activités langagières : Lire, écrire, écouter, parler en continu et parler en interaction. Le chapitre 2 du CECRL est consacré à la perspective actionnelle : il s’agit d’une nouvelle approche pour apprendre et enseigner les langues vivantes. Cette approche est basée sur les actions que l’apprenant réalise en LE. L’enseignant doit donc considérer l’apprenant comme une personne qui va agir dans la réalité personnelle, publique, scolaire ou professionnelle. C’est un acteur social. La perspective actionnelle reprend les principes de l’approche communicative, mais elle met l’accent sur la notion de tâche. ► Dans cette approche, l’apprenant devra mobiliser des compétences qui lui permettent d’agir pour accomplir des tâches qui ne sont pas seulement langagières. La tâche met donc l’apprenant en « action ». Ex : Vous devez organiser un dîner pour vos amis. → verbe d’action « uploads/Management/ mooc-cavilam-enseigner-le-fle-synthese-lilou-ch.pdf
Documents similaires





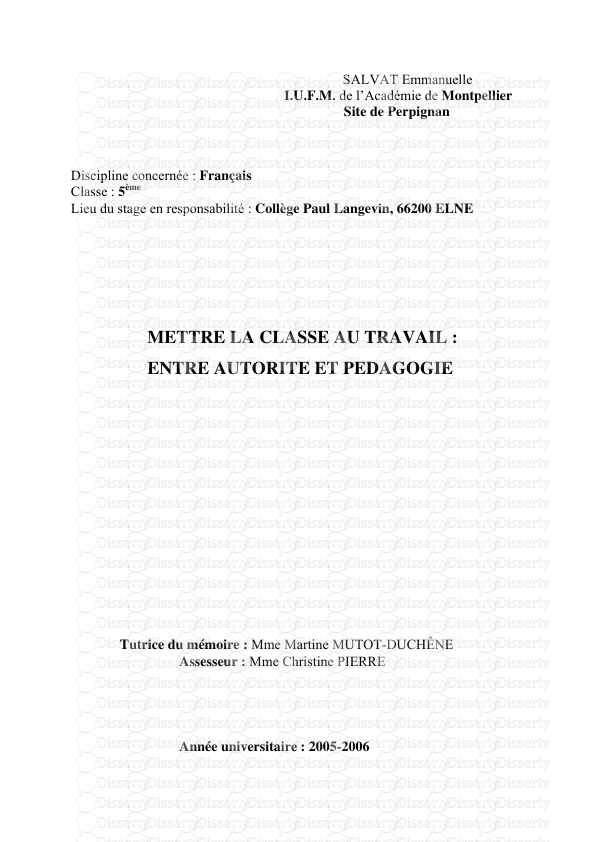




-
59
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 11, 2021
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 0.4288MB


