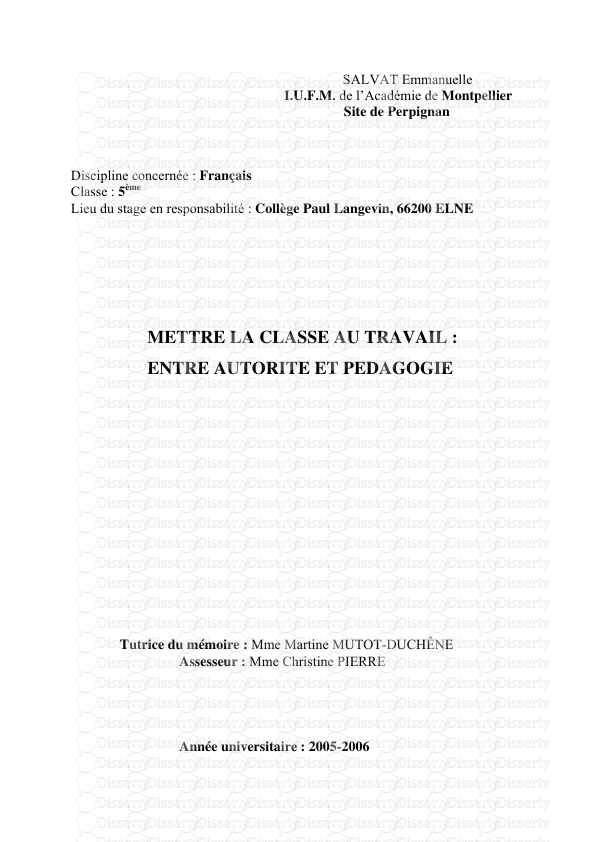SALVAT Emmanuelle I.U.F.M. de l’Académie de Montpellier Site de Perpignan Disci
SALVAT Emmanuelle I.U.F.M. de l’Académie de Montpellier Site de Perpignan Discipline concernée : Français Classe : 5ème Lieu du stage en responsabilité : Collège Paul Langevin, 66200 ELNE METTRE LA CLASSE AU TRAVAIL : ENTRE AUTORITE ET PEDAGOGIE Tutrice du mémoire : Mme Martine MUTOT-DUCHÊNE Assesseur : Mme Christine PIERRE Année universitaire : 2005-2006 RESUME EN FRANCAIS L’essentiel de ce mémoire est de mettre en évidence l’exigence de l’adaptation de l’enseignant à son public. Cette exigence passe nécessairement par une gestion rigoureuse de la classe. De plus, face à des élèves difficiles, il est indispensable de faire du lieu « classe » un espace d'échanges, de confiance. Enfin, les diverses méthodes de travail de l’enseignant doivent prendre en compte les difficultés des élèves afin qu'ils puissent y remédier et devenir autonomes. RESUME EN ANGLAIS The essence of this memory is to highlight the requirement of the adaptation of the teacher to his public. This requirement necessarily passes by a rigorous management of the class. Moreover, with difficult pupils, it is essential to make place "classifies" a space of exchanges, of confidence. Lastly, the various working methods of the teacher must take into account the difficulties of the pupils so that they can cure and become autonomous it. MOTS CLÉS 1/Climat de classe 2/ autorité 3/ respect 4/ motivation 5/ autonomie SOMMAIRE INTRODUCTION 4 CHAPITRE 1 UNE CLASSE QUI NE SE MET PAS AU TRAVAIL 1.1. Une mauvaise ambiance de classe 6 1.1.1. Le bruit 6 1.1.2. L’agressivité 7 1.2. Les causes 9 1.2.1. L’extra scolaire : un environnement social difficile 9 1.2.2. L’intra scolaire : un vécu scolaire insatisfaisant 11 1.3. Les conséquences 13 CHAPITRE 2 CREER DES CONDITIONS FAVORABLES A L’APPRENTISSAGE 2.1. Le temps de l’introspection 14 2.1.1. Laxisme ou autocratie ? 14 2.1.2. Qu’est –ce que l’autorité ? 15 2.2. Premières applications: améliorer la gestion de classe. 16 2.2.1. Apaiser les tensions entre les élèves. 17 2.2.2. Etablir un code de conduite. 18 2.3. Eduquer et transmettre un savoir : les enjeux de la communication orale. 20 2.3.1. Comment parler ? 20 2.3.2. Apprendre à écouter et écouter pour apprendre. 22 CHAPITRE 3 REMOTIVER LES ELEVES 3.1. La relation enseignant/apprenant : une relation de confiance 26 3.1.1. Quand les apprenants ont confiance en l’enseignant 26 3.1.2. Quand l’enseignant redonne confiance aux apprenants 28 3.2 Donner du sens à ce que l’on fait. 31 3.2.1. « Des projets, des objectifs pour être motivé » 31 3.2.2. Des objectifs pour la lecture 31 3.2.3. Souligner l’enchaînement logique des séances. 32 3.3 Eviter l’ennui. 33 3.3.1. Mettre de la diversité dans le projet pédagogique. 33 3.3.2. Varier les activités au cours de la séance. 34 3.3.3. Varier les supports. 35 CONCLUSION 36 BIBLIOGRAPHIE DOCUMENTS ANNEXES INTRODUCTION Au cours des quelques semaines précédant ma première rentrée scolaire en tant que professeur, je ne me suis pas posée de questions sur le rôle de l’enseignant. Je pensais que ma fonction ne se limiterait qu’à l’unique transmission des savoirs et des savoir-faire à une classe d’un niveau donné. La confrontation à la réalité a fait tomber cette idée préconçue. Cette prise de conscience a été d’autant plus rude que j’ai eu affaire à une classe difficile. Difficile en ce sens où bon nombre d’entre eux n’ont montré aucune appétence au travail, mais ont été particulièrement enclins à l’agitation et aux bavardages. C’est donc par la mise en œuvre de diverses actions pour renverser cette tendance que se justifie l’objet de ce mémoire professionnel : « Comment mettre les élèves au travail ? » La polysémie du mot « éducation » éclaire la démarche adoptée. En effet, en tant que professeurs, nous appartenons au Ministère de l’Education Nationale. Or comme son nom l’indique, le pôle essentiel de notre fonction est l’éducation. Pour saisir les divers enjeux de notre mission, commençons par définir le terme : EDUCATION n.f. 1 Mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d’un être humain → instruction. 2 Développement méthodique (d’une faculté, d’un organe) → exercice. L’éducation de la mémoire 3 Connaissance et pratiques des usages de la société.→ politesse, savoir-vivre.1 Si l’on s’en tient à cette définition, la mission de l’enseignant est donc de dispenser un savoir (« instruire », sens 1), de développer des savoirs et des savoir-faire de l’élève (sens 2) et enfin de l’initier aux codes de la société (sens 3), en le formant à la citoyenneté. Concrètement dans la classe, pour remplir ces trois missions que sous-tend le terme « éducation », quelles sont les compétences attendues de l’enseignant ? La maîtrise de sa discipline et l’autorité. Ces deux pôles ne sont, par ailleurs, que les deux aspects d’un même acte pédagogique que « la contrainte d’instauration et de maintien d’un ordre minimal dans la classe, condition de possibilité de toute activité de formation, et le souci de faire que chaque 1 Le petit Robert, dir. J. REY-DEBOVE et A. REY, Paris, dictionnaires le Robert, 2000. séquence soit l’occasion de réels apprentissages pour un maximum d’élèves dans l’ordre de la discipline d’enseignement »2. Dans cette perspective, la démarche que j’ai adoptée, lie autorité et matière enseignée autour de la question : comment mobiliser les élèves dans leurs apprentissages ? Dans ma pratique professionnelle, la réflexion s’est amorcée par un temps d’observation et par une recherche des différentes causes pouvant expliquer le rejet de certains élèves du travail. Mon analyse s’est articulée en deux temps. Je me propose, tout d’abord, de développer les diverses tentatives mises en place en vue de l’établissement d’un cadre propice à l’apprentissage, puis d’exposer les différentes démarches qui ont eu pour objectif de donner aux élèves l’envie d’apprendre. 2 Davisse (A.) & Rochex (J.Y.), « Pourvu qu’ils m’écoutent… », discipline et autorité dans la classe, Paris, 1997, p.176. CHAPITRE 1 UNE CLASSE QUI NE SE MET PAS AU TRAVAIL 1.1. Une mauvaise ambiance de classe. La 5ème 1 m’a été présentée, dès le début de l’année, par le Principal de l’établissement, M. Montès, comme une classe difficile. Il ne m’a fallu qu’une semaine pour vérifier cette mise en garde : le 9 septembre, j’ai compris que l’année qui m’attendait allait être rude. En effet, j’été très vite confrontée à des perturbations liées à différents types d’indiscipline qui, associés, ont fortement troublé mes premières séances. 1.1.1. Le bruit Le premier est bien sûr le bruit. Les bavardages, dans un premier temps, se faisaient entendre dans le fond de la salle et n’avaient aucun lien avec l’objet du cours. Cette première « dérégulation »3 est progressivement devenue brouhaha. Au cours de ces séances, je n’avais pas conscience du bruit, comme me l’a, à juste titre, fait remarquer ma tutrice. Je continuais donc tout naturellement le cours, m’adressant à ceux qui consentaient à m’écouter. Les réflexions concernant la séance, se perdaient dans le bruit des bavardages, voire étaient elles- mêmes perturbatrices. En effet, la règle selon laquelle on lève le doigt, n’était que très peu respectée ; celle selon laquelle on écoute celui qui parle était encore moins suivie, inquiétant désintérêt pour la parole de l’autre. J’ai donc mené des séances dans un désordre qu’à présent je juge épouvantable. Cependant, de cette mauvaise gestion de la parole de ma part ont découlé d’autres problèmes de discipline qui allaient installer dans mes cours des attitudes néfastes au bon fonctionnement de la classe. Dès le début de l’année, je n’avais pas su repérer les comportements perturbateurs et les élèves y ont vu un excès de permissivité. Ils en ont par conséquent abusé. Par ailleurs, trop souvent jusque là, j’ai commis l’erreur de sermonner toute la classe, sans grande efficacité d’ailleurs, ou de punir sans avoir réellement observé ma classe. En effet, les élèves agités pouvaient rester une heure durant dans un état d’excitation intense alors que les quelques élèves calmes s’énervaient, d’une part parce qu’ils arrivaient difficilement à suivre 3 Terme emprunté à J.F. Blin, Classes difficiles, des outils pour prévenir et gérer les perturbations scolaires, Delagrave Ed., 2004. le cours et, d’autre part, parce qu’ils avaient droit à mes remontrances au même titre que les autres. Cette excitation, parfois poussée à l’énervement, est rapidement devenue agressivité. 1.1.2 L’agressivité - Violence physique et violence verbale. Cette première réaction s’explique par le sentiment d’injustice que j’ai fait naître chez mes élèves, lorsque je les ai sermonnés. Après avoir puni un élève, il m’est arrivé d’entendre: « Si toute la classe parle, pourquoi suis-je le seul à être puni? Pourquoi moi plus qu’un autre ? » Au cours de la réunion parents/professeurs qui s’est tenue au mois de novembre, la maman de Yannick L. m’a fait remarquer ce premier aspect. En effet la veille, son fils avait été puni pour « bavardages intempestifs ». Une fois rentré chez lui, le motif de la punition invoqué par l’élève en question fa été « c’est parce que la prof. ne m’aime pas ». Ce sentiment a généré des rancœurs à mon égard. J’ai pu constater que leur raisonnement ne tient qu’en cette simple dichotomie « elle uploads/Management/ mettre-la-classe-au-travail-entre-autorite-et-pedagogie.pdf
Documents similaires










-
80
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 05, 2021
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 1.1604MB