Unité d’apprentissage 1 LINGUISTIQUE ET PRAGMATIQUE SOMMAIRE 1.1. Une linguisti
Unité d’apprentissage 1 LINGUISTIQUE ET PRAGMATIQUE SOMMAIRE 1.1. Une linguistique de la langue 1.2. Une linguistique de la parole 1.3. Domaines de la linguistique 1.4. Types de pragmatique OBJECTIFS Identifier l’objet d’étude de la linguistique. Maîtriser l’utilisation des concepts linguistiques fondamentaux. Distinguer la place de la pragmatique dans la linguistique. Identifier les types de pragmatique. 1.1. Une linguistique de la langue La linguistique, par son double objet - elle est science du langage et science des langues - pose la distinction entre langage/ langue. Le langage, faculté humaine, caractéristique universelle et immuable de l’homme, se constitue en objet distinct des langues, toujours particulières et variables, en lesquelles se réalise le langage. La linguistique s’occupe des langues, elle est d’abord la théorie des langues. Les linguistes contemporains s’accordent pour considérer Ferdinand de Saussure comme le fondateur de la linguistique moderne. Son livre posthume, Cours de linguistique générale, publié en 1916 d’après les notes de quelques étudiants, a marqué la naissance de la linguistique comme science. Saussure fonde la nouvelle science qu’il institue sur des distinctions : a) Entre l’objet de la linguistique et sa matière ; la matière de la linguistique c’est l’ensemble des manifestations du langage, insaisissables dans leur totalité, en raison de leur diversité et leur hétérogénéité. L’objet de la linguistique est « construit » par le linguiste, à partir du point de vue qu’il choisit d’adopter, pour s’intéresser à tel ou tel aspect de la matière. Si la matière est donnée d’avance, l’objet, lui, résulte de décisions. « La linguistique a pour unique et véritable objet la langue envisagée en elle-même et pour elle-même. » (Saussure, 1916/1998 : 317) b) Entre la structure et les relations ; la linguistique envisage les faits à décrire sous l’angle de leur structure, en isolant et décrivant les relations internes régulières qui en relient les éléments. c) Entre la structure et le système ; le principe fondamental de la linguistique moderne, installé par Saussure à travers les deux termes clé système et structure, est exprimé par le postulat : La langue forme un système. La langue est un arrangement systématique de parties. Elle se compose d’éléments formels articulés en combinaisons variables, d’après certains principes de structure : « des types particuliers de relations articulant les unités d’un certain niveau ». (op. cit.) d) Entre le fait et la relation ; Saussure remplace la notion positiviste du fait linguistique par celle de relation. Une langue ne comporte jamais qu’un nombre réduit d’éléments de base qui se prêtent à un grand nombre de combinaisons. Chacune des unités d’un système se définit ainsi par l’ensemble de relations qu’elle soutient avec les autres unités, et par les oppositions où elle entre ; c’est une entité relative et oppositive. Les entités linguistiques ne se laissent déterminer qu’à l’intérieur du système qui les organise et les domine, les unes par rapport aux autres ; elles ne valent que par rapport à la structure. e) Entre le signe, le signifiant, le signifié ; Saussure rejette la notion de mot au profit de celle de signe : Le véritable objet de la linguistique est l’étude, interne et synchronique des systèmes de signes que constituent les états de langue. (Saussure, 1916/1998 : 124) Selon Saussure, le signe linguistique unit non une chose et un nom, mais un concept et une image acoustique, qui sont, pour lui, des entités psychiques, non matérielles. Saussure préfère les termes signifiant (pour image acoustique) et signifié (pour concept). Le signe linguistique se caractérise par trois propriétés essentielles : il présente deux faces indissociables : pour rendre évidente la relation entre le signifié et le signifiant Saussure utilise la métaphore de la feuille de papier : tout comme on ne peut découper le recto sans découper en même temps le verso d’une feuille, on ne peut pas dissocier le signifiant du signifié ; il est arbitraire : la relation entre le signifiant et le signifié est conventionnelle, elle n’est motivée par aucune relation nécessaire de cause à effet. Elle possède cependant un caractère contraignant : à partir du moment où l’on s’est entendu d’appeler un chat un chat, on est contraint d’utiliser ce mot pour se faire entendre ; il est linéaire : le signifiant, inscrit dans le temps, présente un caractère linéaire ; ses éléments se présentent successivement. Par contre, les signes sémiotiques peuvent coexister dans le temps et dans l’espace, comme par exemple, les panneaux du code de la route. A partir des caractéristiques du signe, Saussure formule deux principes essentiels de la linguistique structurale : le principe de l’arbitraire du signe et celui de la linéarité du signifiant. Le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire, il est immotivé, donc conventionnel. Il n’y a aucune motivation dans l’union du concept « table » et de l’image acoustique, sonore qui le rend perceptible à l’esprit. f) Entre la langue et la parole ; Selon Saussure, le langage se compose de la langue et de la parole. Dans l’ensemble des manifestations du langage, on sépare donc ce qui relève de l’action individuelle, variable, unique, imprévisible, que Saussure nomme la parole, de ce qui est constant, commun aux sujets parlants, la langue. Opposée à la parole, la langue est un phénomène social, un code commun à tous les membres d’une communauté linguistique ; elle est essentielle, nécessaire à la parole, qui lui est subordonnée. Dans la dynamique de cette relation langue -parole, c’est à partir de la parole qu’on arrive à constituer la langue et c’est la parole qui, dans le long terme, est responsable des changements qui surviennent dans la langue. Le linguiste français Emile Benveniste reprendra plus tard la même idée : d’après lui, le langage représente la forme la plus haute d’une faculté qui est inhérente à la condition humaine, la faculté de symboliser. C’est la faculté de représenter le réel par un signe et de comprendre le signe comme représentant le réel, donc d’établir un rapport de « signification » entre quelque chose et quelque chose d’autre. Pour E. Benveniste, comme pour Saussure, la linguistique est « une théorie de la langue comme système de signes et comme agencement d’unités hiérarchisées » : « Une forme linguistique constitue une structure définie : 1) c’est une unité de globalité enveloppant des parties ; 2) ces parties sont dans un arrangement formel qui obéit à certains principes constants ; 3) ce qui donne à la forme le caractère d’une structure est que les parties constituantes remplissent une fonction ; 4) enfin ces parties constitutives sont des unités d’un certain niveau, de sorte que chaque unité d’un niveau défini devient sous-unité du niveau supérieur. » (Benveniste, 1966, I : 21- 23) 1.2. Une linguistique de la parole Dans son Cours de linguistique générale, Saussure exprime l’idée qu’on pourrait avoir deux linguistiques : une linguistique proprement dite, de la langue, et une autre, secondaire, de la parole : « L’étude du langage comporte deux parties : l’une, essentielle, a pour objet la langue, qui est sociale et indépendante de l’individu ; cette étude est uniquement psychique ; l’autre, secondaire, a pour objet la partie individuelle du langage, c'est-à-dire la parole y compris la phonation : elle est psychophysique. (…) On peut, à la rigueur, conserver le nom de linguistique à chacune de ces deux disciplines et parler d’une linguistique de la parole. Mais il ne faudra pas la confondre avec la linguistique proprement dite, celle dont la langue est l’unique objet. » (Saussure, 1916/1998 : 37-38) La linguistique de la parole, considérée comme secondaire, prend en compte l’exploitation individuelle de la langue, en s’intéressant à sa vocation discursive ; elle évoluera vers les développements pragmatiques, se détachant ainsi de la linguistique de la langue. On arrive ainsi à identifier une ligne de partage entre les linguistiques non pragmatiques et les linguistiques pragmatiques, par la prise en compte des situations ordinaires de la communication humaine (Eluerd, 1985). Cette ligne de partage marque la différence entre plusieurs types d’analyse : A) Analyses non pragmatiques : des analyses linguistiques d’un premier type : elles distinguent la langue, code intériorisé ou non, de ses utilisations ordinaires dans chaque acte particulier de communication, c’est-à-dire la parole. Ces analyses sont clairement non pragmatiques. B) Analyses pragmatiques : des analyses d’un second type : elles se situent dans la zone où la langue « devient » parole pour interroger les procédures de ce passage à l’énonciation, à l’aide des traces qu’il laisse dans l’énoncé. Elles recouvrent le champ des analyses dites du discours ou de l’énonciation ; des analyses d’un troisième type : elles essaient d’aborder le langage dans ces usages ordinaires, refusent le postulat du dispositif langue/parole et s’interrogent sur l’émergence de la langue dans et par la communication elle-même. Ce sont des analyses pragmatiques. Les linguistiques pragmatiques remettent en cause : 1) La linguistique du code : la pragmatique prend en compte non seulement la langue, cet objet abstrait, mais aussi ses réalisations concrètes, résultant du processus par lequel les individus uploads/Management/ unite-pragmatique.pdf
Documents similaires







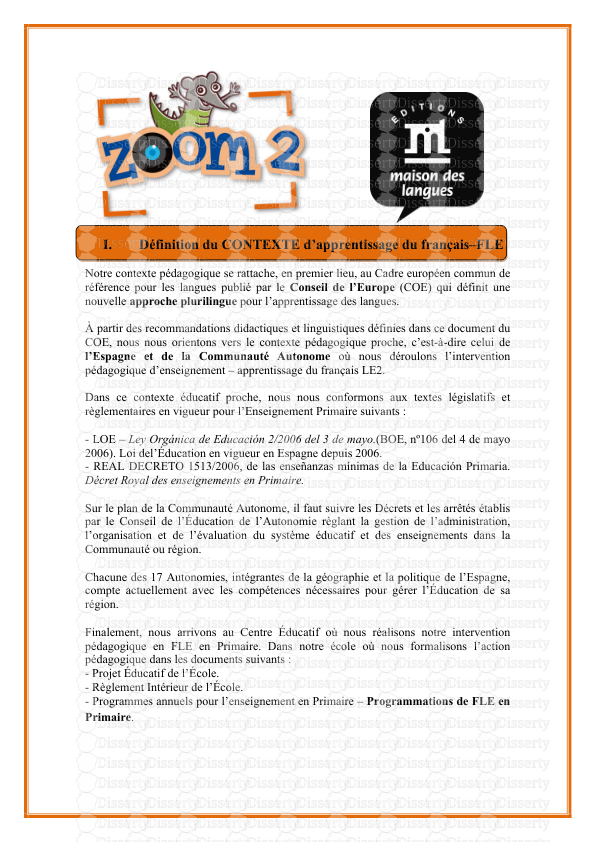


-
56
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 19, 2021
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 0.3334MB


