DE L'ÂME À LA PSYCHÉ Lou Andreas-Salomé et la question de la nature humaine Isa
DE L'ÂME À LA PSYCHÉ Lou Andreas-Salomé et la question de la nature humaine Isabelle Mons Société d'études soréliennes | Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle 2004/1 - n° 22 pages 217 à 234 ISSN 1146-1225 Article disponible en ligne à l'adresse: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.cairn.info/revue-mil-neuf-cent-2004-1-page-217.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pour citer cet article : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mons Isabelle, « De l'âme à la psyché » Lou Andreas-Salomé et la question de la nature humaine, Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle, 2004/1 n° 22, p. 217-234. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distribution électronique Cairn.info pour Société d'études soréliennes. © Société d'études soréliennes. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit. Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 78.155.0.45 - 11/03/2014 14h40. © Société d'études soréliennes Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 78.155.0.45 - 11/03/2014 14h40. © Société d'études soréliennes ISABELLE MONS Lorsque Lou Andreas-Salomé 1 rencontre Sigmund Freud en septembre 1911, au IIIe Congrès international de psychanalyse à Weimar, elle est sur le seuil d’une vie consacrée à l’analyse clinique de l’être humain. Son nom, souvent accompagné de celui de Friedrich Nietzsche ou du poète Rainer Maria Rilke, est connu dans les cercles philosophiques et littéraires en Allemagne, en Autriche et en France. De Saint-Pétersbourg, sa ville natale, à Zurich où elle fréquente l’une des premières universités ouvertes aux femmes, depuis sa rencontre avec Nietzsche à Rome, en 1882, jusqu’à Berlin, Vienne et Paris, elle parcourt l’Europe du tournant du siècle, dotée d’un triple patrimoine linguistique (russe, français et allemand). Au- delà de l’histoire des femmes, son œuvre appartient à l’histoire des idées et à l’univers de la psychanalyse. Figure charismatique de la femme fin de siècle, Lou Andreas-Salomé est critique, essayiste, dia- riste, biographe, épistolière et romancière. Elle est surtout l’une des premières intellectuelles à établir un lien entre les disciplines : les lettres (pensée nietzschéenne et Lebensphilosophie, poésie rilkéenne, théâtre naturaliste), les arts (peinture, sculpture), les religions (leur histoire et leurs différences) répondent aux sciences (psychologie, De l’âme à la psyché Lou Andreas-Salomé et la question de la nature humaine 217 1. L’œuvre de Lou Andreas-Salomé (1861-1937), femme de lettres et psychana- lyste, est restée longtemps méconnue. L’intérêt croissant de la critique européenne et nord-américaine permet d’espérer une meilleure reconnaissance lorsque Dorothee Pfeiffer, responsable des archives privées de Göttingen, achèvera le dépôt des manus- crits aux archives littéraires allemandes de Marbach (Deutsches Literaturarchiv). ÉTUDES Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 78.155.0.45 - 11/03/2014 14h40. © Société d'études soréliennes Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 78.155.0.45 - 11/03/2014 14h40. © Société d'études soréliennes 218 biologie, entomologie, zoologie, psychanalyse). Lou Andreas- Salomé les rassemble pour leur complémentarité autour du thème de l’humain (der Mensch), apportant ainsi une interprétation nouvelle de l’époque de la modernité. Défini comme le sujet d’une réflexion critique ou esthétique sur l’existence individuelle, soumise aux conséquences de la modernisation technique et sociale, l’homme moderne acquiert, dans son œuvre, une identité liée à la notion d’origine. Il est, selon Michel Foucault, « cet homme assignable en son existence corporelle, laborieuse et parlante 2 » qui, au cœur de « l’ère de l’illusion », traverse une singulière crise de l’identité : Paul Ricœur voit en Nietzsche, Marx et Freud, les « trois maîtres du soupçon », ceux qui la dénoncent 3. Le débat anthropologique trouve, dans l’œuvre d’Andreas-Salomé, un écho philosophique, lit- téraire et scientifique. Durant plus de cinquante années, elle va apprendre les notions de la psychologie nietzschéenne et de la théo- rie psychanalytique : sa définition de l’être humain repose sur l’ana- lyse du langage intérieur lorsqu’il reflète les maux de l’âme, perçus par l’analyste comme des troubles psychiques. L’évolution de la terminologie ne modifie pas le fond même de la question de l’homme. À Londres, en 1913, Pierre Janet 4 relève au XVIIe Congrès international de médecine que les termes utilisés par les psychanalystes pour désigner, par exemple, le fait sexuel signifient tout autant l’élan vital des métaphysiciens. En introduisant son essai « Psychosexualité » par cette remarque du psychologue français 5, Lou Andreas-Salomé confirme l’orientation qu’elle donne à son écriture philosophique et romanesque depuis sa rencontre avec les pionniers de la psychanalyse ; elle prouve aussi la complémentarité des disciplines lorsqu’il s’agit d’étudier la nature profonde de l’humain, et cristallise autour de ce thème de nombreuses problé- matiques de son époque. Elle dépasse ainsi, fort heureusement, la polarité masculin-féminin, cadre réducteur dans lequel l’écriture de 2. Michel Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1966, p. 329. 3. Paul Ricœur, Le conflit des interprétations. Essais d’herméneutique, Paris, Éd. du Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 1969, p. 149. 4. Élève de Jean Charcot, Pierre Janet (1859-1947) annonce à l’occasion de ce congrès que S. Freud et J. Breuer seraient débiteurs de sa théorie de l’analyse psy- chologique, ce qui lui vaudra les foudres des psychanalystes viennois. 5. Lou Andreas-Salomé, « Psychosexualité » (1917), in Eros, trad. d’Henri Plard, Paris, Éd. de Minuit, 1984, p. 131. Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 78.155.0.45 - 11/03/2014 14h40. © Société d'études soréliennes Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 78.155.0.45 - 11/03/2014 14h40. © Société d'études soréliennes 219 femmes-écrivains est souvent enfermée. Ses textes biographiques et les essais psychanalytiques, sa critique littéraire, une vaste corres- pondance et les journaux posthumes 6 contribuent à définir l’être du tournant du siècle sans se limiter à être le miroir des grandes théories. Andreas-Salomé bâtit sa propre pensée sur l’humain à partir d’une interprétation des philosophes, poètes, théologiens et scientifiques qu’elle a souvent côtoyés et répond à la question anthropologique en réunissant les disciplines : philosophie, littérature et psychanalyse. De la philosophie de la vie à la métapsychologie Entre 1871 et 1914, l’Europe, catalysateur de contradictions, est une mosaïque de pays qui voient l’émergence de nationalités et bien- tôt l’affrontement des nationalismes. Les années 1900 marquent un tournant dans l’existence de Lou Andreas-Salomé, alors reconnue dans les cercles intellectuels pour avoir écrit avec succès la première étude sur Nietzsche 7 dont elle fut la disciple. À cette époque, elle adhère au courant de pensée post-nietzschéen centré autour du prin- cipe de « vie ». La définition de la « philosophie de la vie » (Lebens- philosophie) repose, en allemand, sur une terminologie précise : « vivre », dans le sens de leben, traduit l’idée de vie comme action extérieure à un moi agissant ; « vivre », dans le sens de erleben, exige un sujet qui « vive la vie ». Tandis que le phénomène vital se présente comme un cycle déterminé par des lois biologiques fixes, il apparaît aux contemporains d’Andreas-Salomé, critiques de la théorie kan- tienne et successeurs de Nietzsche, comme un progrès imprévisible auquel le discours métaphysique peut apporter une interprétation nouvelle. La question kantienne « Qu’est-ce que l’homme ? » fonde la pensée anthropologique du XIXe siècle. Kant relance le débat sur la nature humaine définie, avant lui, selon une conception métaphy- 6. Pour ne citer que quelques ouvrages, Ma vie. Esquisse de quelques souvenirs, trad. de D. Miermont et B. Vergne, Paris, Puf, 1986, ou L’amour du narcissisme. Textes psy- chanalytiques, trad. d’I. Hildenbrand, Paris, Gallimard, 1980, enfin Fénitchka, suivi de Une longue dissipation, trad. de N. Casanova, Paris, Éd. Des Femmes, 1987. Voir Isabelle Mons, Lou Andreas-Salomé et l’anthropologie de son temps, thèse de doctorat, Paris, Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle, 2003. 7. Lou Andreas-Salomé, Friedrich Nietzsche à travers ses œuvres (1894), trad. de J. Benoist-Méchin, Paris, Grasset, 3e éd. 2000 (1re éd. 1932). Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 78.155.0.45 - 11/03/2014 14h40. © Société d'études soréliennes Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 78.155.0.45 - 11/03/2014 14h40. © Société d'études soréliennes 220 sique, ou d’après la psychologie médicale dite « expérimentale ». Ces deux directions données de manière indépendante à un seul et même sujet – celui de l’être humain – se rejoignent lorsqu’en 1798, le débat anthropologique connaît un tournant avec la publication de L’anthropologie d’un point de vue pragmatique. Le kantisme crée une anthropologie d’orientation philosophique dont Andreas-Salomé prend connaissance durant son adolescence à Saint-Pétersbourg. Dans la juste continuité de la philosophie des Lumières, l’être doué de raison s’élève, dans l’Europe des années 1880, à un stade supé- rieur d’humanité, sous l’impulsion du scepticisme nietzschéen et schopenhauérien. La connaissance et la recherche de la vérité for- ment le socle de la philosophie de la vie. Le ich en est le fondement : il connaît en allemand cette double signification, je et moi, sur laquelle la tradition philosophique et scientifique du je sujet est uploads/Philosophie/ de-l-x27-ame-a-la-psyche-lou-andreas-salome-et-la-question-de-la-nature-humaine-isabelle-mons-dans-mil-neuf-cent-revue-d-x27-histoire-intellectuelle-20041-n0-22.pdf
Documents similaires








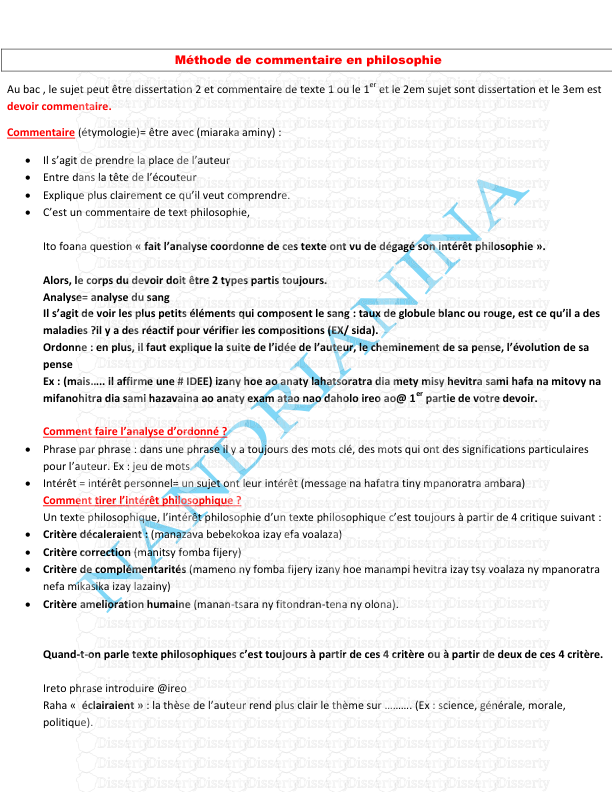

-
70
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 19, 2021
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1776MB


