L’HISTOIRE DU BOUDDHISME Le bouddhisme, qu'il s'agisse d'une religion, d'une ph
L’HISTOIRE DU BOUDDHISME Le bouddhisme, qu'il s'agisse d'une religion, d'une philosophie ou d'une pratique souvent centrée sur la méditation, fut fondé par Siddhartha Gautama. Celui-ci naît environ en - 556 du calendrier julien en Inde et sa doctrine se diffusera plus largement deux siècles plus tard. Le bouddhisme est une des plus anciennes religions encore largement pratiquées de nos jours. Se développant progressivement en dehors de sa région d'origine, l'Inde du nord-est, il a touché à une époque ou à une autre la quasi-totalité du continent asiatique, s'enrichissant d'éléments issus des cultures d'Asie centrale, d'Extrême-Orient, d'Asie du Sud-Est, ainsi que des cultures hellénistique et himalayenne. Malgré des premiers contacts avec l'Europe à l'époque du gréco- bouddhisme, ce n'est qu'au XIXe siècle que les lettrés européens ont commencé à s'y intéresser sérieusement, mais en relayant une vision parfois biaisée du bouddhisme en Occident. Au XXIe siècle, bien que la grande majorité des bouddhistes résident toujours en Asie, on en trouve sur tous les continents, qu'ils soient autochtones ou issus de l'émigration asiatique. Au fil du temps, de nombreuses écoles sont apparues. Le bouddhisme actuel peut être divisé en trois grands courants : Theravāda, Mahāyāna et Vajrayāna. Le terme « bouddhisme », d'invention occidentale, est communément utilisé pour désigner, d'une façon quelque peu approximative, le « Dharma (enseignement, doctrine) du Bouddha », soit buddhadharma en sanskrit, buddhaśāsana en pali, fójiào en chinois, bukkyō en japonais, nang pa sangs rgyas pa'i chos en tibétain77,78. Dharma Article détaillé : Dharma. Le Dharma (ou « Loi ») est l'ensemble des enseignements donnés par le Bouddha, qui forment le Canon pali. Toutefois, le terme est polysémique, et il peut signifier « ce qui est établi », « la loi naturelle », « la loi juridique », « le devoir », « l'enseignement » voire « l'essence de toute chose » ou « l'ensemble des normes et lois, sociales, politiques, familiales, personnelles, naturelles ou cosmiques. ». On utilise souvent aussi le mot pali śāsana. En sanskrit, le mot signifie « enseignements, système religieux dans un lieu et à une époque donnés (angl. dispensation) », au sens des enseignements spécifiquement conçus historiquement comme une religion institutionnalisée, ce qu'en Occident on appelle « bouddhisme »79. Dans les commentaires pali, ce mot peut sur trois types d'enseignement — dans l'ordre, ceux sur « l'étude des écritures », sur « la pratique » et sur « la réalisation », ceux qui laisse entendre que les textes sont le fondement de l'enseignement du Bouddha, et que sans eux il ne peut y avoir de pratique de l'octuple chemin, et donc pas non plus de réalisation79. BAHATI KISENGWA BEYA BARUANI MANIALE KOMBA BARAKA INYONGO KEMBIA VALIRE EXPOSE DE RELIGION 4/10/2022 « La mise en mouvement de la roue de la Loi », le Dharmacakra Pravartana Sūtra, est le premier sermon du Bouddha, donné après qu'il eut atteint l'éveil80. Trois joyaux Symbole des Trois Joyaux. Au dessous, en sanskrit, le mantra om namo ratna trayaya (Om Louange au Trois Joyaux). Peinture sur toile. Dans le bouddhisme, « prendre refuge dans les trois joyaux », le Bouddha, le Dharma (l'ensemble des enseignements) et le Sangha (l'ensemble des pratiquants, voir plus bas), est une cérémonie par laquelle on devient bouddhiste. Quatre nobles vérités Article détaillé : Quatre nobles vérités. Les quatre nobles vérités indiquent ce qu'il est essentiel de savoir pour un bouddhiste. Elles énoncent le problème de l'existence, son diagnostic et le traitement jugé adéquat : 1. La vérité de la souffrance (duhkha): toute vie implique la souffrance, l'insatisfaction ; 2. La vérité de l'origine de la souffrance : elle repose dans la soif (tṛṣṇā) : le désir, les attachements ; 3. La vérité de la cessation de la souffrance : la fin de la souffrance est possible ; 4. La vérité du chemin : le chemin menant à la fin de la souffrance est la voie médiane, qui suit le Noble Chemin octuple. Trois caractéristiques de l'existence Les trois caractéristiques ou marques de l'existence, trilakshana81 (du sanskrit : lakṣaṇa ; pali : lakkhaṇa ; « marque »82) sont : • Anātman (absence de soi, impersonnalité) : il n'y a rien dans le monde qui ait une existence indépendante et réelle en soi, donc aucune âme (ātman), aucun soi, mais une simple agrégation de phénomènes conditionnés. • Anitya (impermanence) : tout est constamment changeant dans les phénomènes, on ne peut absolument rien y trouver de permanent. • Duḥkha (souffrance) : aucun phénomène ne peut nous satisfaire de manière ultime et définitive83. Ces trois caractéristiques de l'existence conditionnée se retrouvent dans les quatre sceaux de la philosophie bouddhiste84. Elles sont valides en tout temps et en tout lieux, et peuvent être appréhendées par une vision directe de la réalité. Le nirvāṇa, n'étant pas conditionné, échappe aux caractéristiques de souffrance et d'impermanence (il est cependant impersonnel, il n'y a donc « personne » en nirvāṇa). Trois poisons Article détaillé : Trois Poisons. Le bouddhisme considère qu'il existe trois poisons pour l'esprit : • tṛṣṇā : la soif ou l'avidité ; • dveṣa : la colère ou l'aversion ; • moha : l'ignorance. Certaines écoles en ajoutent deux : la jalousie et l'orgueil. Selon le Bouddha, les causes de la souffrance humaine peuvent être trouvées dans l'incapacité à voir correctement la réalité. Cette ignorance, et les illusions qu'elle entraîne, conduisent à l'avidité, au désir de posséder davantage que les autres, à l'attachement et à la haine pour des personnes ou des choses. Sa philosophie affirme que la souffrance naît du désir ou de l'envie. C'est en s'en libérant qu'il serait parvenu au nirvāṇa. Roue de l'existence karmique. Sculpture rupestre de Dazu, Chine. Entre 1180 et 1250. Hauteur 8 m. Renaissances Article détaillé : Réincarnation bouddhiste. À cause des trois poisons et de l'interdépendance, les hommes sont assujettis au Saṃsāra (le cycle des renaissances). Le « monde » (Loka) dans lequel ils renaîtront après leur mort dépendra de leur karma, c'est-à-dire de leurs actions passées. Cette renaissance ne fait donc que prolonger indéfiniment la souffrance (« la fatigue de remplir les cimetières » dit l'Assu Sutta85). Conformément à la philosophie bouddhiste, ce n'est ni le même, ni un autre qui renaît. Ce n'est donc pas, comme dans le principe de la réincarnation, une âme immortelle qui se « réincarne ». En effet, la notion de réincarnation implique l’existence d’une âme immortelle qui entre et sort d’un corps et entre à nouveau dans un autre, mais, selon la croyance bouddhiste, il n’existe rien de tel. Le Bouddha propose de se réveiller de ce cauchemar, de chasser la confusion et l'illusion pour être illuminé par la réalité. Ainsi, la souffrance et le cycle karmique seraient brisés. Il définit le « but ultime » de son enseignement comme étant « la délivrance », le « dénouement », « la libération de la souffrance » ou nirvāṇa. Douze liens interdépendants Pagode du temple Horyu-ji, Japon. Article détaillé : Coproduction conditionnée. Les douze liens interdépendants décomposent le cycle des renaissances selon des liens conditionnés dépendant l'un de l'autre. 1. L’ignorance (avidyā) : L’ignorance de la loi de cause à effet et de la vacuité. L'ignorance produit le karma. 2. Le karma (les saṃskāras) : Somme des actions (conditionnées) du corps, de la parole, et de l'esprit, qui produisent la conscience. 3. La conscience (vijñāna) : La conscience produit le nom et la forme. 4. Le nom et la forme (nāmarūpa) : Le nom et la forme produisent les six sens. 5. Les six sens (ṣaḍāyatana) : Les six sens (toucher, odorat, vue, ouïe, goût, mental) permettent l'apparition du contact. 6. Le contact : Des six sortes de contacts (tactile, odorant, visuel, auditif, gustatif, mental) découlent les 6 sensations. 7. La sensation (vedanā) : Les sensations agréables produisent l'attachement (désir ou soif). 8. La soif (tṛṣna) : Le désir d'obtenir des sensations agréables produit la saisie, l'attachement. 9. La saisie (upādāna) : Appropriation des objets désirables qui produit le devenir. 10. Le devenir (bhava) : L'appropriation par la saisie produit la force du devenir, qui conduit à la (re-) naissance. 11. La naissance (jāti) : La naissance est la condition qui produit vieillesse et mort. 12. La vieillesse et la mort (jarāmaraṇa) : La vieillesse et la mort sans pratique de libération n'éliminent pas l'ignorance. Noble Chemin Octuple Article détaillé : Noble Chemin octuple. Roue du Dharma. Ses huit rayons symbolisent les huit membres du sentier octuple. Bronze, Période Kamakura, vers 1200, Japon. Musée national de Tokyo. Les huit membres du noble sentier octuple (ariyāṭṭaṅgika magga) sont : 1. la compréhension juste (Sammā diṭṭhi), 2. la pensée juste (Samnā saṅkappa), 3. la parole juste (Sammā vācā), 4. l'action juste (Sammā kammanta), 5. le mode de vie juste (Sammā ājiva), 6. l'effort juste (Sammā vāyāma), 7. l'attention juste (Sammā sati), 8. la concentration juste (Sammā samādhi). Au lieu de « juste » on lit parfois « complet » ou « total ». Quatre incommensurables Article détaillé : Quatre Incommensurables. Les quatre conduites ou sentiments pieux (brahmavihāra en sanskrit et pali) sont aussi appelés les Quatre Incommensurables uploads/Philosophie/ expose-de-rel 1 .pdf
Documents similaires


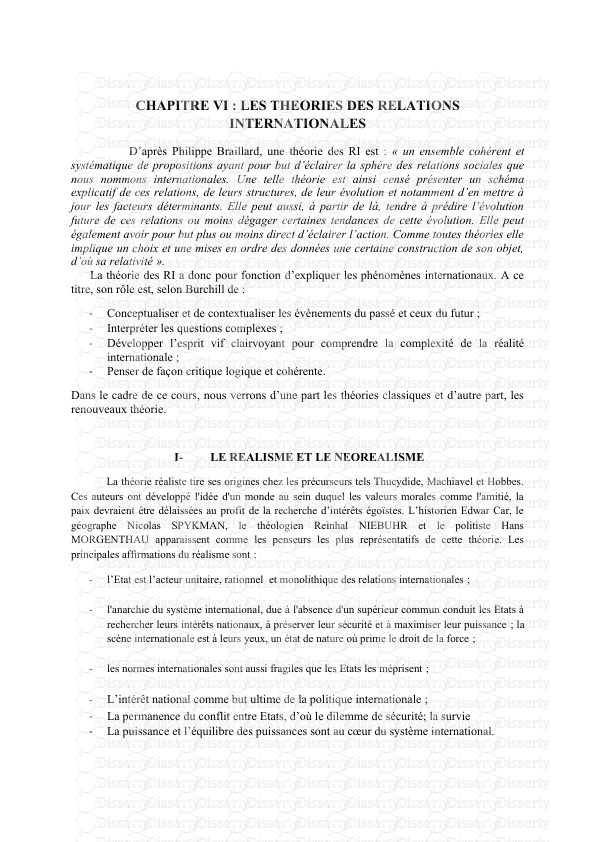







-
34
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 08, 2021
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.4681MB


