Le sens du signifiant. Implications linguistiques et cognitives de la motivation
Le sens du signifiant. Implications linguistiques et cognitives de la motivation Philippe Monneret To cite this version: Philippe Monneret. Le sens du signifiant. Implications linguistiques et cognitives de la mo- tivation. Honor´ e Champion, 13, 2003, Biblioth` eque de grammaire et de linguistique, Olivier Soutet, 2-7453-0763-0. HAL Id: hal-01084395 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01084395 Submitted on 19 Nov 2014 HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of sci- entific research documents, whether they are pub- lished or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destin´ ee au d´ epˆ ot et ` a la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publi´ es ou non, ´ emanant des ´ etablissements d’enseignement et de recherche fran¸ cais ou ´ etrangers, des laboratoires publics ou priv´ es. Le sens du signifiant Implications linguistiques et cognitives de la motivation PHILIPPE MONNERET 2 INTRODUCTION Il en va des disciplines comme des civilisations : leur fondation s'accomplit sur un meurtre primitif dont la victime, dans le premier cas, est une question qu'il a fallu taire afin d'assurer la constitution d'un savoir objectivé et transmissible. En linguistique, les questions victimes de ce silence fondateur sont le plus souvent des tabous parfaitement explicites, qui varient au gré des mutations de la discipline, lorsque l'émergence de connaissances nouvelles ou d'une conceptualisation adéquate permettent de prolonger l'investigation scientifique au delà des limites de ce qui fut un temps raisonnable. L'on songe bien sûr à la question de l'origine du langage, mais aussi aux dichotomies saussuriennes (matière / objet, langue / parole, linguistique interne / linguistique externe, etc.), dont l'efficacité épistémologique, incontestable, est proportionnelle à l'ampleur des exclusions assumées (la matière, la parole, l'externe), lesquelles assurent en retour une définition restreinte mais précise d'un champ intégralement subsumé par un mode d'appréhension intellectuelle qui relève de la scientificité. Si la linguistique contemporaine n'a jamais songé à s'émanciper du premier principe de la linguistique saussurienne, celui de l'arbitraire du signe – en dépit de quelques rares voix discordantes qui n'ont cependant jamais troublé un consensus profondément installé dans la communauté des linguistes – c'est, nous semble-t-il, qu'un tel principe relève de cette catégorie de questions qu'une discipline gagne à ignorer, parce que les désagréments éventuels de leur refoulement pèsent peu au regard des bénéfices par ce dernier dégagés. Une phonétique articulatoire, une phonologie, une sémantique eussent-elles été conçues si la linguistique s'était abîmée, à sa naissance, dans une thématisation du rapport entre signifiant et signifié, dans une quête du sens du signifiant, autrement dit dans une forme de holisme protoscientifique dont il est difficile d'imaginer qu'il pût jamais émerger une rationalité assimilable à celle des sciences, fussent-elles molles ou humaines. Comment ne pas penser au Saussure des Anagrammes qui, s'il semble psychologiquement cohérent avec celui du Cours (en termes de retour du refoulé), demeure définitivement incompatible avec ce dernier lorsque l'on considère non plus l'homme mais la nature du discours produit. En l'absence d'un sol épistémologique, dérobé par le premier principe du Cours, le propos des Anagrammes s'exclut, dans une empathie avec son objet qui ne laisse espérer aucune réconciliation, de la science du langage définie par l'auteur du Cours. Toutefois, si une discipline à prétention scientifique ne peut se fonder sur la maxime globaliste du primum non secare, la recherche d'une adéquation toujours meilleure à l'objet étudié exige en retour, périodiquement, d'interroger le réductionnisme qui lui fut originairement nécessaire, afin de tenter de s'affranchir de dichotomies à vocation méthodologique susceptibles de nuire à l'intégrité de son objet. C'est donc par ce que nous pourrions nommer le moment du secundum religare que l'on peut retrouver l'exigence holistique à laquelle il avait d'abord fallu 3 renoncer : s'il fut jadis crucial de penser le signe linguistique à partir de son arbitraire, il est peut-être temps aujourd'hui de commencer à s'intéresser sérieusement à la relation entre signifié et signifiant, d'envisager la motivation du signe comme un concept premier ; il est peut-être temps de songer à organiser un nouveau voyage en Cratylie, dans un esprit qui soit moins celui du touriste disposé à revenir les bras chargés de curiosités que celui du voyageur qui parcourt l'inconnu dans l'espoir d'élargir son propre monde. Cette question qu'affrontèrent autant les philosophes que les linguistes exige de se prémunir contre une dérive trop rapidement philosophique. C'est pourquoi nous commencerons par une confrontation de deux pensées linguistiques : celle de Saussure et celle de Guillaume (Chap. I). Il s'agira non pas de chercher à substituer un paradigme à un autre, mais de donner au texte saussurien l'occasion d'assumer pleinement certains de ses présupposés en prenant appui sur la conception guillaumienne de la psychosémiologie qui, loin de s'opposer frontalement à la doctrine saussurienne, en constitue une sorte de clinamen. Nous verrons ainsi que la principale faiblesse de la conception saussurienne du signe tient à son unipolarité sémiologique, là où une adéquation aux faits à décrire exige une double polarité, non seulement sémiologique, mais aussi systématique. L'aspect systématique n'est pas absent du Cours bien entendu, mais la comparaison avec le point de vue guillaumien fera apparaître les limites du traitement saussurien : cantonné dans le cadre de la théorie de la valeur, il se révèle inapte à enrichir la définition des composants du signe. En d'autres termes, notre point de départ sera la thèse selon laquelle la question de l'arbitraire absolu ne peut être dissociée de celle de l'arbitraire relatif1. Les frontières de notre Cratylie seront donc déplacées par rapport à la définition traditionnelle de ce territoire qui, ainsi élargi, livrera une problématique quelque peu renouvelée et résolument inscrite dans le champ de la linguistique. Nous n'éviterons pas, toutefois, de poser pour elle-même la question de la motivation interne du signe (Chap. II). Cette enquête sur l'iconicité dans les langues nous conduira successivement sur le terrain de la sémiologie (de Humboldt à Peirce et de Jakobson à Éco), de la psycholinguistique (Peterfalvi, Fonagy) et de l'étymologie (Guiraud). Elle permettra de dresser un bilan théorique et pratique sur la question mais aussi de constater que, malgré l'ampleur du champ d'investigation dégagé, la recherche linguistique semble répugner, depuis une vingtaine d'années, à s'y aventurer2. Mais, parvenu à ce point, nous n'aurons traité encore qu'une moitié de notre sujet. Jamais en effet n'aura été quitté le terrain de la langue, alors que notre propos sur la motivation du signe engage également le plan de la parole. Car la thèse arbitriste se prolonge, sur ce plan par une thèse parallèle : celle de l'isolement de la sphère motrice du langage. Si le signe est arbitraire, s'il n'existe aucune relation logique ni psychologique entre signifié et signifiant, il est évident que la réalisation individuelle du signifiant sera pensée comme indépendante de la conception du signifié. Cette thèse, implicite dans le « circuit de la parole » du Cours est en revanche parfaitement explicite dans le courant modulariste de la neuropsychologie 1 A ne pas confondre avec la thèse inverse, explicite dans le Cours, qui consiste à placer l'arbitraire relatif sous la dépendance de l'arbitraire absolu. 2 Signalons tout de même une exception remarquable, la première livraison de la revue Faits de langue (« Motivation et iconicité », mars 1993). 4 cognitive. Or, le parallèle entre les deux thèses s'étend jusqu'à leur statut : la question de l'isolement de la sphère articulatoire joue, dans le champ de la neurolinguistique, le même rôle que celle de l'arbitraire dans le champ de la linguistique, celui d'une question close d'avance, dont la résolution prématurée procède d'une exigence de nature méthodologique. Cette thèse de l'isolement de la sphère articulatoire est en effet fondée non pas sur des observations de type neuroanatomique, mais sur des considérations d'ordre fonctionnel reposant sur l'examen de cas pathologiques. Il apparaît ainsi que, depuis les origines de l'aphasiologie, l'étude des pathologies du langage a éprouvé le besoin de recourir à l'existence d'un trouble isolé de l'articulation verbale, l'anarthrie, trouble dont l'enjeu théorique est inversement proportionnel à la quantité – très faible – de cas observés, lorsqu'il n'est pas posé indépendamment de toute observation clinique. Comme dans le cas de l'arbitraire, nous avons donc là une question qui a été d'emblée investie d'une fonction épistémologique majeure, et corrélativement négligée dans ce qu'elle interrogeait en elle-même. Un tel parcours historique (Chap. III) permettra également de rappeler qu'il fut un temps où la notion d'anarthrie inspira les plus grandes réserves. Or la filiation évidente qui existe entre l'associationnisme du siècle dernier (Wernicke, Charcot) et la neuropsychologie cognitive contemporaine suppose précisément une parenthèse amnésique sur cette période (celle de Goldstein, d'Ombredane). En effet, la neuropsychologie cognitive n'a jamais eu besoin, pour s'implanter, de réfuter les critiques sévères adressées à l'associationnisme dont elle a repris, sous d'autres termes et, certes, en les approfondissant, les principes essentiels. Le développement général de la mouvance cognitiviste lui aura épargné ce travail critique. Notre réflexion sur l'isolement de la sphère articulatoire sera approfondie par une étude de la littérature neurolinguistique consacrée à l'anarthrie (Chap. IV), cette uploads/Philosophie/ le-sens-du-signifiant-texte-integral.pdf
Documents similaires

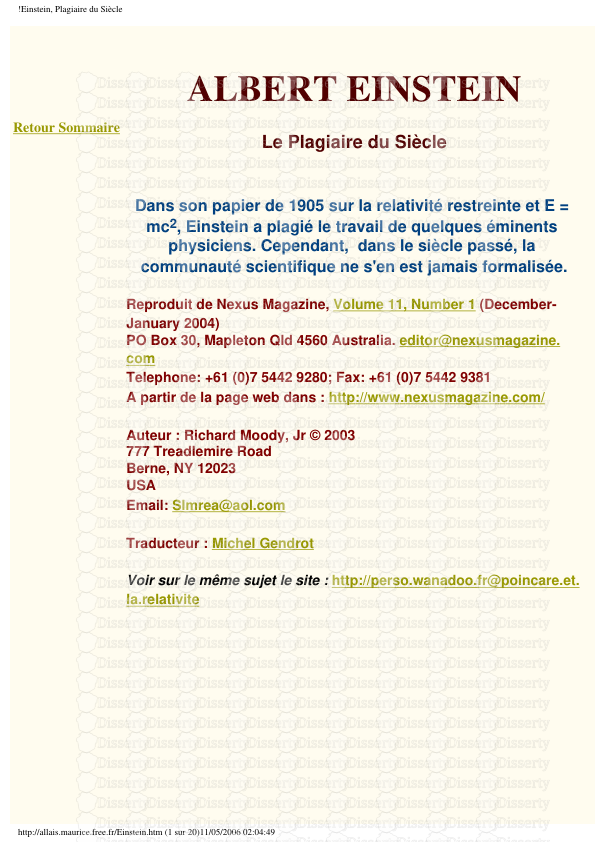








-
48
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 27, 2022
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 1.5828MB


