Plan de l’exposé 1/ Introduction 2/ Théorie de la personnalité ●Selon Freud ●Se
Plan de l’exposé 1/ Introduction 2/ Théorie de la personnalité ●Selon Freud ●Selon Cattell ●Selon Eysenck 3/ Exemples de personnalité ●Criminelle ●Autoritaire 4/ Théorie des traits de personnalités 5/ La dissociation structurelle 6/ Conclusion Introduction Définitions de la personnalité Pour introduire notre sujet concernant la personnalité, nous allons vous donner quelques définitions importantes: ●C’est l’ensemble des comportements, des aptitudes, des motivations, etc., dont l’unité et la permanence constitue l’individualité, la singularité de chacun. ●La personnalité est constituée de l’ensemble des comportements de notre vie quotidienne avec les individus que nous côtoyons et, comme ces comportements peuvent changer avec le temps et les évènements, nous dirons que notre personnalité change en même temps. ●Ensemble de traits qui caractérisent la structure intellectuelle et affective d’un individu et qui se manifestent dans son comportement. Mini introduction Beaucoup de chercheurs, ont effectué durant les années passées pour pouvoir décrire et définir la personnalité à travers des recherches scientifiques, des expériences, des données, des recueils et à ce jour, des recherches sont toujours effectuées au sujet de la personnalité. La théorie de la personnalité selon Freud La théorie de la personnalité de Sigmund Freud a varié à mesure qu’il avançait dans son développement théorique. Pour Freud, la personnalité humaine est un produit de la lutte entre nos pulsions destructrices et la recherche du plaisir. La construction de la personnalité devient un produit : le résultat de la façon dont chaque personne lutte contre ses conflits internes et les demandes de l’extérieur. La personnalité marquera ainsi la manière dont chacun s’en sortira socialement et fera face à ses conflits internes et externes. Il a exposé cinq modèles pour conceptualiser la personnalité : topographique, dynamique, économique, génétique et structurel. Ces cinq modèles tentent de donner forme à un schéma complet où peut s’articuler la personnalité de chacun d’entre nous. 1/ Modèle topographique Freud a utilisé la métaphore des parties de l’iceberg pour faciliter la compréhension des trois régions de l’esprit. La pointe de l’iceberg, celle que l’on voit, équivaut à la région constante. Elle serait liée à tout ce que l’on peut percevoir dans un moment particulier : perceptions, souvenirs, pensées, fantasmes et sentiments. La part de l’iceberg qui est submergée, mais qui peut quand même être visible, équivaut à la région pré-consciente de l’esprit. Elle est liée à tout ce dont on est capable de se souvenir : des moments qui ne sont plus disponibles dans le présent mais qui peuvent être apportés à la conscience. La plus grande partie de l’iceberg qui reste occulte sous l’eau équivaut à la région inconsciente. Dans cette zone resteraient gardés tous les souvenirs, les sentiments et les pensées inaccessibles à la conscience. Elle garde des contenus qui peuvent être inacceptables, désagréables, douloureux, conflictuels, et surtout angoissants pour la personne. 2/ Modèle dynamique Ce modèle est possiblement l’un des plus difficiles à comprendre dans la théorie de la personnalité de Freud. Il est lié à la dynamique psychique qui se produit dans l’esprit du sujet, entre les pulsions qui cherchent la gratification outre mesure et les mécanismes de défense qui veillent à les interdire. La dynamique psychique régulatrice a pour objectif primordial de veiller à ce que chaque personne puisse s’en sortir et s’adapter au milieu social. Les mécanismes de défense qui dérivent de ce modèle sont : répression, formation réactive, déplacement, fixation, régression, projection, introjection et sublimation ; il s’agit du pilier important de la théorie de la personnalité de Sigmund Freud. 3/ Modèle économique Il est lié à au mode de fonctionnement de ce que Freud a appelé “pulsion”, laquelle peut être définie, grosso modo, comme l’énergie qui nous pousse à trouver un but précis. En ce sens, Freud considérait que tout comportement était motivé par les pulsions. 4/ Modèle génétique Ce modèle suit les cinq étapes du développement psycho-sexuel. Il se caractérise par la recherche de gratification dans les zones érogènes du corps, dont l’importance dépend de l’âge. Freud a découvert que l’adulte n’est pas le seul à trouver de la satisfaction dans les zones érogènes, mais que l’enfant le fait aussi. 5/ Modèle structurel Ce modèle dans la théorie de la personnalité de Sigmund Freud se démarque par la séparation de l’esprit en trois instances. Ces trois instances se développeraient au fil de l’enfance. Chaque instance a des fonctions différentes qui agissent à différents niveaux de l’esprit, mais de manière conjointe pour former ainsi une structure unique de personnalité. Le Ca : c’est la part primitive et innée de la personnalité, dont le seul but est de satisfaire les pulsions de la personne. Elle représente les besoins et les désirs plus élémentaires. Le Moi : il évolue selon l’âge et agit comme un intermédiaire entre le Ca et le Surmoi. Il représente la manière dont on fait face à la réalité. Le Surmoi : il représente les pensées morales et éthiques reçues de la culture. Il représente la loi et la norme. Pour conclure sur la théorie de la personnalité de Freud, il est important de signaler que les modèles interagissent entre eux. Ils font de la personnalité un ensemble dynamique de caractéristiques psychiques qui conditionnent le mode selon lequel chaque personne agit face aux circonstances qui se présentent. La théorie de la personnalité selon Raymond Cattell Selon la théorie défendue en psychologie différentielle, la personnalité se décompose en traits, qu'il faut identifier et caractériser. Le problème, c'est que ces traits ne sont pas observables directement, on doit donc observer les comportements des individus pour en inférer les dimensions psychologiques qui les sous-tendent. 1/ L'hypothèse lexicale En 1936, Allport et Odbert propose une hypothèse permettant d'envisager la mesure des comportements, en se basant sur un postulat simple : nous savons parler des comportements, les décrire, nous avons des mots pour désigner les émotions et les caractéristiques de personnalité : extraverti, taciturne, joyeux... Le langage est donc une voie pratique vers l'identification et le recensement des traits de personnalité. Allport et Odbert réalisent alors une enquête leur permettant de collecter l'ensemble des termes décrivant des comportements sous-tendus par la personnalité. Dès leur premier recensement, ils retiennent plus de 18000 termes dont 4500 réellement différents, qui caractérisent des traits stables. Mais nous ne sommes pas certains d'avoir dans le langage des mots ou expressions pour tous les comportements possibles, il n'y a pas dans l'utilisation du langage pour décrire les aspects de la personnalité, une démarche complète et rigoureuse. L'hypothèse lexicale constitue néanmoins un départ pour codifier les dimensions psychologiques de la personnalité et leurs composantes, en partant du principe que toutes les conduites sont codées en langage. Ces mêmes conduites sont sous- tendues par les traits de personnalité. 2/ Théorie de la personnalité selon Raymond Cattell En 1943, Cattell part du travail d'Alport et d'Odbert et extrait de son analyse, près de 50 descripteurs différents. Cependant, pour Cattell, il est nécessaire de recueillir le maximum de données brutes pour avoir une idée objective de l'identification des traits. Il ne s'arrête donc pas là, et va recueillir encore 3 sortes de données : L-data (données de vie) : les données sont tirées de l'observation des sujets, ou bien sur la base de recueils objectifs, ou sur la base de recueils fait par l'observateur qui va suivre le sujet. Q-data (données de questionnaires) : par des questionnaires, Cattell recense ce que les sujets estiment être des traits de personnalités, ou leurs aspects. Les données recueillies reposent donc sur l'auto-évaluation du sujet. T-data (données de tests) : Cattell va utiliser des tests, au possible objectifs, pour tenter de recenser et décrire les aspects des personnalités. Des étudiants sont suivis par des observateurs pendant 6 mois, qui vont recueillir des L-data. Cattell fait avec ces données une analyse factorielle, de laquelle il tire 15 facteurs, qu'il nomme "Traits-source". Sur la base des Q-data et de ces 15 traits, il va construire un questionnaire comportant 10 items : il le soumet à un grand échantillon, et après analyse des résultats, obtient 16 traits (12 anciens déjà trouvés auparavant + 4 nouveaux). Cattell avait également travaillé sur les T-data, en utilisant des test objectifs de personnalité : il reprend les 16 facteurs et construit une batterie expérimentale de 500 petites épreuves. Ces données lui permettent d'obtenir, à la suite d'une analyse factorielle, 21 facteurs. Une fois les données obtenues, à la manière de la méthodologie adoptée pour identifier les aptitudes mentales primaires dans les recherches sur l'intelligence, son analyse factorielle, qui se sera poursuivie sur plusieurs décades (entre 1940 et 1970) démontre l'existence (selon les données recueillies) de 16 facteurs primaires de personnalité, qu'il renomme par des lettres (A, B, C, E, O...), afin d'éviter toute confusion avec des termes déjà existants. 3/ Le 16 facteurs et les Big Five Cattell, à partir de ces données et de l'analyse factorielle, construit enfin un test, explorant les 16 facteurs de personnalités, avec pour la mesure de chacun d'entre eux, une douzaine d'items dédiés. Les questions sont présentées en 3 points (d'accord - pas d'accord - sans avis). Néanmoins, tout comme les aptitudes mentales primaires uploads/Philosophie/ les-theorie-de-la-personnalite.pdf
Documents similaires



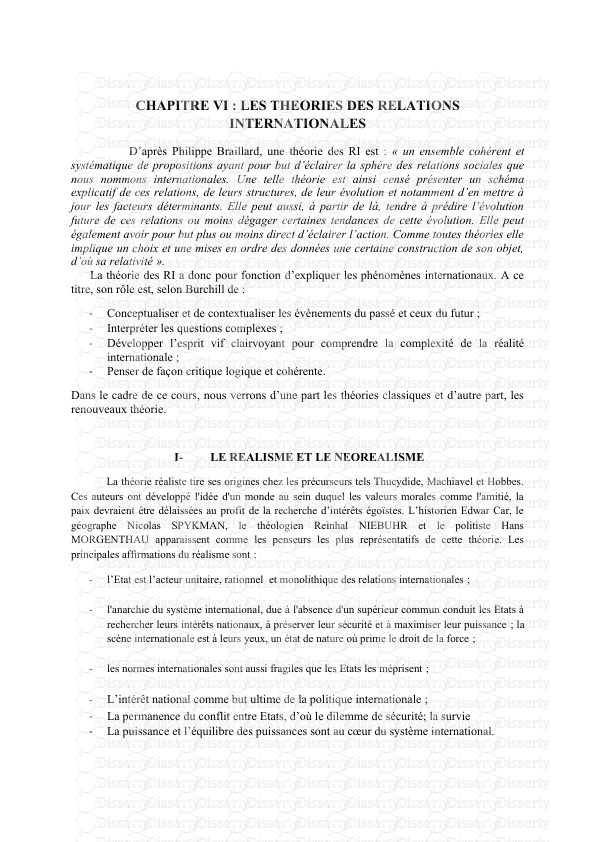






-
62
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 17, 2021
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1500MB


