L’individualisme économique et social Albert Schatz (1907) Numérisé par Richard
L’individualisme économique et social Albert Schatz (1907) Numérisé par Richard Caillaud Paris, août 2012 Institut Coppet www.institutcoppet.org Cette œuvre est diffusée sous licence Creative Commons Sommaire AVANT-PROPOS ................................................................................................................. 6 INTRODUCTION ................................................................................................................. 7 PREMIÈRE PARTIE. – LA FORMATION DE LA DOCTRINE LIBÉRALE CLASSIQUE ............................................................................................................................ 12 Chapitre I : Le mercantilisme et la réaction anti-mercantiliste ....................................... 12 I. Le mercantilisme ................................................................................................ 13 II. Les idées directrices de la réaction anti-mercantiliste ........................................ 21 Chapitre II : Les bases psychologiques de l'individualisme : de Hobbes à Mandeville .. 28 I. Les théories politiques et économiques de Th.Hobbes ...................................... 30 II. L’Ecole du sens moral ........................................................................................ 35 III. B. de Mandeville ................................................................................................ 39 Chapitre III : Le libéralisme doctrinal en France : les physiocrates ................................ 51 I. L’École physiocratique ...................................................................................... 51 II. La théorie de l’ordre naturel ............................................................................... 56 III. Les conclusions d’art social des physiocrates .................................................... 60 IV. Les théories politiques et fiscales des physiocrates ........................................... 64 Chapitre IV : La constitution du libéralisme doctrinal en Angleterre : D. Hume et A. Smith .................................................................................................................................... 68 I. L’École anglaise ................................................................................................. 69 II. Le système de liberté naturelle ........................................................................... 72 III. Les conclusion d’art social du système de liberté naturelle ............................... 83 Chapitre V : La constitution du libéralisme scientifique : la théorie de la valeur, la théorie de la population et la théorie de la rente ................................................................... 88 I. La théorie de la valeur ........................................................................................ 89 II. La théorie de la population ................................................................................. 95 III. la théorie de la rente ......................................................................................... 103 IV. Les conclusions d’art social du libéralisme scientifique .................................. 106 DEUXIÈME PARTIE. – LES DIVERS ASPECTS DE L’INDIVIDUALISME AU XIXÈME SIÈCLE ..................................................................................................................... 112 Chapitre I : Les développements complémentaires de la doctrine classique : Ch. Dunoyer et la définition de la liberté .................................................................................. 114 I. La définition de la liberté ................................................................................. 115 II. L’État producteur de sécurité ........................................................................... 118 III. La liberté et l’État ............................................................................................. 121 Chapitre II : Les développements complémentaires de la doctrine classiques (suite) : J. St. Mill et la théorie de l’individualisme ............................................................................ 126 I. La méthode de Stuart Mill ................................................................................ 127 II. La théorie de l’individualisme .......................................................................... 131 III. La théorie de « l’état stationnaire » .................................................................. 135 IV. L’individualisme et les réformes sociales ........................................................ 139 V. Le progrès social et le socialisme ..................................................................... 144 Chapitre III : La constitution du libéralisme orthodoxe : Bastiat et ses successeurs ..... 150 I. L’optimisme économique doctrinal aux environs de 1850 .............................. 150 II. L’œuvre polémique de Bastiat ......................................................................... 152 III. L’œuvre doctrinale de Bastiat .......................................................................... 157 IV. Les disciples de Bastiat .................................................................................... 164 Chapitre IV : La conjonction du libéralisme économique et du libéralisme politique : les théoriciens de la démocratie libérale .................................................................................. 170 I. Société démocratique et gouvernement démocratique ..................................... 172 II. L’égalité démocratique et la liberté .................................................................. 177 Chapitre V : La conjonction du libéralisme économique et du libéralisme politique (suite). La théorie individualiste du droit et la défense des libertés individuelles ............. 182 I. Les libertés nécessaires de l’individu ............................................................... 187 II. La délimitation des fonctions de l’État ............................................................ 193 Chapitre VI : L’interprétation individualiste de l'histoire : A. de Tocqueville et Taine 200 I. L’ancien régime et la Révolution ..................................................................... 202 II. Les origines de la France contemporaine ......................................................... 204 III. Les erreurs de la Révolution ............................................................................. 207 Chapitre VI : Libéralisme et christianisme .................................................................... 216 I. L’idée chrétienne d’autorité : Le Play et l’école de la Réforme sociale .......... 218 II. L’idée chrétienne de justice : le Catholicisme social ....................................... 227 III. L’idée chrétienne d’amour : la Démocratie chrétienne et le solidarisme évangélique. .................................................................................................................... 238 Chapitre VIII : L’individualisme sociologique ............................................................. 249 I. La philosophie synthétique d’Herbert Spencer ................................................ 253 II. L’individualisme sociologique après Spencer .................................................. 263 Chapitre IX : De l’individualisme anti-étatiste à l'individualisme anarchiste ............... 274 I. Les tentatives de détermination du rôle de l’État dans l’ordre économique .... 278 II. Le paradoxe individualiste ............................................................................... 281 III. L’individualisme anarchiste de Proudhon ........................................................ 284 IV. L’individualisme anarchiste de Max Stirner .................................................... 294 Chapitre X : L’individualisme aristocratique : son aspect économique et son aspect philosophique ..................................................................................................................... 300 I. La philosophie de la misère .............................................................................. 301 II. La théorie du rôle économique des élites ......................................................... 304 III. La philosophie de l’individualisme aristocratique ........................................... 310 CONCLUSION ................................................................................................................. 321 AVANT-PROPOS Ce livre est le résumé d’un cours d’Histoire des Doctrines économiques, professé devant les candidats au doctorat ès-sciences politiques et économiques. L’intérêt que m’ont paru y prendre les meilleurs de mes auditeurs m’a fait penser qu’il pourrait rendre quelques services, sous cette forme nouvelle, à certains de leurs camarades présents ou futurs. Je voudrais aussi que ce livre trouve accueil auprès d’un public plus vaste, à l’esprit simplement curieux d’idées générales. Ce sont de ces idées des économistes d’autrefois et des meilleurs d’entre les modernes que je me suis borné, dans les pages qui suivent, à mettre en ordre de mon mieux. Je prie seulement le lecteur de n’avoir pas peur du titre. Il aura si souvent entendu dire que l’individualisme, c’est l’égoïsme, l’isolement de l’individu obligé de se suffire à lui-même et conduit à se désintéresser de ses semblables, qu’il est en droit d’être prévenu contre le mot : les plus honnêtes gens s’y sont trompés, en se laissant prendre à cette interprétation trop littérale qui est un contresens, et beaucoup se croient très éloignés d’une telle doctrine qui en sont en réalité très voisins. L’opinion publique se nourrit volontiers de légendes ; elle est souvent aveugle dans ses préjugés comme dans ses engouements. L’individualisme a particulièrement souffert des travestissements fâcheux qu’elle lui a fait subir. Comme les dieux de l’Olympe après leurs équipées terrestres, je voudrais qu’avec de l’ambroisie, il s’en débarbouillât tout à fait. « La volonté de faire triompher un idéal social n’est jamais que l’expression d’un tempérament individuel, le reflet des instincts vitaux les plus profonds vraiment dominateurs de l’individu ». NIETZSCHE. C’est toujours aux doctrines qu’il faut demander compte des souffrances ou des prospérités de la société. Tout le mouvement social se résume dans los doctrines. Elles donnent l’impulsion aux faits et, à leur tour, elles la reçoivent des faits ; de sorte qu’en elles se trouvent et la cause et l’indice do l’état moral d’une époque. » Ch. PERIN. INTRODUCTION La vie en général, et en particulier la vie compliquée que la civilisation nous a faite, entraîne pour l’homme une succession incessante de déterminations à prendre. Dans chacune de ces déterminations, l’homme est ou se croit libre. Il doit donc choisir entre les motifs qui l’inclineraient à prendre tel ou tel parti. Il n’est pour lui qu’un moyen d’éviter les incertitudes et les hésitations sans cesse renaissantes, et d’introduire dans le cours de son existence une unité relative : c’est d’adopter un certain nombre de principes qui lui dicteront sa conduite dans les circonstances ordinaires où une décision de sa part est requise. Ces principes, qui existent par exemple en morale, en hygiène et dans les différentes disciplines professionnelles, peuvent être dissociés et groupés suivant le domaine où ils trouvent leur application. Ils constituent alors, dans chacun de ces domaines, une doctrine. Une doctrine économique peut donc être considérée comme l’ensemble des principes ou préceptes qui déterminent notre action dans l’ordre économique. Nous avons tous une doctrine en économie politique aussi bien qu’en morale et en hygiène. Peu importe que nous en ayons ou non conscience. On sait que M. Jourdain demeurait fort surpris de faire de la prose depuis sa plus tendre enfance. Nous ne pouvons pas ne pas avoir de doctrine. Prétendre que l’on s’est affranchi de toute doctrine morale, c’est dire simplement que l’on rejette la morale théologique, la morale formelle ou la morale utilitaire, pour leur substituer une doctrine personnelle qui sera vraisemblablement la morale du bon plaisir. Prétendre que l’on n’a pas de doctrine économique, c’est dire simplement que l’on considère comme non fondés le socialisme, l’individualisme et autres généralisations analogues et que, n’admettant ni l’existence de lois naturelles, ni la nécessité d’acheminer la société à un état différent de l’état présent, on adopte la doctrine opportuniste dont on peut définir le principe : la recherche du maximum de satisfaction présente. Par conséquent, ce qu’Aristote disait de la philosophie peut être étendu au delà du domaine philosophique. S’il est légitime de s’occuper de philosophie, il faut s’occuper de philosophie ; mais si l’on prétend qu’il n’est pas légitime de s’occuper de philosophie, il faut encore une philosophie pour le prouver, de sorte qu’en tout état de cause, une philosophie est indispensable. Il y a quelques inconvénients à ce que l’adoption d’une doctrine demeure dans cet état de demi-conscience. La vie d’une société et son amélioration sont des œuvres collectives supposant un certain concours de volontés. L’une et l’autre se trouvent mal d’être abandonnées au hasard, à l’impulsion irrégulière d’une opinion publique peu éclairée, qui cherche sa voie et que rien ne protège contre l’incohérence. Puisque le règne de l’opinion devient de plus en plus despotique, puisque suivant que cette opinion sera sage ou folle notre existence individuelle sera heureuse ou malheureuse dans toute la mesure uploads/Philosophie/ lindividualisme-economique-et-social-albert-schatz 1 .pdf
Documents similaires









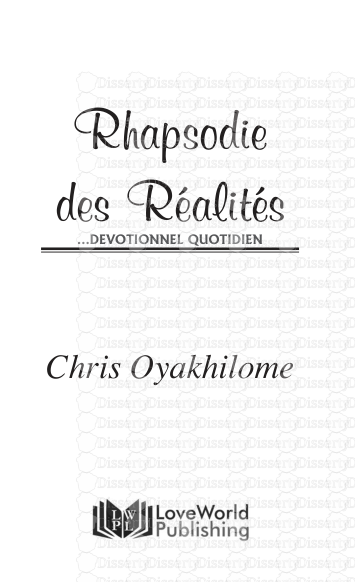
-
64
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 09, 2022
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 2.3195MB


