Comment Rubel édite Marx Sommaire : – Gilbert Badia, « Les morceaux choisis de
Comment Rubel édite Marx Sommaire : – Gilbert Badia, « Les morceaux choisis de Marx à la Pléiade » [entretien], France Nouvelle, n° 930, du 14 au 20 août 1963, p. 21-22. – Gilbert Badia, « Karl Marx, présenté par Maximilien Rubel », La Pensée N°113, janvier/février 1964, p. 80-82. – Gilbert Badia, « Brèves remarques sur l’édition des œuvres de Marx dans la Bibliothèque de la Pléiade », La Pensée, N° 146, août 1969. – Gilbert Badia, « Brève remarques sur le tome II des œuvres de Marx », L’Homme et la société, n° 17, 1970. – Stathis Kouvélakis, « Marx raccourci, ou comment Rubel édite Marx », Futur antérieur, n° 30-31-32, 1995, avec une note de l’auteur de juin 2008. KARL MARX PRÉSENTÉ PAR MAXIM1LIEN RUBEL 1 par Gilbert BADIA ANS l'article intitulé « Karl Marx et ses critiques bourgeois d'aujourd'hui », {La Pensée, n° 111, p. 29 et suiv.), le phi- losophe soviétique A. 1. Malych notait en particulier que « nombre de spécialistes bourgeois de la doctrine de Marx l'opposent à Engels et à Lénine ». D'autres. « représentent Marx comme un prédicateur de principes éthiques abstraits. » Pour certains enfin « Marx et Engels ont au fond proposé eux- mêmes une utopie..., bien qu'ayant critiqué les utopistes ». Ces remarques s'appliquent parfaitement au Marx que nous propose M. Rubel. Pour lui, en effet, « Engels [n'est] considéré [que] comme un interprète parmi d'autres » 2 et à Lénine, il préfère Anton Pannekoek, en tant que dépositaire de la vraie pensée marxiste 3. Quant à l'idée que Marx devrait être étudié avant tout comme le fonda- teur d'une éthique, dix remarques de M. Rubel attestent que c'est bien là sa thèse. « C'est dire que la « critique de l'économie politique » se confond en dernière instance avec un enseignement éthique » (note de la page 736, p. 1649). Page 1708, M. Rubel, parlant de la lutte émancipatrice du prolétariat, pour- suit : « Cent autres textes témoignent du sens éthique que Marx attribuait en vérité à ce refus de la servitude » (note 2 de la p. 1239). Ailleurs, il souligne la sympathie de Marx « aux économistes « d'occa- sions », de préférence aux professionnels : c'est qu'il était conscient d'appar- tenir à la même école de pensée » (note 1 de la p. 1128). On serait tenté d'opposer à chacune de ces affirmations de M. Rubel dix textes de Marx qui les contredisent. Vouloir en particulier faire d'Engels « un interprète parmi tant d'aurès », c'est se refuser à tenir compte de cent lettres où Marx consulte son ami, non seulement sur des questions pratiques (calcul de l'amortissement des machines, importance du capital circulant, du capital variable, etc.), mais sur des points de théorie. C'est se refuser à tenir compte de cette collaboration de tous les jours, dans tous les domaines, c'est ne pas voir la piété et les scrupules d'Engels éditeur de Marx*. Quant à faire de Marx un économiste d'occasion, c'est proprement aber- i. Karl MARX. Bibliothèque de la Pléiade. Edition établie par Maximilien Rubel. Tome l. Economie. Paris, 1063. 2. Avertissement, p. LIV. 3. 2 cf. note 3, de la page 1481, p. 1730. 4. Nous renvoyons, pour ne pas allonger ce compte rendu à notre article paru dans La Pensée, n0 112 ; voir en particulier les citations de la p. 4 et 5 ; le lecteur soucieux de se faire un juge- ment par lui-même sera tout-à-fait convaincu par la lecture des Lettres sur le Capital que vont publier prochainement les Editions Sociales. SUR UNE EDITION RECENTE DE K. MARX 81 rant.. A partir de combien d'années d'études passe-t-on donc professionnel dans cette discipline aux yeux de M. Rubel ? Pour sa part, Marx avait cons- cience d'avoir consacré aux études économiques, le meilleur de sa vie. N'écri- vait-il pas à Lassalle le 12 novembre 1858, à propos de sa Contribution à la Critique de l'Economie politique : Cet ouvrage « est le résultat de quinze années de recherches, donc de la meilleure période de ma vie. » On le voit, l'interprétation de Marx que M. Rubel nous propose dans ses notes est très contestable. Mais on peut supposer légitimement que le lecteur qui achète le volume paru dans la Bibliothèque de la Pléiade s'intéresse d'abord à Marx. Or la façon dont M. Rubel traite les textes a quelque chose de cho- quant, voire de scandaleux. Nous ne parlerons pas de la traduction 5. Elle n'est pas infidèle, elle est médiocre. Il y a plus grave : M. Rubel a trouve que le Capital, dont Marx a corrigé lui-même les deux premières éditions allemandes et l'édition française, n'était pas satisfaisant sous sa forme classique. II l'a disloqué. 11 en a rejeté en annexe le cinquième environ, toute une série de pages sur la journée de travail, le machinisme et la grande industrie qui viennent illustrer, par des exemples historiques, la théorie que Marx établit. En outre, il a interverti les deux derniers chapitres, sous prétexte que Marx aurait choisi cette disposition « pour endormir les censeurs ». En particulier, les censeurs russes ! Le malheur est que nous possédons les considérants des censeurs russes. Si l'édi- tion a été autorisée, cela ne tient nullement à l'interversion de tel ou tel cha- pitre, mais à ce que « l'exposé n'est pas accessible à tout le monde » et « qu'il a la forme d'une démonstration mathématique », bien que l'auteur soit « un socialiste 100 % » et que « tout le livre ait un caractère parfaitement socialiste »- 6. Dans une lettre à son ami Kugelmann, Marx écrit : « Voulez-vous désigner à votre femme comme parties qu'on peut lire pour commencer les sections sur la « journée de travail », « la coopération, la division du .travail et le machinisme », enfin sur « l'accumulation primitive » r. Or la plus grande partie des chapitres que Marx recommande de lire d'abord sont précisément ceux que M. Rubel renvoie en annexe ! On peut se demander à quel souci répond ce bouleversement. Faute de trouver quelque raison solide, on ne voit qu'une suffisance incroyable du pré- sentateur : ce n'est plus le Capital de Marx, c'est « Le Capital » tel que le souhaite M. Rubel. La conception qu'a M. Rubel de la genèse du « Capital » est, elle aussi, fort sujette à caution : « Marx, écrit-il, avait conçu de bonne heure le plan d'une « Economie » a publier par livraisons.... en six rubriques : 1) Le Capital ; 2) La propriété foncière ; 3) Le Travail salarié ; 4) L'Etat ; 5) Le Commerce ;. Parfois elle est contestable. Faute de place pour une démonstration qui requerrait de nom- breuses citations, nous nous permettons de renvoyer aux exemples que nous avons donnés sur ce psint dans « France nouvelle », n° 930, ,14 a»ût 1963, p. 22. 6. Lctt-c de Marx à Sorge du 21 juin 1872. 7. Lettre à Kugelmann' du 30 novembre 1867. 82. GILBERT BAD1A extérieur ; 0) Le Marché mondial. Il n'a jamais pu faire mieux qu'en écrire la « quintessence », c'est-à-dire une partie de la première rubrique... » Après quoi, M. Rubel fait un sort tout particulier â « l'Introduction générale à la critique de l'Economie politique » jetée sur le papier par Marx en 1857, à laquelle il attribue <c un caractère définitif » s, précisant ailleurs « qu'elle en disait trop » 9. M. Rubel donne à ce texte de travail 10 une valeur absolue, comme si tout le Capital n'était que le développement de ce plan, comme si Marx, portant dans sa tête son oeuvre majeure, toute prête d'avance, n'avait eu qu'à l'écrire. La démarche de Marx est opposée. Dans une lettre à Engels (25 février 1859) il raille durement Lassalle qui prétend, à partir d'Heraclite, juger de la nature et du rôle de l'argent dans la société actuelle : « Dans mon exposé... [Lassalle] verra qu'il est un âne qui a la prétention, à l'aide de deux ou trois phrases abstraites, de juger de choses empiriques qu'il faut étudier, et long- temps into the bairgain [par-dessus le marché] pour pouvoir dire son mot à leur sujet... » ". . Que s'est-il passé en réalité ? Marx a étudié l'Economie politique. 11 a jeté un plan sur le papier. Et ce plan initial, comme presque tous ceux qui se lancent dans une recherche quelconque ont pu le vérifier par leur propre expé- rience, il est amené à le modifier au fur et & mesure qu'il prend une connais- sance plus exacte de la matière qu'il étudie. Et en 1866, il écrit à Kugelmann (13 Octobre) : « L'ensemble de l'oeuvre se décompose ainsi. Livre I : Procès de production du Capital. Livre II : Procès de circulation du Capital. Livre III : Formes du procès d'ensemble. Livre IV : Contribution a l'histoire de la théo- rie ». C'est le (Capital, tel que nous le connaissons. uploads/Philosophie/ rubel-comment-rubel-edite-marx.pdf
Documents similaires




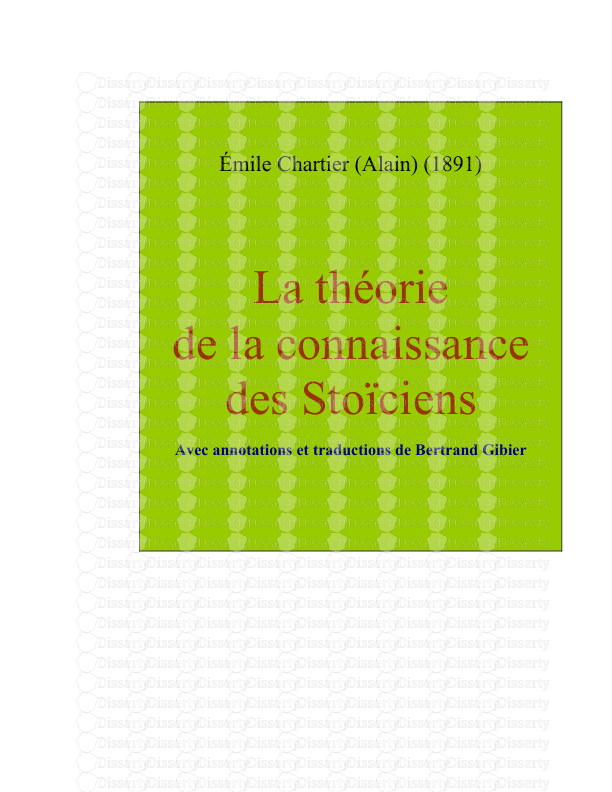





-
79
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 20, 2022
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 2.1839MB


