Eric Landowski Simulacres en construction In: Langages, 18e année, n°70, 1983.
Eric Landowski Simulacres en construction In: Langages, 18e année, n°70, 1983. pp. 73-81. Citer ce document / Cite this document : Landowski Eric. Simulacres en construction. In: Langages, 18e année, n°70, 1983. pp. 73-81. doi : 10.3406/lgge.1983.1153 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458-726X_1983_num_18_70_1153 Eric LANDOWSKI C.N.R.S. SIMULACRES EN CONSTRUCTION 7. Énonciation : le concept excède à première vue les pouvoirs d'une science moyenne et porte aux solutions radicales, par défaut ou par excès. Premier extrême (et première étape chronologique) : jusque vers le milieu des années soixante, c'est la mise à l'écart, quasi générale — ou l'ignorance — de la dimension énonciative des discours. Mais il faut tout de suite marquer les différences d'attitudes qui sous-tendent ce rejet. Nous en distinguerons deux. Dans le meilleur des cas, il s'est agi d'un choix méthodologique délibéré, fondé sur le constat de la pluralité des niveaux de fonctionnement des objets sémiotiques et sur la nécessité pratique qui en résulte (en vue d'une plus grande efficacité de leur description) de traiter séparément chacun de ces niveaux. D'où la mise au point, dans le cadre d'une « première sémiotique », d'un ensemble de procédures dites de normalisation des cor pus, visant à fournir à l'analyse un plan de travail homogène, réduit à ce que le texte énonce une fois allégé des « marques énonciatives » qui l'enca drent. Sans doute vaut-il la peine de souligner que le privilège de fait ainsi accordé à l'analyse du discours « objectivé » et « normalisé » n'impliquait aucune exclusion de principe quant au développement ultérieur d'une pro blématique relative à l'autre dimension considérée. Bien au contraire, sa place était en quelque sorte déjà aménagée, « en creux » l. Si on ne se laisse "pas tromper par les apparences les plus superficielles, on voit que cette attitude, à la fois par son caractère concerté et par l'ouver ture qu'elle ménage en direction du « paramètre subjectif » du discours (même si elle ne l'opère pas d'emblée), se distingue fondamentalement, et dès l'origine, de ce qui constitue alors la référence dominante : la théorie de l'information. Car c'est bien, de ce côté-là pour le coup, d'une véritable mise à l'écart (plutôt que de la suspension) de l'une des dimensions essen- 1. Cf. A.J. Greimas, Sémantique structurale, Paris, Larousse, 1966, p. 153, où l'analyste est invité à éliminer du texte les catégories de la personne, du temps et de la deixis, ainsi que les éléments phatiques, « à moins que (nous soulignons) l'analyse n'ait choisi ce paramètre (celui de la « subjectivité » (dans le discours) comme objet de description ». 73 tielles du discours qu'il s'agit. N'impliquant, de part et d'autre, rien de plus que la référence à un code mutuellement et conventionnellement accepté, la communication est envisagée en ce cas comme un simple transfert d'objets — encodes et décodables — entre deux espaces sémantiquement neutres, celui de l'émetteur et celui du récepteur. En un mot, renonciation, ici, n'est rien, le « message » (plutôt que l'énoncé) esi tout. A l'autre extrême, si l'on franchit d'un trait la distance et les années qui séparent un strict behaviorisme des derniers aboutissements de la philoso phie du langage, on aura au contraire un « sujet énonçant » omniprésent, hypertrophié, quand bien même aucun énoncé ne sortirait de sa bouche. Car cette fois, ce n'est plus la consistance du message ni sa bonne transmis sion qui sont en jeu, mais bien la forme et la substance d'un sujet : son « identité ». 2. C'est à l'écart de ces deux pôles, à bonne distance du réductionnisme positiviste comme du substantialisme des « post-modernes », que voudrait se frayer la voie d'une sémiotique rationnelle (pour reprendre une formule de Jean Petitot 2). En ce cas, comment traiter en particulier de « l'énoncia- tion » ? Deux séries de références viennent d'emblée à l'esprit. Il s'agit bien sûr, en premier lieu, de l'héritage des sciences du langage elles-mêmes (de Saus sure à Hjelmslev et à Benveniste, pour marquer quelques repères essentiels), d'où le projet sémiotique en tant que tel prend directement nais sance. Mais il s'agit aussi des principales sciences sociales (et humaines), par rapport auxquelles l'effort de construction sémiotique en cours — à con cevoir en ce cas comme l'élaboration d'un corps de propositions méthodolo giques de caractère général — trouve l'une de ses plus pressantes raisons d'être. Même formulée en termes aussi sommaires, la désignation de ces coordonnées n'est pas neutre. Elle traduit une certaine conception de la dis cipline : dette assumée, en amont, vis-à-vis des sources linguistiques et des méthodes structurales ; et surtout, en aval, astreinte voulue à une finalité pratique : la recherche de la plus grande opérativité possible au service d'une meilleure intelligibilité du « social ». Or, choisir cette perspective, c'est faire siennes un certain nombre de préoccupations spécifiques, relatives à ce qu'en termes très généraux on pourrait désigner comme l'efficacité sociale du discours, et qui vont condi tionner, entre autres choses, la manière d'appréhender l'ensemble des pro blèmes touchant aux relations entre les « discours » et leurs « sujets », eux- mêmes inscrits dans la « société », ou dans l'Histoire. Chacun de ces termes devrait évidemment être défini. Mais nous préférerons engager le débat d'une manière différente, en privilégiant la discussion d'une problématique 2. J. Petitot, « Sur la décidabilité de la véridiction », Actes sémiotiques-Documents, IV, 31, 1982. 74 par rapport à la justification de la terminologie retenue, avec plus ou moins de bonheur, pour l'exprimer. 3. Si l'on veut donner à la matière toute son ampleur, il faut remonter au plus simple, c'est-à-dire à la fonction sémiotique elle-même : c'est poser la question de savoir comment la « signification » vient au monde et comment l'existence (sémiotique) advient aux « sujets ». Le postulat étant que la signification n'est pas « dans les choses » mais résulte de leur mise en forme (qui ne peut être effectuée que du point de vue d'un observateur compétent), tout va dépendre — quant à la construction de la théorie sémio tique proprement dite — de la manière de concevoir et la relation entre ces deux instances (le sens, le sujet), et le statut qui peut leur être attribué en tant que termes aboutissants. En un sens, les termes se prêtent ici plus facilement à la définition que la relation qui les unit — relation que l'on peut en première approximation décrire comme le rapport de présupposition qui s'établit entre le surgisse- ment d'une « existence » et l'exercice d'une « compétence » : le sujet sémio tique compétent fait être du sens. Le « faire être » étant par ailleurs la défi nition même (encore qu'intuitive) de Y acte, on voit que la représentation proposée a pour effet de valoriser, au cœur même de la théorie, l'idée de construction dynamique, d'opération et de générativité. C'est là, en dépit de certaines rémanences possibles sur d'autres points, ce qui distingue en pro fondeur le « geste sémiotique » initial du « geste phénoménologique » : le sens, loin d'être reçu ou perçu, est pensé comme le fruit d'un acte sémioti que générateur. Le propos n'étant pas, toutefois, de s'appesantir ici sur les tenants et les aboutissants d'ordre philosophique, qu'il suffise de relever le terme clef du dispositif : faire. Un tel prédicat, de par sa nature purement syntaxique (x F y), ne désigne rien de plus, au niveau le plus abstrait, qu'une fonction en elle-même quelconque, que rien ne spécifie si ce n'est, précisément, sa capacité de mettre en relation deux variables à déterminer {x, y). D'où la nécessité — hors d'une démarche purement axiomatique — d'y investir un minimum de contenu. C'est ce qu'on a déjà commencé de faire à l'instant, en dénommant les fonctifs de la relation : x, le « sujet compétent », y, le « sens ». Reste à opérer le même enrichissement sémantique en ce qui con cerne la relation -fonction elle-même. Et pour ce faire, nous substituerons simplement au verbe « faire » le verbe « énoncer ». En vertu de cette décision, l'énonciation ne sera donc rien de plus, mais rien de moins non plus, que l'acte par lequel le sujet fait être le sens. Corré lativement, l'énoncé réalisé et manifesté apparaîtra, dans la même perspect ive, comme l'objet dont le sens fait être le sujet. On pourra trouver ces formules séduisantes, sans pour autant en être dupe. Car, à identifier pratiquement énonciation et fonction sémiotique (ou 75 même, plus techniquement, parcours génératif de la signification 3) comme le fait la première des deux « définitions » ci-dessus, on se donne un cadre qui reste évidemment trop large, ou insuffisamment déterminé compte tenu, surtout, de la visée opératoire annoncée plus haut. Aussi laissera-t-on en suspens l'approche de la relation -fonction proprement dite (qu'est-ce qu'énoncer ?) pour revenir aux termes proposés comme ses aboutissants : le « sujet » d'un côté, le « sens », de l'autre. Le terrain s'y trouve un peu mieux balisé. 4. Du côté du sujet, deux observations principales sont à uploads/Philosophie/ simulacres-en-construction-landowskky.pdf
Documents similaires








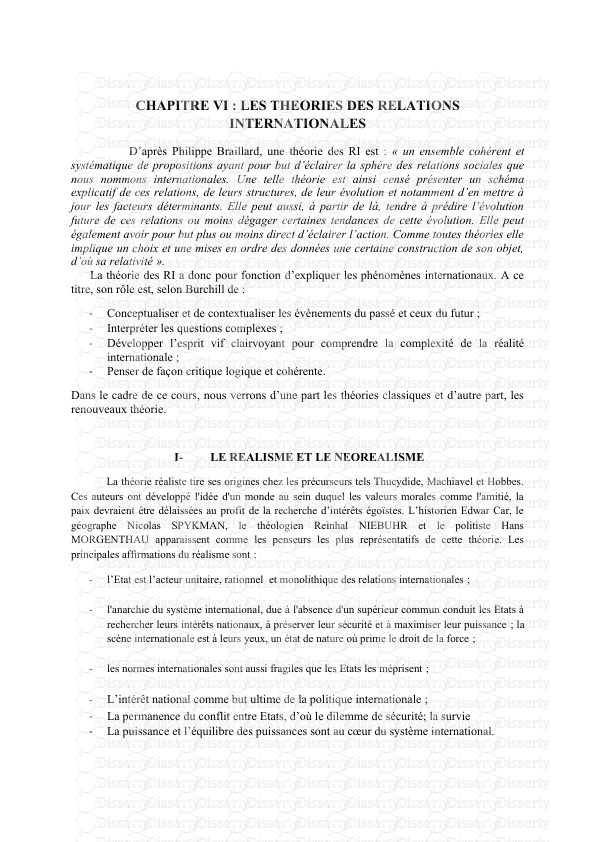

-
65
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 20, 2022
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.7877MB


