Tous droits réservés © Études internationales, 1976 Ce document est protégé par
Tous droits réservés © Études internationales, 1976 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ Document généré le 17 jan. 2023 12:40 Études internationales Brass, Paul R., Language, Religion and Politics in North India, Cambridge, University Press, 1974, 467 p. Jean Benoist Volume 7, numéro 4, 1976 URI : https://id.erudit.org/iderudit/700730ar DOI : https://doi.org/10.7202/700730ar Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) Institut québécois des hautes études internationales ISSN 0014-2123 (imprimé) 1703-7891 (numérique) Découvrir la revue Citer ce compte rendu Benoist, J. (1976). Compte rendu de [Brass, Paul R., Language, Religion and Politics in North India, Cambridge, University Press, 1974, 467 p.] Études internationales, 7(4), 621–623. https://doi.org/10.7202/700730ar LIVRES 621 de doctorat, qui de 1940 à 1969 ont porté sur l'un ou l'autre aspect du système poli- tique québécois. L'auteur a retenu non seulement tout ce qui touche aux institu- tions politiques, aux partis et aux groupes de pression, mais aussi le contexte écono- mique, démographique, social et culturel, dans lequel baignent ces institutions et ces forces politiques. Ce livre bibliographique s'ouvre sur une préface de Jean-Charles Bonenfant rappe- lant la grande utilité pour les chercheurs d'un tel ouvrage. La préface est suivie par un avant-propos où l'auteur explique ce qu'il a voulu faire et où il souligne les limites de son travail ; même si, en ce qui touche aux idéologies, institutions, forces et comportements politiques, il a tenté d'être le plus exhaustif possible, il n'a pu faire un relevé systématique de tout ce qui a été écrit dans les disciplines connexes comme la géographie, la démographie, l'économie, la sociologie, l'anthropologie, etc., et il a dû laisser de côté les journaux. Le plan général de la bibliographie est axé autour de trois grands thèmes : l'envi- ronnement, les institutions politiques et la vie politique. Le premier chapitre sur l'environnement se divise en quatre : les fondements culturels, les structures sociales, les structures géographico-démographico- économiques et les fondements constitu- tionnels. Le deuxième chapitre sur les institutions politiques distingue deux ni- veaux d'institutions : 1) les institutions centrales et 2) les institutions régionales et locales. Le troisième chapitre comporte trois sections de la vie politique : 1) les événements d'actualité de la période 1940- 1969 ; 2) les attitudes et les comportements politiques, surtout électoraux, et 3) les forces politiques, soit les partis et les groupes d'intérêt et de pression. Enfin, l'auteur donne en annexe une liste des biographies, des mémoires et des rapports des commissions et comités d'enquête as- sez complète jusqu'en 1967. Cette bibliographie sur le système poli- tique québécois de 1940 à 1969 est très complète dans le cadre que le professeur Boily s'était fixé et il n'y a aucun doute qu'elle sera un instrument de travail très précieux pour les chercheurs et les étu- diants de toutes les disciplines qui s'inté- ressent aux études québécoises. Paul GAGNÉ Département de philosophie, Université du Québec à Trois-Rivières BRASS, Paul R., Language, Religion and Politics in North India, Cambridge, University Press, 1974, 467p. L'intégration politique de l'Inde se heurte aux forces qui subdivisent cet État multi- national en entités distinctes qui s'affrontent. Les deux principales forces à l'œuvre dans les clivages qui partagent en sous-groupes le nord de l'Inde sont la religion et la langue. Manipulées, effectivement ou sym- boliquement, par les élites ces forces en- trent dans le combat politique. L'identité des groupes se cristallise alors autour d'un symbole privilégié qui, placé au premier plan des affrontements, ne révèle pas toujours leur véritable support. Telle est la thèse générale de l'auteur, celle par laquelle il aborde la dynamique des rela- tions entre politique, langues et religions dans quelques États du nord de l'Inde. Un intéressant chapitre introductif fait le point sur le contexte théorique et sur les modalités de la politique d'intégration nationale suivie par le gouvernement cen- tral indien. L'auteur montre alors combien les concepts classiques de la science poli- tique occidentale relèvent d'un ethnocen- trisme qui les rend peu applicables dans un tel cas, et il se donne pour tâche à la fois d'examiner un cas concret et de mettre 622 LIVRES au point des concepts et une démarche capables d'approcher la réalité spécifique d'une société donnée. Trois thèmes viennent alors encadrer les études de cas qui forment le cœur du livre. C'est d'abord la constatation que « les marques objectives d'identité, telles que le langage ou la religion, ne sont pas des données absolues à partir desquelles l'iden- tité des groupes ethniques émergerait auto- matiquement, mais qu'elles sont elles- mêmes sujettes à des variations ». Le se- cond thème porte sur la manipulation de ces marques en tant que symboles d'iden- tification par les élites et le troisième est « la position centrale de la politique et de l'organisation politique pour la forma- tion et la canalisation de l'identité des groupes ». Il s'agit alors d'appliquer à l'Inde ces approches qui tiennent un grand compte de la dimension sociologique. Dans ce pays se déroule un vaste mouvement, par lequel les peuples à la fois s'assimilent et se diffé- rencient. Le gouvernement central vit dans la hantise des forces centrifuges qui pour- raient faire éclater le pays, mais, pour les contrer, il a adopté une politique souple dont l'auteur dégage les quatre principes fondamentaux : si les demandes d'autono- mie régionale écartent toute idée de séces- sion, elles peuvent s'exprimer librement et même aboutir ; les demandes qui s'appuient sur le particularisme linguistique ou cultu- rel peuvent être acceptées, mais jamais celles qui s'appuient sur la religion ; seules les demandes qui jouissent d'un large support populaire ont des chances d'être entendues ; les demandes de partition d'États plurilingues doivent reposer sur le consensus de plusieurs des groupes ethni- ques concernés. S'appuyant sur ces quatre principes, les gouvernants ont mené une politique assez fluctuante, mais ils ont obtenu finalement des succès que bien des observateurs n'escomptaient pas. Dans le nord de l'Inde, à la différence des régions méridionales, le problème est rendu plus difficile du fait que les divisions ne portent pas tant sur des frontières lin- guistiques (entre ceux qui parlent ou non hindi), mais sur des barrières religieuses (entre hindous, musulmans et Sikhs). On assiste alors à une stratégie politique bien particulière qui tend à pousser au premier plan les différences linguistiques, symbo- liques, et à les faire concorder avec les frontières religieuses, bien plus fondamen- tales. Cela permet de « résoudre des con- flits politiques basés sur la religion par référence au clivage d'importance secon- daire qu'est la langue ». L'auteur pénètre dans l'intimité des phé- nomènes en examinant avec soin trois cas régionaux : l'échec du mouvement régio- naliste qui s'appuyait, au Bihar, sur la langue Maithili ; les tentatives d'autonomie de la minorité musulmane de l'Uttar Pra- desh et du Bihar et ses vains efforts pour atteindre un succès politique en s'appuyant sur la langue ourdoue ; le mouvement, mieux réussi, que les Sikhs ont entrepris au Punjab. Longues et détaillées, ces études de cas reprises dans la trame théorique choisie par l'auteur aboutissent à un tableau gé- néral qui dépasse le cas du nord de l'Inde. Elles montrent que « la genèse des natio- nalités dans un État multiethnique n'est pas nécessairement incompatible avec l'intégra- tion politique, même dans un régime basé sur la compétition entre des partis politi- ques qui expriment les demandes émanant de groupes ethniques ». La menace de con- flits et de désintégration que recèle l'ethni- cité ne semble pas plus grande que celle que contiennent d'autres clivages, entre classes sociales par exemple. Outre le sérieux de la documentation et de l'analyse, l'intérêt de ce livre tient à la large fresque des relations interethniques au sein d'États composites. Faisant appel à la fois à la science politique et à l'anthropo- logie sociale, l'auteur donne valeur d'exem- ples aux cas particuliers qu'il étudie. Son LIVRES 623 étude devient alors une précieuse contri- bution à l'analyse de l'intégration en situa- tion multi-ethnique. On regrette seulement parfois que, dominé par son idée centrale, il ne la nuance pas plus à propos des études de cas : dans quelle mesure les échecs ou les succès qu'il analyse ne sont- ils pas dus également à la situation des minorités en question au sein de la société globale ? Peut-on à cet égard placer les Sikhs et les Musulmans sur le même pied ? Mais le mérite de ce livre important est de bien mettre en évidence au niveau local la dynamique sociologique des tensions interethniques et de l'intégration nationale, en prenant comme lieux d'observation pri- vilégiés deux des symboles et des détermi- nants les plus solides d'identification eth- nique : la langue et la religion. Jean BENOIST Département d'anthropologie, Université uploads/Politique/ paul-brass-x27-s-language-religion-and-politics-in-india.pdf
Documents similaires








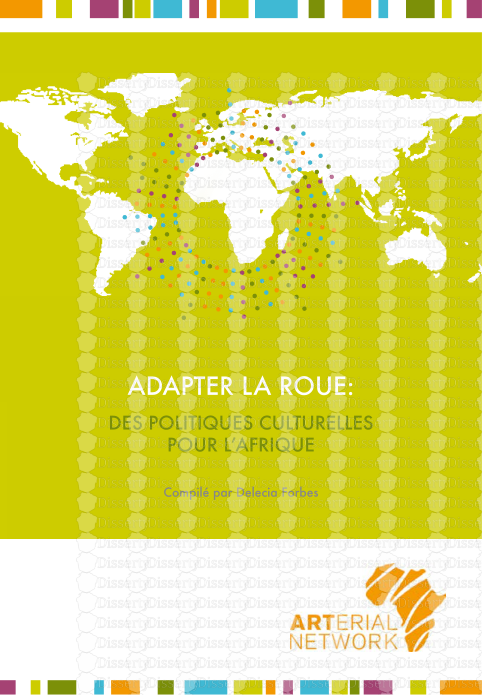

-
49
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 12, 2022
- Catégorie Politics / Politiq...
- Langue French
- Taille du fichier 0.4360MB


