HAITI, L'Église Mai-juin 2006 Le Père Paulin Innocent est en formation à la com
HAITI, L'Église Mai-juin 2006 Le Père Paulin Innocent est en formation à la communauté du noviciat spiritain européen, à Chevilly-Larue près de Paris. Haïtien, il se prépare à devenir le maître des novices des Spiritains en Haïti. Il a aimablement accepté de présenter quelques réflexions sur la vie de l’Eglise dans son pays au cours des trente dernières années. HIER L’Eglise catholique a toujours eu un rôle important et actif. Nous allons en parler à partir de 1969, car cette date marque une étape importante dans l’histoire de l’Eglise d’Haïti en général et dans celle des Spiritains en particulier. Duvalier a toujours donné l’impression de promouvoir un clergé indigène en Haïti, ce qui aurait été louable, mais ce qui en réalité l’avait intéressé, c’était de vassaliser l’Eglise. Il l’a réussi un peu en embarquant certains prêtres dans son mouvement, et d’autres plus avisés qui ne voulaient pas emboîter le pas étaient persécutés, poursuivis ou exilés. Les Spiritains en 1969, par un geste de clémence, disait son ministre des cultes, entraient dans cette dernière catégorie. Dans les années 80, à la faveur des idées de la théologie de la libération, et aussi à la suite du fameux cri lancé par le feu pape Jean-Paul II lors de sa visite à Port-au-Prince le 9 mars 83, l’Eglise retrouvait son souffle et sentait l’urgente nécessité d’accompagner le peuple haïtien dans sa longue marche d’émancipation. Le départ de Duvalier fils en 1986 a été vraiment ressenti comme une libération du peuple et de l’Eglise. On en a fini avec la dictature ! L’Eglise officielle va être immédiatement discréditée, car elle s’est ralliée aux gouvernements de transition. Mais à la base, le petit peuple vit avec son Eglise et nous pouvons signaler le rôle actif de la Conférence Haïtienne des Religieux. Elle a gardé un souffle prophétique tout au long des changements de régimes, même si aujourd’hui elle est un peu plus réservée. En 1990, le Père Aristide remportait largement les élections présidentielles pour avoir été l’un de ceux qui n’a jamais cessé de dénoncer les réalités de corruption. En fait, il est appuyé par de nombreux prêtres dont les Spiritains ; appuyé aussi par les T.K.L. (Ti Kominote Legliz). Ces communautés puisent aux expériences de la théologie de la libération et y trouvent leur inspiration. Le coup d’état de 1991 renverse Aristide et l’oblige à l’exil aux Etats-Unis. Tout ce qui a été mis en place tombe, avec complicité ou indifférence des responsables de l’Eglise. En 1994, c’est le retour d’Aristide. Mais il se produit un clivage important avec l’influence de certains meneurs des TKL qui deviennent des activistes politiques un peu servilement. C’est l’apparition des TKL à nouveau visage : Ti Kominote Lavalas ou TFL Ti Fanmyi Lavalas. Lavalas, c’est l’image de la crue et de l’inondation pour le changement. En 1996-2001, sous le gouvernement de Préval, l’Eglise se trouve déjà très affaiblie, avec d’une part une bonne partie de TKL politisée et des prêtres qui font de la politique , l’Eglise officielle qui fait des déclarations certes mais sans grande influence, et d’autre part le petit peuple qui attend. En 2001, avec le retour d’Aristide au pouvoir sur fond de crise interminable, l’Eglise n’a pas été épargnée. Elle a été à l’image du pays, morcelée et parfois vivement critiquée pour sa passivité, ses positions ambiguës et aussi pour avoir produit quelqu’un comme Aristide. Livre recommandé Philippe Delisle : Le catholicisme en Haïti au XIXème siècle Basée sur des archives privées romaines, parisiennes ou bretonnes largement inédites, cette étude entend faire revivre à la fois un temps fort de l’expansion missionnaire française et un moment important dans l’évolution culturelle de la Caraïbe. Elle s’attache à décrypter la stratégie ecclésiastique, à faire le lien avec la situation politique et sociale locale d’alors, mais aussi à aborder la vie religieuse haïtienne dans toute sa complexité. Assuré de l’appui politique, le clergé recruté particulièrement en Bretagne entend fonder une authentique chrétienté. Il multiplie les implantations et n’hésite pas à combattre violemment les idéologies concurrentes, depuis le protestantisme jusqu’au vaudou. Mais le manque de moyens, l’instabilité politique, l’attachement des élites haïtiennes aux idées libérales et enfin l’emprise du vaudou auront rapidement raison des projets de Bretagne noire. AUJOURD'HUI Nous en sommes peut-être à une attitude d’Eglise plus consensuelle, par exemple avec une CHR (Conférence Haïtienne des Religieux) plus silencieuse et une hiérarchie qui prend la parole en temps voulu. C’est une attitude d’attente, d’espoir pour laisser une chance à ce qui se cherche et se fait. Il y a une prise de distance d’avec la politique. En même temps, on sent un retour à des réalités plus proches de sa mission : les engagements pastoraux des paroisses, les services ou oeuvres des congrégations : éducation, santé, animation des quartiers et du développement. Voici quelques témoignages intéressants et très significatifs. CIFOR (Centre Inter-Instituts de Formation Religieuse) Cette faculté de théologie a vu le jour en 1998 pour la formation des Religieux et Religieuses. Les Religieux qui pensent au sacerdoce font leur philosophie au grand séminaire interdiocésain, puis leur théologie au CIFOR. Les Religieuses et les Frères peuvent y faire des études sur un ou deux ans : initiation aux sciences humaines, à l’Ecriture Sainte et à la théologie. Le CIFOR est la principale œuvre que les congrégations religieuses ont réalisée ensemble en Haïti. Animation des quartiers populaires C’est l’un des aspects de la place de l’Eglise : sa présence au cœur des cités populaires pour partager la vie des gens et créer des liens, les écouter et répondre à leurs besoins. Ici par exemple, il y a prise en charge des soins de santé dans les dispensaires des Religieuses. Là se font tous les gestes indispensables du caritatif et du social, comme par exemple l’ouverture d’un terrain de foot-ball aux jeunes du quartier de Saint-Martin. On peut citer le nom de deux quartiers sensibles de Port- au-Prince : Cité Soleil avec la présence des Salésiens et Solino avec les Spiritains. Animation rurale La population d’Haïti est majoritairement rurale. Les petits paysans arrivent à s’organiser dans des regroupements de réflexion et d’entraide pour l’agriculture et l’élevage avec l’aide de coopérants étrangers, en majorité des Cubains. Il est question même d’université rurale depuis deux ans, pour souligner le suivi de l’animation entreprise. C’est vrai par exemple avec l’Association des paysans de Fondwa et Fonkoze qui soulignent en patois créole l’aspect solidarité, car Fonkoze signifie serrer les coudes ou les épaules, à travers le service d’une banque alternative de prêt aux petits marchands. C’est le travail d’animation du P. Joseph Bonhomme Philippe. Le P. Jean- Yves Urfié de son côté motive les gens au reboisement des mornes (collines) et ainsi leur fait espérer un lendemain meilleur. Le P. Paulin a ainsi partagé une réflexion sur la situation d’une Eglise haïtienne, hiérarchie et peuple, qui a cherché, cherche encore et trouve une place de communion et de service à la manière de Gaudium et Spes : Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes, de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur (n° 1). Témoignage d’un Frère du Sacré Cœur sur l’éducation Le projet éducatif catholique est articulé avec le plan national d’éducation mis en place par l’Etat. Le projet éducatif des Frères du Sacré-Coeur en Haïti y ajoute une touche originale. Ce qui se vérifie par les résultats : nos anciens élèves sont davantage des technocrates que des membres de l’élite intellectuelle du pays. Cela à cause de la conviction que ce sont les mains calleuses des travailleurs qui soulèveront ce pays accroupi économiquement, dont la grande majorité de sa population croupit dans l’ignorance. Le simple fait d’être Frères du Sacré-Cœur, dans la Province d’Haïti aujourd’hui, signifie déjà offrir à l’Eglise, plus particulièrement la jeunesse haïtienne assoiffée d’humanité, de justice et de fraternité, un nouvel air, une nouvelle raison de vivre et d’espérer. Nous sommes en Haïti 58 Frères (dont 1 canadien, 1 français), 8 novices de première année, 13 novices de deuxième année, 13 profès à vœux temporaires et 24 profès perpétuels. Dans plus de 12 ensembles éducatifs, avec 400 collaborateurs laïcs, nous accueillons 9822 éléves. En suivant un ordre ascendant des établissements : 4 écoles maternelles, 5 écoles primaires, dont 3 non payantes, 4 collèges secondaires, 2 écoles professionnelles. A cela s’ajoutent 2 centres éducatifs avec cours du soir pour adultes (alphabétisation et cours classiques). Frère Kysly, Frère du Sacré-Coeur<.div> Cet article est paru dans la "Revue Saint-Joseph d'Allex" n° 988 (mai-juin 2006) uploads/Religion/ haiti-l-x27-eglise-spiritains-a-solino.pdf
Documents similaires








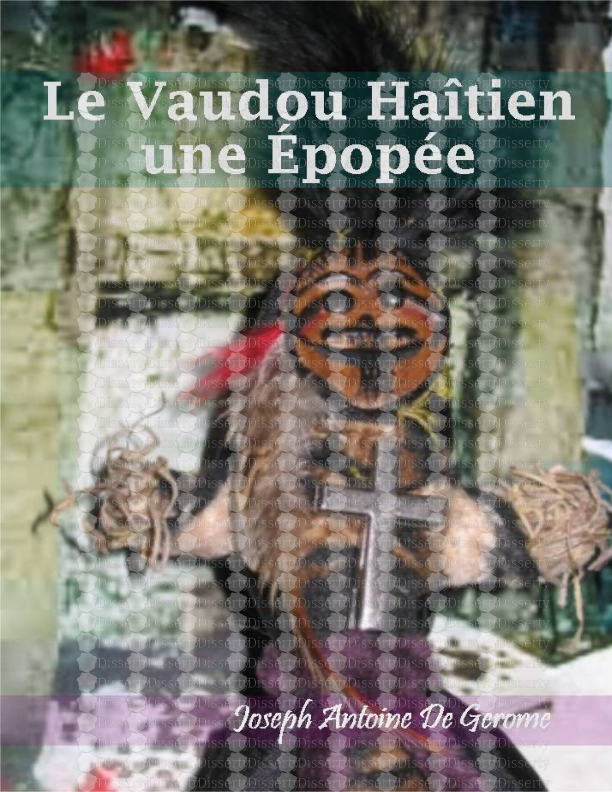

-
43
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 14, 2021
- Catégorie Religion
- Langue French
- Taille du fichier 0.2131MB


