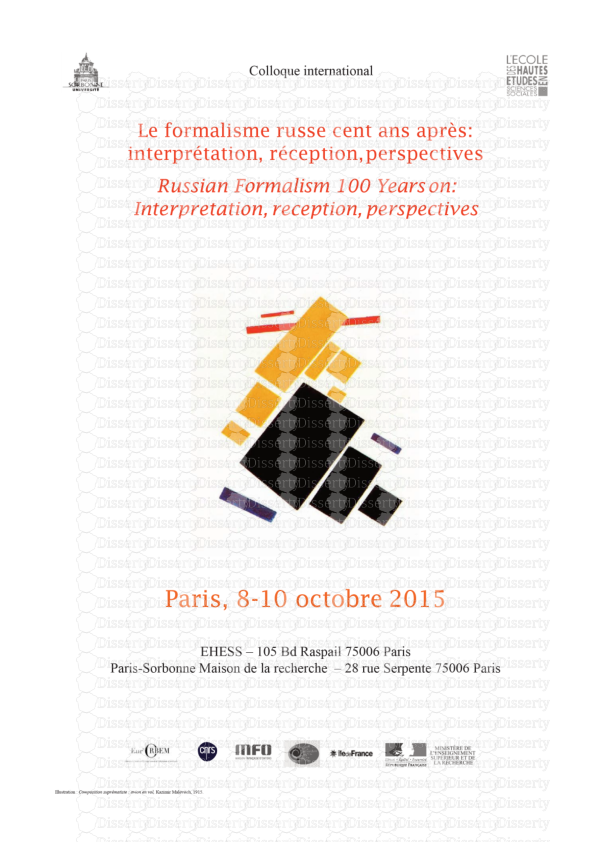2 3 Le formalisme russe cent ans après : interprétation, réception, perspective
2 3 Le formalisme russe cent ans après : interprétation, réception, perspectives Depuis plusieurs décennies, le formalisme russe s’est affirmé comme un héritage fondamental des sciences humaines et sociales. Nombreuses sont les découvertes majeures des formalistes et nombreux sont les acquis essentiels issus de leurs travaux, ayant exercé une influence sur la recherche, directement ou indirectement, bien au-delà de la Russie et des pays slaves. Mais ces travaux sont-ils vraiment connus ? Qu’en est-il exactement de leur réception en Occident à partir des années 1960 ? Les avancées favorisées par ces acquis sont-elles devenues au fil des ans autant de truismes et d’idées reçues ? L’ambition de ce colloque est de rouvrir le dossier, cent ans après l’apparition du formalisme et cinquante ans après son premier moment de diffusion en Occident. Le temps est venu, d’une part, de dresser un bilan ou état des lieux de la question, en mettant en évidence les principaux acquis du mouvement russe, ainsi que la façon dont il s’est trouvé intégré au paysage intellectuel occidental au cours des années 1960, sous l’influence de la linguistique structurale de Roman Jakobson et, pour la France, grâce au rôle de passeur de Tzvetan Todorov et de Gérard Genette. Cette interrogation suppose de s’intéresser aux figures principales, choisies comme représentants du mouvement (Chklovski, Eichenbaum, Tynianov), ainsi qu’à la façon dont leurs textes ont alors été traduits, présentés, diffusés. D’autre part, il s’agirait également de cerner les principales relectures dont – conséquence des avancées de la recherche, de l’accès à de nouveaux matériaux et du changement de climat scientifique – le formalisme a pu être l’objet en Russie ou à l’étranger depuis les années 1980. L’inclusion du formalisme russe dans une perspective européenne a fait surgir de nouveaux questionnements et mis en évidence ses liens avec la science de l’époque, au-delà de son ancrage connu dans l’avant-garde poétique futuriste. D’autres noms sont apparus, comme ceux de Grigori Vinokour ou Boris Jarkho, incarnation d’un formalisme moscovite plus discret et moins iconoclaste. Ces avancées pèsent cependant peu face au désintérêt diffus pour un mouvement associé à une technicité linguistique et qui est censé incarner une orientation disciplinaire dure, alors que semblent aujourd’hui dominer ces orientations molles de la critique littéraire que Jakobson malmenait sous le nom de « causerie ». Réunissant des théoriciens et des historiens de la littérature, des spécialistes de sciences humaines, ce colloque international, par-delà les principaux axes de réflexion proposés, entend poser à terme la question de la continuité des usages et de l’actualité du mouvement russe, ainsi que de ses extensions tchèque et polonaise et de ses développements et inflexions dans les années 1960 avec l’école de Tartu. Catherine DEPRETTO, John PIER, Philippe ROUSSIN 4 Russian Formalism 100 Years On: Interpretation, reception, perspectives Russian formalism has been established as a fundamental heritage of the human and social sciences for several decades. The major discoveries by the formalists are numerous, as are the essential advances coming out of their works that have exerted influence over research, both directly and indirectly, well beyond Russia and the Slavic countries. But are these works truly known? What, exactly, has their reception been in the West since the 1960s? Have the advances enabled by this work become so many truisms and handed-down ideas? The aim of this conference is to look at the issues anew, a hundred years after formalism first appeared and fifty years after it gained currency in the West. The time has now come, on the one hand, to take stock of the issues by highlighting the main steps forward pioneered by the Russian movement as well as of how these developments were integrated into the western intellectual landscape during the 1960s under the influence of Roman Jakobson’s structural linguistics and, for France, thanks to the role of mediator played by Tzvetan Todorov and Gérard Genette. These questions involve looking at the principal figures acknowledged as representative of the movement (Shklovsky, Eichenbaum, Tynianov) as well as at how their texts were translated, presented, circulated. On the other hand, this stocktaking also involves defining the principal readings – a consequence of the progress of research, access to new materials and changes in the scientific climate – that formalism has experienced in Russia and abroad since the 1980s. The inclusion of Russian formalism within a European perspective has raised new questions, revealing its links with science at the time of its emergence that extend beyond formalism’s well-known anchoring in the poetics of the futurist avant-garde. Other names have appeared such as those of Grigori Vinokour and Boris Jarkho, embodying a more discrete and less iconoclastic Moscow formalism. Even so, these advances bear little weight alongside a pervasive lack of interest in a movement associated with linguistic technicalities regarded as indicative of a rigid disciplinary orientation whereas today it would seem that it is those soft orientations of literary criticism, branded as “chitchat” by Jakobson, that hold sway. Bringing together theoreticians and historians of literature as well as specialists in the human sciences, this international conference ultimately seeks, through the main lines of reflection proposed above, to address the question of the ongoing uses and current relevance of the Russian movement, including its extension to Czech and Polish scholarship and its developments and modulations starting in the 1960s with the Tartu school. Catherine DEPRETTO, John PIER, Philippe ROUSSIN 5 Sylvie ARCHAIMBAULT Eur’Orbem, CNRS/Université Paris-Sorbonne Grigorij Vinokur (1896–1947) et la notion de « culture de la langue » (kul’tura jazyka) Le Cercle linguistique de Prague inclut dans ses Thèses (cf. Travaux du Cercle Linguistique de Prague, 1929) la notion de « culture de la langue, très nécessaire à la plupart des langues slaves littéraires à cause de leur tradition relativement récente ou de leur développement soit interrompu, soit hâtif ». Mais, bien en amont de cela, Grigorij Vinokur avait élaboré une réflexion en plusieurs étapes, dédiée à ce qu’il dénommait « Kul’tura jazyka ». L’idée d’une conscience linguistique collective, partagée par une société éduquée, qui est à la base de la « culture de la langue ». C’est à la genèse de cette notion par Vinokur que notre intervention sera dédiée. Au début de l’année 1923, alors qu’il préside le Cercle Linguistique de Moscou, Vinokur commence l’élaboration de sa réflexion sur la culture de la langue. Un premier article intitulé Kul’tura jazyka (Zadači sovremennogo jazykoznanija) paraît dans la revue Pečat’ i revoljucija en 1923. Dans cet article, qui constitue la trame de son ouvrage éponyme de 1925, Vinokur développe l’idée que « la langue n’est pas un organisme, mais une organisation ». Il développe tout d’abord l’idée – partagée à l’époque par les linguistes russes – qu’il y a nécessité impérieuse à refonder la linguistique, car celle-ci traverse une crise. Cette même année 1923, dans la préface au recueil intitulé La Parole russe [Russkaja reč’], Lev Ščerba pointait lui aussi la nécessité de trouver des voies originales pour sortir de cette crise. Ščerba dresse de la situation des études linguistiques un constat en demi-teinte. S’il reconnaît à la grammaire historique classique l’importance des modèles abstraits qu’elle avait su élaborer, dans le domaine phonétique notamment, il note l’essoufflement de ces recherches et clame la nécessité de revivifier les études linguistiques en recentrant les analyses sur la langue, vue comme « système vivant de signes qui expriment nos pensées et nos sentiments ». Pour Vinokur, la grammaire historique et comparée souffre de lier son explication des faits de langue à l’échelle de l’individu. Il commence par dérouler l’histoire de la linguistique depuis le début du XIXe siècle. La première période, celle de Bopp et Schleicher, a été celle de la reconsti- tution de la langue-mère, concevant la langue comme un organisme. La seconde, celle des néo- grammairiens, dont la force a été de toucher à la vie de la langue, vue comme processus non pas organique, mais historique et culturel. Mais l’impasse dans laquelle ils se sont trouvés est illustrée par les lois phonétiques : si celles-ci sont compatibles avec la reconstruction, elles n’ont pas de contenu culturel et historique. Vinokur réfute également le psychologisme qui a entaché les travaux de Baudoin de Courtenay. La troisième étape du développement de cette discipline scientifique (naučnoe jazykovedenie) est désormais à élaborer. Bien que cela ne soit pas dit explicitement, c’est la tâche à laquelle Vinokur souhaite justement s’atteler. Si la réflexion démarre sous les auspices d’un technologisme marqué par le producti- visme ambiant (« C’est uniquement en sortant de la notion de système de la langue que le linguiste- technologue pourra distinguer tous ces innombrables vis et boulons qui composent la machine langagière »), elle connaîtra plusieurs inflexions qu’il sera intéressant de suivre au travers des publications successives. L’intérêt de Vinokur pour la langue artistique, les questions fondamentales de la différen- ciation entre langage et langue, ainsi que de la relation langue/parole, sa grande connaissance des écrits du corpus des linguistes européens contemporains, en font un observateur particulièrement attentif des évolutions de la langue russe dans ses usages. De ces différents points de vue, son ouvrage uploads/Science et Technologie/ formalistes-russes-livret.pdf
Documents similaires










-
49
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 14, 2021
- Catégorie Science & technolo...
- Langue French
- Taille du fichier 1.4851MB