1 cc PLAN DU COURS. INTRODUCTION GENERALE 1. Objectifs du cours 2. Intérêt 3. S
1 cc PLAN DU COURS. INTRODUCTION GENERALE 1. Objectifs du cours 2. Intérêt 3. Stratégies 4. Contenu du Cours 5. Bibliographie sommaire Chapitre I. Types de connaissance et Science. I.1. Types de connaissance I.2. La Science I.3. Esprit scientifique I.4. Groupements scientifiques I.5. Les Ecrits scientifiques Chapitre II. Comment préparer un Travail scientifique II.1. Types de recherche scientifique II.2. Catégories des travaux scientifiques II.3. Préparation d’un Travail scientifique II.4. Rassemblement des matériaux. Chapitre III. Comment élaborer un Travail scientifique III.1. Le Plan d’un Travail scientifique III.2. Aspects techniques de rédaction et de présentation ‘un travail scientifique CONCLUSION DU COURS BIBLIOGRAPHIE 2 Introduction générale 1. Objectifs du cours. Le cours d’Initiation à la recherche scientifique poursuit deux objectifs : o Le premier, d’ordre pratique : consiste à apprendre à l’étudiant(e) comment utiliser les sources d’information et les informations disponibles c’est-à-dire comment les trouver et les choisir ? Comment les critiquer et les traiter pour répondre à l’objectif poursuivi ? Si l’information qui est disponible ne suffit pas, comment peut-on la compléter par des enquêtes personnelles ? Enfin, comment présenter le résultat d’un travail scientifique c’est-à-dire le plan général, le découpage des matières, les références et citations, les bibliographies, etc. o Le deuxième, d’ordre théorique : consiste à initier les étudiants aux grands principes de la méthode scientifique notamment les principes d’objectivité et de subjectivité, l’esprit critique, la validité d’une démonstration ou d’une théorie, la recherche des hypothèses (sont des réponses provisoires à une question de recherche), le choix de la méthode, le rôle des concepts et des théories. o Au terme de cet enseignement, chaque étudiant doit être capable de s’assumer quant à ce double objectif pratique et théorique. 2. Intérêt du cours. Le rôle de ce cours est d’enseigner à l’étudiant(e) les connaissances scientifiques pour sa formation générale et professionnelle et aussi lui apprendre comment procéder méthodiquement au travail, à la production des nouvelles connaissances scientifiques (production scientifique). Des qualités morales et intellectuelles sont requises pour une meilleure formation de l’étudiant (e). Qualités morales : liberté et responsabilité personnelle. D’où la nécessité de la probité ou de l’honnêteté scientifique, de l’opiniâtreté et de la patience dans la recherche. Qualités intellectuelles : il faut avoir le bon sens, l’expérience, être méthodique, analytique, critique et synthétique ; apprendre à poser correctement les problèmes, à les décomposer et à analyser ses diverses composantes. Tout doit se faire dans l‘humilité et la simplicité. 3. Stratégies. a) D’enseignement : les enseignements seront essentiellement théoriques et transmis ex. cathedra. b) D’évaluation : l’évaluation comprendra : -une interrogation générale écrite, à la fin du cours, des travaux pratiques et/ou dirigés et un examen écrit. 4. Contenu du cours. Si la qualité de l’étudiant(e) à former est fonction de ses prédispositions à se soumettre aux exigences de l’esprit scientifique, il revient au cours d’IRS de lui offrir toutes les techniques et les normes d’élaboration d’un travail scientifique. Comme toute initiation, ce cours introduit l’étudiant(e) dans l’exaltante mission de chercheur par une esquisse méthodologique qui sera clôturée avec le cours de méthode de recherche. 3 5. Bibliographie sommaire. - ELENGESA NDUNGUNA, Cours d’IRS, G1 S/A, Fac. sciences sociales. - MPALA MBAMBULA, L., Directives pour rédiger un travail scientifique suivi de recherche scientifique sur internet. 3è édition augmentée, Lubumbashi, Ed. Mpala, 2006. 4 CHAPITRE .I. TYPES DE CONNAISSANCE ET SCIENCE. Connaissance et Science sont deux notions qui prêtent souvent à équivoque. Dans le langage courant, la connaissance est un savoir et peut-être synonyme de la science. Mais tout savoir n’est pas nécessairement scientifique. I.1 TYPES DE CONNAISSANCE Les connaissances humaines peuvent être regroupées en trois grands types : 1. Les connaissances empiriques ou connaissances du bon sens : sont celles amassées grâce à l’expérience personnelle et à l’observation banale. 2. Les connaissances réflexives : sont celles acquises par le jeu de la réflexion ou du raisonnement. 3. Les connaissances scientifiques : sont celles qui se différencient des autres principalement par leurs modes d’acquisition (elles sont méthodiques). I.2. LA SCIENCE a) Définition. Deux types de courant sont à prendre en compte dans la définition du concept de « science » : Les Empiristes classiques et positivistes, d’une part et les empiristes critiques ou dialecticiens, d’autre part. 1° les Empiristes positivistes : partent d’une démarche inductiviste pour définir la science comme étant un ensemble des descriptions, des lois et des théories concernant l’univers dans son ensemble ou certains de ses aspects. Selon ces auteurs, la démarche méthodologique pouvant conduire à des connaissances systématiques ou rationnelles et raisonnées concernant le réel est purement empirique. En d’autres termes, celles de l’observation et de l’expérimentation décident de l’acceptation ou du refus des énoncés scientifiques. 2° les empiristes critiques ou dialecticiens : définissent la science de la même manière que les inductivistes mais pour eux, si le Savant a comme objectif d’atteindre la vérité, il sait que cette vérité est cachée. Ainsi, face à la vérité scientifique, les positivistes sont optimistes alors que les dialecticiens sont pessimistes c’est-à-dire ne voient pas ce que la science cherche à l’œil nu ; la vérité est cachée. Pour la constater, il faut des méthodes et des techniques bien spécifiques. Les positivistes voient la vie d’une manière objective mais les dialecticiens (critiques) sont pessimistes mais tous définissent la science de la même manière. b) Caractéristiques de la Science. La science comporte trois caractéristiques principales : -l’exactitude, - l’objectivité, - la communicabilité. Exactitude renvoie à la notion de vérité telle que l’indique René Descartes (1596-1650). Descartes définit quatre règles conduisant l’esprit à la vérité : 1. Ne rien recevoir qui ne soit clair et distinct. 2. Diviser les difficultés pour les résoudre. 3. Partir des idées les mieux connues (les plus simples) aux plus inconnus plus complexes). 4. Explorer entièrement l’ensemble des éléments du phénomène mis en étude. Objectivité (jean Piaget). L’objectivité est atteinte lorsque deux ou plusieurs chercheurs différents qui travaillent sur un même objet avec des expériences et positions différentes, arrivent incontestablement au même résultat. 5 Pour l’atteindre, PIAGET préconise un moyen : la décentration qui est l’action de se défaire des sources personnelles, de déformations que sont les croyances, les préjugés, les stéréotypes, les intérêts, les expériences antérieures héritées de la tradition, de la coutume, les opinions politiques, philosophiques, morales ou religieuses,… La communicabilité : le discours par lequel on communique la science doit être clair, précis et exhaustif. Fonctions de la science. On distingue deux fonctions principales : Les fonctions vis-à-vis du monde, d’une part et les fonctions libératrices, d’autre part. a) Les fonctions vis-à-vis du monde. Ces fonctions d’appréhension de la réalité objective se ramènent à trois et consistent à décrire les faits, élaborer les lois et expliquer les faits. o La description des faits consiste à les décomposer, en découvrir les différentes qualités, classer les faits en catégories, élaborer les types de ces faits. o Les lois scientifiques sont des liaisons entre les faits. Et le processus de recherche de ces liaisons constantes entre les faits s’appelle « analyse scientifique ». o L’explication des faits consiste à relier le plus grand nombre possible des phénomènes observés et des lois particulières en un ensemble cohérent commandé par un principe général explicatif du tout envisagé. b) les fonctions libératrices consistent à : o libérer l’homme et la société de la servitude et du dénouement. La science libère l’homme de la servitude (analphabétisation) o vaincre l’ignorance en combattant les fausses réponses issues de cette ignorance o affirmer l’autonomie de la conscience individuelle face à toute autorité et le droit inaliénable à la critique. I.3. Esprit scientifique L’esprit scientifique est généralement considéré comme un ensemble de dispositions intellectuelles ou morales que doit posséder un étudiant dès l’accès aux études universitaires. Ces prédispositions peuvent l’aider à mener son travail de recherche avec brio car l’aventure scientifique réside dans le goût, le choix et l’amour assidus de découvrir et de connaître quelque chose. L’esprit scientifique se caractérise par : - son ouverture qui use constamment d’autocritique et de doute méthodique ; - son refus de se baser sur l’a priori, mais sur l’observation critique des phénomènes ; - son souci de recourir aux idées objectives, à la relativisation des faits, à la volonté d’innover. I.4. GROUPEMENTS SCIENTIFIQUES 6 Les groupements scientifiques sont constitués : des institutions universitaires et supérieures, des académies, des sociétés savantes, des colloques et congrès, des bibliothèques, etc. 1.4.1. LES INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES ET L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR En R.D.C., il existe des Universités publiques et privées. C’est le cas de l’Université de Lubumbashi (UNILU), de Kisangani (UNIKIS), de Kinshasa (UNIKIN), l’Université protestante de Kinshasa (UPK), l’Université protestante de Lubumbashi (UPL), etc. Chaque université a des Facultés au sein desquelles se trouvent des départements. Les universités ont pour mission fondamentale de former des chercheurs spécialisés dans les domaines organisés dans chaque Faculté. Aux universités se rattachent des centres de recherche organisant la recherche fondamentale dans les domaines de leur mission. Chaque Faculté doit normalement organiser un centre de recherche. Les instituts supérieurs organisent des options de formation des cadres (produits finis) devant être utilisés directement dans uploads/Science et Technologie/ cours-d-x27-irs-2016-copie.pdf
Documents similaires


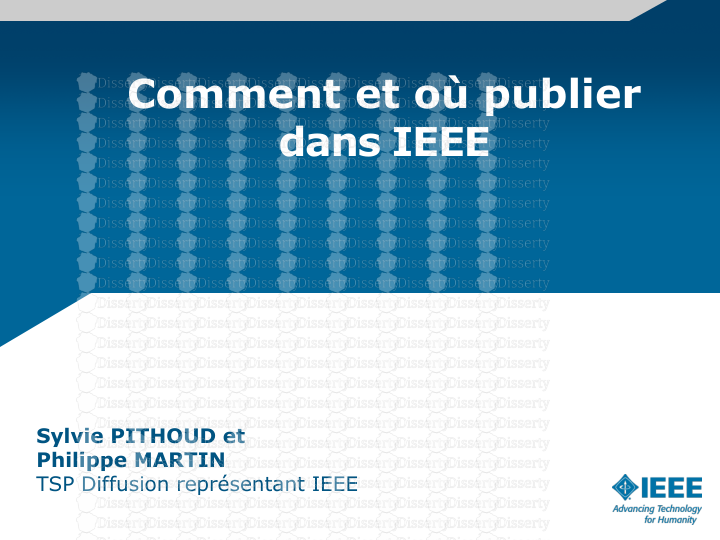







-
79
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 25, 2022
- Catégorie Science & technolo...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3482MB


