SECRET MEDICAL ET IMAGERIE Mémoire soutenu dans le cadre du Diplôme d'Etudes Ap
SECRET MEDICAL ET IMAGERIE Mémoire soutenu dans le cadre du Diplôme d'Etudes Approfondies en Ethique Médicale et Biologique (Directeurs: Pr. Y. PELICIER et Dr C.HERVE) Soutenu par Mr Philippe MERIOT le 20 juin 1994 ------------ INTRODUCTION La protection du colloque singulier entre le patient et le médecin est un principe admis de tous, un des fondements du contrat de soins. Comme le mentionne le Code de déontologie médicale en France dans son article 11, ce qui est confié au médecin, et donc au radiologiste, mais aussi "ce qu'il a vu, entendu ou compris" constituent le secret: secret professionnel, secret médical, information, vérité, mensonge... La radiologie, devenue imagerie médicale, constitue maintenant la septième discipline en médecine, regroupant la radiologie et imagerie médicale d'une part, la biophysique et médecine nucléaire d'autre part, et prend une place croissante au sein de la pratique médicale. Les radiologistes sont astreints comme tous leurs confrères au secret professionnel. Or, si nous retrouvons dans la littérature médicale beaucoup d'écrits sur l'image et sur le secret médical, les références traitant de façon spécifique la question du secret en imagerie médicale semblent absentes. La question n'intéresserait-elle pas les radiologistes, n'en ressentiraient-ils pas le poids ni les conséquences dans leur pratique? Nous n'avons volontairement pas repris dans le titre l'expression de "secret médical", celle-ci paraissant prendre un sens différent suivant les acteurs, un sens restrictif pour les juristes se référant aux textes réglementaires, les médecins, à travers leur Code de déontologie, l'élargissant à la notion de confidentialité et de vérité cachée, ce qui crée la situation paradoxale suivante: le secret médical ne peut pas être opposé au patient, mais celui-ci ne peut appréhender les connaissances exactes du médecin à son sujet. Cette ambiguïté se retrouve dans de nombreux ouvrages; nous avons pour notre part conservé le terme de "secret médical" lorsque nous abordons l'aspect réglementaire du problème, et utilisé dans la partie traitant de l'information du patient le mot "secret" avec ses variantes: vérité absolue, adaptée, déformée, cachée, non-dit,... quand il ne s'agit pas de l'absence physique du médecin. Nous tenterons de faire ressortir, dans ce travail, la problématique spécifique que pose le secret au radiologiste, en raison des particularités de son environnement et de ses relations. Nous verrons dans la première partie les textes se référant au secret médical, non de façon exhaustive, mais en s'arrêtant à ceux qui intéressent le radiologiste. La deuxième partie portera sur les caractères du secret médical en radiologie. Les attitudes du radiologiste devant l'information au patient seront schématisées, et à partir de ces hypothèses, nous tenterons de dégager une logique, une cohérence dans la prise en charge des malades. La troisième partie, utilisant des interrogatoires de patients ayants subi certains de ces examens, illustrera le vécu et les ressentiments qui peuvent apparaître lors de ces actes radiologiques. ------------ I - LES TEXTES Trois textes mentionnant le secret médical sont abordés: le Code pénal, le Code de déontologie et le serment d'Hippocrate; la spécificité de l'imagerie , bien sûr, n'y apparaît pas. 1° - SECRET MEDICAL ET CODE PENAL A la différence des pays anglo-saxons, où il ne subsiste que sous la forme de directives déontologiques, le secret médical en France est garanti par une loi du Code pénal napoléonien de 1810, l'article 378, qui en fait une obligation légale. Le texte initial a été plusieurs fois modifié par l'ajout de mots ou d'alinéas, jusqu'à la loi du 23 décembre 1980. Compte tenu de la promulgation très récente du nouveau Code pénal, qui est entré en vigueur le premier mars 1994, la plupart des ouvrages et articles concernant le secret médical ne font référence qu'à l'ancien Code pénal. L'article 226-13 remplace maintenant l'article 378 de l'ancien Code pénal. La relation de confiance, qui se crée entre le malade et son médecin, et qui doit être absolue, impose à ce dernier de protéger l'intimité de son patient en observant le devoir de discrétion créé par le contrat de soin. Ce devoir a suivi, depuis l'élaboration du code pénal en 1810, une évolution chronologique en trois étapes: - une première étape, celle de la thèse contractuelle, repose sur le contrat tacite et privé entre le malade et son médecin, pendant une partie du XIXème siècle et s'harmonise avec l'esprit libéral individualiste, le secret devant être respecté dans l'intérêt même du patient; - la deuxième étape est celle de l'ordre public, dépassant le cadre particulier du colloque médecin-patient, et concerne plus généralement les garanties apportées par la société à l'exercice normal de la médecine. Cette conception tient compte du fondement social de l'article 378. Personne n'est propriétaire des secrets du patient, et notamment pas le médecin, qui ne les a reçu que pour exercer sa mission de soins ; il n'en est que le dépositaire. - la troisième étape, récente, est celle des intérêts sociaux, ces intérêts entraînant dans certains cas la révélation, le partage du secret professionnel. Des mesures sociales et sanitaires devenues nécessaires, puis des études épidémiologiques se sont heurtées au secret médical et à l'impossibilité d'obtenir des médecins les renseignements, voire les dénonciations nécessaires, par exemple dans la lutte contre les sévices à enfants, les épidémies, le contrôle des prestations d' assurance-maladie. Trois dérogations ont été incluses à l'origine sous forme d'alinéas dans l'article 378 de l'ancien Code pénal, concernant la dénonciation des avortements, les sévices ou privations sur les mineurs de 15 ans et, avec l'accord de la victime, la suspicion de viol ou d'attentat à la pudeur. Le nouveau Code pénal précise dans son article 226-14 que les sanctions prévues en cas de violation du secret médical ne sont pas applicables " dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ". Deux alinéas sont ensuite ajoutés, concernant des dérogations; le deuxième permet au médecin la dénonciation aux "autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans", reprenant en cela les dénonciations mentionnées à l'article 378. Une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique". Notons que le radiologiste est concerné par cet alinéa: les radiographies, les examens scanographiques, l'échographie, voire l'I.R.M. sont sollicités pour étayer un diagnostic suspecté de sévices ou de mauvais traitements. En général, les documents produits servent à confirmer l'hypothèse du clinicien, qui, sur un faisceau d'arguments convergents, peut engager une procédure, mais on pourrait imaginer que le radiologiste soit directement impliqué. Enfin, d'autres dérogations sont prévues par les textes, notamment la déclaration de certaines maladies contagieuses, des maladies vénériennes, des accidents du travail, des maladies professionnelles, la déclaration des naissances et des décès, les renseignements destinés aux médecins conseils des caisses d'assurance-maladie... Ainsi le secret médical, dans le milieu de la santé et des services sociaux, n'est plus absolu. En dehors des dérogations précises, l'obligation de secret demeure pour tout ce qui n'est pas expressément visé par les textes. 2°- LE CODE DE DEONTOLOGIE ET LE SECRET MEDICAL Etymologiquement science du devoir, la déontologie, à travers les codes professionnels, fixe actuellement les règles et devoirs imposés à l'intérieur de corps de métiers, à la différence du code pénal. La déontologie se place aux confins de la morale et du droit, empiétant sur l'une et sur l'autre. La règle du secret médical comme obligation déontologique s'est développée en France au cours du XIXème siècle, sous l'impulsion de l'article 378 du Code pénal de 1810. La parenté revendiquée du serment d'Hippocrate, dans la rédaction du Code de déontologie, ne doit pas faire oublier que la notion de secret médical ne s'est pas transmise de façon continue jusqu'à nous. Durant tout le XIXème siècle, certaines associations de médecins demandèrent l'édition de règles de déontologie, mais ce n'est qu'en 1947 qu'un Code de déontologie sera promulgué sous forme de décret, après que la profession se soit dotée d'un Ordre juridiquement organisé, pourvu d'un contrôle disciplinaire. Il est à noter cependant que le Code de déontologie ne se contente pas de réglementer la profession de médecin et les rapports entre médecins, il précise également les rapports entre les médecins et les malades, éléments extérieurs à la corporation. De même, le directeur d'un l'hôpital, représentant du service public, doit donc tenir compte de règles de déontologie qui s'appuient traditionnellement sur le modèle libéral. Enfin, le Code de déontologie médicale réglemente, par des textes différents, deux problèmes: la violation du secret professionnel et la circulation de l'information. 3°- LE SERMENT D'HIPPOCRATE La tradition déontologique fait remonter le secret médical à Hippocrate et à l'école de Cos, au Vème siècle avant J.C. Le serment d'Hippocrate n'est en aucune façon un texte réglementaire. Mais il s'agit du premier texte mentionnant le secret médical, et de façon très précise, puisqu'il en contient la définition: "Quoi que je voie ou entende dans la société pendant l'exercice ou même hors de l'exercice de ma profession, je tairai ce qui n'a pas besoin d'être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas". II - SECRET uploads/Sante/ secret-medical-et-imagerie.pdf
Documents similaires
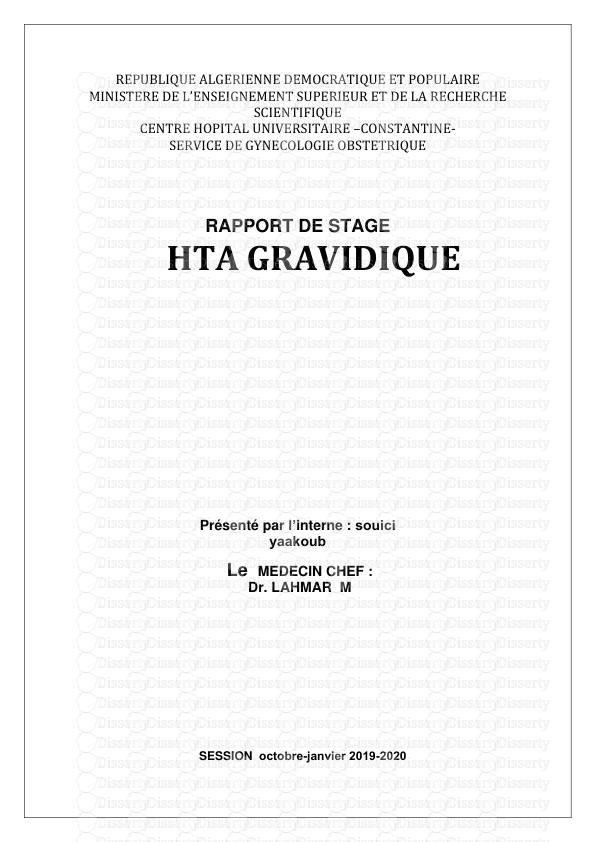









-
97
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 18, 2021
- Catégorie Health / Santé
- Langue French
- Taille du fichier 0.1020MB


