Le monde des passions est un monde étrange où gravitent des individus mus par d
Le monde des passions est un monde étrange où gravitent des individus mus par des forces qui sont en eux malgré qu’ils en aient et pourtant qu’ils contribuent à alimenter même au prix de leur destruction. On comprend que Kant ait pu écrire dans son Anthropologie du point de vue pragmatique que « la passion est une maladie qui exècre toute médication ». En la définissant ainsi, le philosophe l’assimile, conformément au sens grec de pathos à l’univers de la médecine mais à la différence des maladies physiologiques, il attribue à la passion un refus radical de se guérir qu’il exprime avec un verbe, « exécrer » qui indique une passion, celle de la détestation ou de la haine. Autrement dit, le sujet affecté d’une passion ne pourrait se donner comme but de guérir contrairement au sujet affecté d’une maladie physiologique, ce qui assimile la passion à une maladie de l’esprit ou affection psychologique particulièrement grave, à savoir une véritable aliénation dans tous les sens du terme. Or, une maladie est ce qui affecte, du dehors, le corps, le dérègle et contre quoi il lutte sans quoi il meurt. Si la passion est une maladie affectant l’âme, il faudrait qu’elle pût aussi laisser une place à la guérison puisque la raison ne disparaît pas dans l’exercice de la passion comme c’est le cas dans la vraie folie. Le propos de Kant paraît alors paradoxal puisque la passion qui refuse la guérison mime finalement un état normal, celui d’un être qui se sent lui-même, qui mène son projet sans état d’âme. N’est-ce pas que la passion, loin d’être une maladie, est bien plutôt le régime tout à fait normal auquel l’homme aspire, qu’il cherche et dans lequel il reste s’il le trouve ? Une vie sans aucune passion n’est-elle pas au contraire terne, sans intérêt, voire impossible ? L’homme n’est-il pas en un sens responsable de sa passion ? Si par contre la passion paraît bien mauvaise, n’est-il pas bien plutôt possible à l’individu de s’en rendre compte et de tenter de s’en débarrasser ? En nous appuyant sur Andromaque de Racine, La Cousine Bette de Balzac et la Dissertation sur les passions de Hume, nous verrons en quoi on peut souscrire à la thèse de Kant selon laquelle la passion comme maladie qui exècre toute médication, puis en quoi la passion peut être considérée comme en elle-même tout à fait normale avant de voir en quoi le caractère pathologique de la passion apparaît lorsqu’elle s’oppose à l’ordre social. Qu’une passion soit une maladie au sens où l’entend Kant exige de préciser que par passion, il ne faut pas entendre tout mouvement de l’âme, c’est-à- dire une notion un peu large du terme comme l’utilise Hume notamment, mais un mouvement de l’âme exclusif, qui écarte tous les autres. En ce sens, l’idée de passion calme que défend Hume est une contradiction dans les termes (cf. section V). La passion est violente ou n’est pas. Et c’est cette exclusivité qui permet de la comprendre comme maladie. Car, de même que la prépondérance d’une fonction vitale sur toutes les autres crée un déséquilibre qui fait la maladie physique, la prépondérance d’un mouvement sur tous les autres fait la maladie psychique. Un homme psychiquement en bonne santé peut à la fois s’occuper de sa famille, de son métier, des relations avec les uns et les autres. Au contraire, le baron Hulot, préoccupé de satisfaire sa seule passion d’érotomane, cet « homme à passions » comme le nomme Josépha, sacrifie femme, enfants, métier même en se lançant dans d’hasardeuses et frauduleuses spéculations avec l’oncle de sa femme, Fischer. Oreste est victime de mélancolie (cf. Acte I, scène 1, la première réplique de Pylade, v.17 er sq.). Ce qu’il faut entendre comme une maladie qui le dispose à la tristesse. Mais sa passion pour Hermione produit un aveuglement sur lui-même qui se retrouve par exemple chez Pyrrhus, qui, transporté par son mariage avec Andromaque, est incapable de prendre les précautions nécessaires pour sa propre sécurité, refusant même d’écouter les sages conseils de son gouverneur Phoenix qui l’invite à se méfier d’Hermione (Acte IV, scène 6). Mais si la passion est une maladie, ne peut-on pas la soigner comme toute autre maladie ? On peut admettre avec Hume que le combat de la passion et de la raison est une chimère en ce sens que la raison au sens strict, comme jugement du vrai et du faux, est incapable de donner un motif à la volonté (V, 1). Elle peut certes, en touchant les plaisirs ou les peines, susciter quelque chose touchant les passions, mais encore faudrait-il qu’elle le voulût. C’est qu’en effet, dans le cas d’une maladie physique, l’esprit sain recherche à se soigner. Dans le cas d’une maladie psychique, l’esprit par définition, ne le peut pas. Le paradoxe de la passion, c’est qu’elle permet la réflexion mais de telle sorte qu’elle est tout entière soumise à la passion. On le voit bien lorsque le baron Hulot d’Ervy en fait l’aveu à sa femme. Quoi qu’il déteste Josépha qui l’a trahi, il ne pourrait s’empêcher de la retrouver si elle le lui demandait (12. Monsieur le baron Victor Hulot d’Ervy). Ainsi, à la scène 1 de l’acte III, Oreste explique-t-il à Pylade que la nouvelle du mariage de Pyrrhus avec Hermione que celui-là lui a annoncé a frappé sa raison. On voit donc qu’Oreste, obnubilé par sa passion pour Hermione, qui espérait l’emmener, devient furieux. Ce qui montre en quoi ce but exclusif qui définit la passion, fragilise le sujet qui ne peut qu’être transporté ou foudroyé par les coups du sort. Est-ce à dire qu’on pourrait combattre la passion par la passion ? Au XIX° siècle, une cure qui consistait à entrer dans le délire du patient était mise en œuvre. On parle de traitement moral. Ainsi un patient qui se croyait mort refusait de s’alimenter. La mise en place d’un faux jugement dernier permit de le convaincre de s’alimenter (cf. Michel Foucault, Le pouvoir psychiatrique). On voit en quoi on calme le délire mais on ne le soigne pas. Ainsi, Et si la passion du baron Hulot pour madame Marneffe remplace Josépha, ce n’est pas tant une cure que la prolongation de la même passion. C’est pourquoi il en change dès qu’il perd une maîtresse pour finir avec un laideron qu’il épouse. Personne n’arrive à changer l’état du baron. De même, Phoenix finit par entrer dans le vœu de Pyrrhus de voir Andromaque tout en lui faisant remarquer qu’il reste épris d’elle. Son ironie ne change rien à la résolution de Pyrrhus qui ne la comprend pas. Aussi ne réussit-il pas mieux à écarter son ancien élève (Acte II, scène 5). Hume nous explique que ce qui nourrit la passion, ce sont des causes appuyées par la double relation d’idées et d’impressions (II, 3). Ainsi, si un sujet reçoit des bienfaits, des plaisirs d’une autre et s’il y a ressemblance, contiguïté et causalité dans les idées, l’amour est renforcé. Même la haine qui semble contraire peut renforcer l’amour. Dès lors, la guérison de la passion paraît impossible. Néanmoins, si la passion ne peut être guérie, c’est peut-être parce qu’elle n’est pas une maladie car si elle domine toujours la raison, n’est-ce pas que celle-ci ne peut en aucun cas organiser la bonne harmonie des tendances ? Ne faut-il pas alors penser que la passion en tant que dominante, est précisément ce qui organise la vie du sujet, ce qui fait son unité ? Dès lors, la passion n’est-elle pas l’état normal de l’homme et l’absence de passion ou sa faiblesse au contraire une sorte de déficience ? En effet, on peut entendre la passion au sens large de motif de nos actions déterminées par la représentation des biens et des maux. C’est ainsi que l’entend à juste titre Hume dès le début de sa Dissertation sur les passions. Ainsi, lorsqu’un bien nous apparaît, nous le cherchons si nous ne l’avons pas ressenti et nous sommes satisfaits lorsque nous le sentons. Aussi une passion produit-elle aussi un plaisir si elle est satisfaite, mais cette satisfaction n’ôte pas toujours la passion correspondante. Et plus le plaisir est vif, plus la passion est forte. C’est ainsi qu’une passion peut dominer les autres dans le même individu sans qu’il soit nécessaire de considérer que n’est une passion que le désir dominant. Il est clair que la passion ne peut disparaître que si ce qui donne du plaisir n’en donne plus. Ainsi le baron Hulot d’Ervy est-il resté fidèle et véritablement amoureux de sa femme durant douze années avant de se tourner vers d’autres femmes. La raison en est qu’il était désœuvré et il s’est enfoncé dans la passion. Il s’est mis en service actif auprès des femmes. Il y a donc eu modification du plaisir pour qu’il change ainsi. Mais ce qui ne change pas en lui, c’est sa passion pour les femmes. À l’inverse, Hermione est fidèle en quelque sorte à Pyrrhus qu’elle aime et à qui uploads/Sante/ vue-pragmatique-que-la-passion-est-une-maladie-qui-execre-toute-medication.pdf
Documents similaires








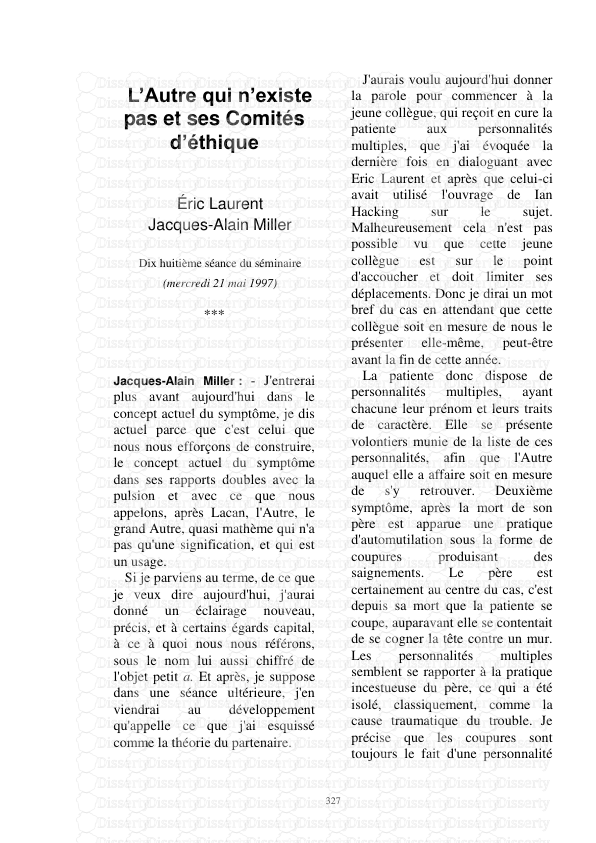

-
59
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 13, 2022
- Catégorie Health / Santé
- Langue French
- Taille du fichier 0.3108MB


