Anne reboul in Berthoud A-C Mondada L eds Modèles du discours en confrontation Berne Peter Lang - Pourquoi l ? analyse du discours a-t- elle besoin d ? une théorie de l ? esprit Anne Reboul Institut des Sciences Cognitives CNRS UPR Bd Pinel Bron cedex Fra
in Berthoud A-C Mondada L eds Modèles du discours en confrontation Berne Peter Lang - Pourquoi l ? analyse du discours a-t- elle besoin d ? une théorie de l ? esprit Anne Reboul Institut des Sciences Cognitives CNRS UPR Bd Pinel Bron cedex France Jacques Moeschler Département de Linguistique Université de Genève rue de Candolle Genève Introduction Dans la littérature publiée sur le discours dans les trente dernières années une hypothèse forte s ? est fait jour celle selon laquelle le discours constitue une nouvelle unité linguistique au même titre que le phonème le morphème et la phrase Il y a deux façons de concevoir cette unité soit à l ? image du phonème ou du morphème comme une unité minimale en dessous de laquelle on ne peut descendre soit à l ? image de la phrase comme une unité divisible composée d ? éléments de rang inférieur mais qui a ses règles propres gouvernant sa bonne formation et son interprétation Dans deux ouvrages récents Reboul Moeschler a et b nous nous sommes élevés contre cette hypothèse du DISCOURS comme une unité linguistique à part entière et nous avons défendu la thèse selon laquelle la production et l ? interprétation des discours ne dépendent pas de règles spéci ?ques mais obéissent aux mêmes principes pragmatiques généraux qui gouvernent l ? interprétation des énoncés Nous avons ainsi développé dans le cadre théorique de la pragmatique de la pertinence cf Sperber Wilson une analyse de ce qu ? est l ? interprétation des discours en partant d ? une dé ?nition extrêmement réduite de ce qu ? est un discours Dé ?nition du discours Un discours est une suite non-arbitraire d ? énoncés Les majuscules suivant une convention introduite dans Reboul Moeschler b nous permettent de distinguer les notions de l ? ANALYSE DE DISCOURS que nous critiquons de celles de notre pragmatique du discours qui restent en minuscules Reboul Moeschler Lausanne - novembre Cin Berthoud A-C Mondada L eds Modèles du discours en confrontation Berne Peter Lang - Cette dé ?nition place clairement le discours dans le domaine de la pragmatique il y est question d ? énoncé plutôt que dans celui de la linguistique il n ? y est pas question de phrase Dans l ? optique de la théorie de la pertinence le locuteur qui produit un énoncé a deux intentions une intention informative l ? intention de rendre manifeste ou plus manifeste à son interlocuteur un ensemble d ? assomptions et une intention communicative l ? intention de rendre mutuellement manifeste qu ? il a cette intention informative L ? interlocuteur a l ? intention de récupérer l ? ensemble d ? assomptions qui font l ? objet de l ? intention informative du locuteur L ? ensemble du système repose sur l ? idée que la communication dépend de façon cruciale de la capacité à attribuer à autrui des croyances et des intentions C ? est cette capacité que l ? on a désignée dans la
Documents similaires





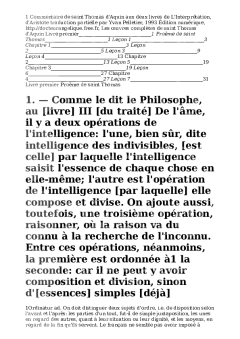




-
44
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Aucune attribution requise- Détails
- Publié le Mai 01, 2022
- Catégorie Philosophy / Philo...
- Langue French
- Taille du fichier 106.3kB


