Introduction: Le droit administratif et l’invention du juge La spécificité du d
Introduction: Le droit administratif et l’invention du juge La spécificité du droit administratif français, par rapport à la plupart des systèmes juridiques en vigueur dans le monde, est de devoir ses caractéristiques et ses principes fondateurs à l’esprit révolutionnaire, et d’avoir trouvé ses premiers développements dans la volonté d’organisation et de toute-puissance de l’État du Premier Empire. Nées dans ces circonstances historiques particulières au début du XIXème siècle, les structures et les principes du droit administratif ont été progressivement modifiés, parallèlement à l’évolution des régimes politiques français vers la République, par une institution possédant la particularité d’être à la fois le conseiller du Gouvernement et le juge administratif suprême : le Conseil d’État. Depuis la naissance du droit administratif, il a toujours été de principe que certaines activités des personnes publiques ou des personnes privées chargées d'un service public, plus ou moins étendues selon la qualité des personnes, les modes et les domaines d'intervention devaient faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. Cette tâche de contrôle de l'activité administrative directe ou indirecte et de la qualité des personnes qui l’accomplissent devait être confiée à l’origine à une organisation juridictionnelle spécialisée : une juridiction administrative. Néanmoins, en raison de l’ambiguïté initiale de la législation, il s’est vite avéré que certains litiges s’élevant entre les particuliers et les prestataires d’activités administratives pouvaient parfois entrer dans la compétence du juge judiciaire. Si le contrôle juridictionnel de l'activité administrative est en principe confié à un juge spécifique, le juge administratif, il relève ainsi du juge judiciaire soit dans ses fonctions répressives, où il peut se trouver amené à apprécier la régularité d'un acte administratif, soit dans ses fonctions civiles, où il aura par exemple à prononcer la responsabilité des personnes publiques et des personnes privées chargées de la gestion d'un service public. En revanche, ce contrôle n’appartient jamais au Conseil constitutionnel sauf en matière de délimitation des compétences (art. 37 de la Constitution de 1958), et en matière d'organisation des opérations électorales (où il peut être amené à apprécier la régularité d'un décret). La question de savoir si un contentieux appartient au juge administratif ou au juge judiciaire est donc d’une importance cruciale. D’une part, elle définit, en première approximation, l’ensemble des litiges soumis au droit administratif et les domaines d’application matérielle de ce droit. D’autre part, elle permet à la fois de poser les principes de répartition et d’étudier les déplacements constants et progressifs de la compétence du juge administratif, en général à son détriment. Les développements qui suivent ont pour but d'exposer les principes fondamentaux de la justice administrative, c'est-à-dire l'existence des juridictions administratives; leur fondement historique dans la séparation des autorités administratives et judiciaires; les problèmes posés par la répartition des compétences entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire et leur solution par le Tribunal des conflits; l'architecture générale des recours contentieux dont disposent les particuliers. - 2 - Chapitre 1 : La délimitation d’un contentieux administratif La perfection n'est pas de ce monde et l’activité administrative ne peut pas régler toutes les situations en satisfaisant à la fois l'intérêt déclaré général et les intérêts des particuliers. Il arrive donc qu'apparaissent des litiges entre les particuliers et les personnes publiques ou les personnes privées chargées de la gestion d'un service public. Pour régler ces litiges, les intéressés peuvent tout d'abord s'adresser à la personne concernée en la saisissant d'un recours administratif. Sont ainsi des recours administratifs, les recours gracieux par lesquels les intéressés demandent à l'autorité qui a pris l'acte de régler elle-même une contestation qui s'élève à son propos; les recours hiérarchiques par lesquels les intéressés demandent à l'autorité hiérarchique supérieure de régler une contestation née d'un acte pris par un de ses subordonnés; les recours prévus par la loi du 2 mars 1982 par lesquels des particuliers demandent au préfet de déférer un acte d'une autorité locale au contrôle du tribunal administratif (« déféré provoqué »); les recours de tutelle, par lesquels un intéressé demande à l'autorité de tutelle d'annuler un acte pris par une autorité administrative placé sous sa tutelle. Enfin, il existe des possibilités de conciliation, de transaction ou d'arbitrage, qui demeurent facultatives, mais que le Conseil d'Etat souhaite encourager (Cf. Régler autrement les conflits, Etude du CE, Doc. fr. 1993). Il est ainsi possible d’obtenir du président du tribunal administratif, en l’absence de tout litige né, l’homologation d’une transaction (CE avis, 6 décembre 2002, Synd. intercom. de l’Haÿ-les-Roses, Rec.xxx, AJDA.xxx) destinée à remédier aux conséquences d’une annulation, d’une illégalité non régularisable, ou de difficultés particulières d’exécution. Depuis 1973, il faut ajouter la possibilité pour les particuliers d'adresser des réclamations au médiateur. Il s'agit d'une personnalité nommée en Conseil des ministres pour six années non renouvelables, et dotée de pouvoirs d'investigation et de divulgation pour intervenir auprès des autorités administratives. Les arguments que l'on fait valoir devant le médiateur peuvent être fondés sur le droit mais aussi sur l'opportunité, l'équité. Ces réclamations ne sont pas soumises à une procédure particulière, hormis le fait qu'elles doivent être initialement transmises au médiateur par un parlementaire. Depuis 1977, il faut également mentionner les recours spéciaux que tout intéressé peut adresser, dans les matières qui les concernent respectivement, aux autres autorités administratives indépendantes. Lorsque ces recours ne sont pas exercés, ou ont été épuisés, les intéressés peuvent aussi introduire des recours juridictionnels. C'est l'évolution de ces recours, jointe aux données de l'organisation des juridictions administratives, qui explique historiquement la formation du droit administratif. Cours de droit administratif – © Pr Gilles J. Guglielmi 2004 - 3 - Section I : L’absence de choix par les constituants La naissance du contentieux administratif résulte de la fondation initiale d’organes qui ont ensuite, progressivement, constitué un ordre juridictionnel et produit à la fois les arguments de leur légitimation et un droit administratif matériel. Elle peut être décrite en trois temps. 1°) En 1790, l'Assemblée constituante est saisie de deux propositions d'organisation qu'elle rejette toutes les deux. La première était de confier aux tribunaux judiciaires l'intégralité du contentieux administratif. Elle fut refusée en raison de la crainte très présente à l'époque, de voir se renouveler les abus des Parlements de l'Ancien Régime, qui avaient parfois réussi à paralyser l'action du pouvoir exécutif (d'où la nécessité de l'Edit de Saint-Germain en 1641). Les constituants affirment donc la séparation des autorités administratives et judiciaires dans la loi des 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction ». Parce qu'elle fut difficile à faire respecter, cette loi dut être confirmée par celle du 16 fructidor an III : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit ». La deuxième proposition était de confier le contentieux administratif à des tribunaux administratifs. Cette solution fut rejetée car elle entraînait la fondation de juridictions d'exception dont on avait eu expressément la volonté de supprimer le principe. Conséquence de ce double rejet : c'est aux autorités administratives qu'est attribué le soin de se juger. Les directoires de département et de districts, autorités exécutives locales, sont juges des affaires locales (loi des 7-11 septembre 1790). Le Conseil des ministres, présidé par le Roi (loi des 27 avril-25 mai 1791), puis les ministres eux-mêmes (Constitution du 5 fructidor an III) pour ce qui concerne les affaires de leur compétence sont appelés à régler les litiges auxquels leurs services sont parties prenantes. C'est le système de l'administrateur- juge. Tout le travail de la théorie juridique de droit public dans la première moitié du XIXème siècle consiste à justifier ce système en affirmant que juger l'administration, c'est aussi administrer : il n'est donc pas nécessaire d'avoir recours à une fonction juridictionnelle entre les autorités administratives et le ministre, c'est-à-dire au cœur d'une personne publique, et une fonction juridictionnelle judiciaire ne saurait s'exercer au-dessus des ministres puisqu'il est interdit aux tribunaux de connaître des actes d'administration. 2°) Dix ans plus tard, en l'an VIII, la conséquence de cette situation est concrétisée au plan organique. C'est la constitution de juridictions administratives, le Conseil d'État (Constitution du 22 frimaire an VIII) et les conseils de préfecture (la loi du 28 pluviôse an VIII en fonde un par département). Les juridictions administratives ainsi fondées sont distinctes des services administratifs actifs des personnes publiques. Cependant, elles sont aussi leurs conseils (comme leur nom l'indique). De plus, les ministres conservent leur fonction juridictionnelle pour les affaires de leurs services. C'est le système du ministre-juge. Ce sont là les institutions de base de la juridiction administrative pendant presque un siècle. Il faut alors décrire l’évolution que leur a imprime le Conseil d’Etat de 1800 à 2000. Cours de droit administratif – © Pr Gilles J. Guglielmi 2004 - 4 - Section II : L’unification par le Conseil d’Etat a) Les ministres sont les juges de droit commun en premier ressort uploads/s1/ complement-cours.pdf
Documents similaires



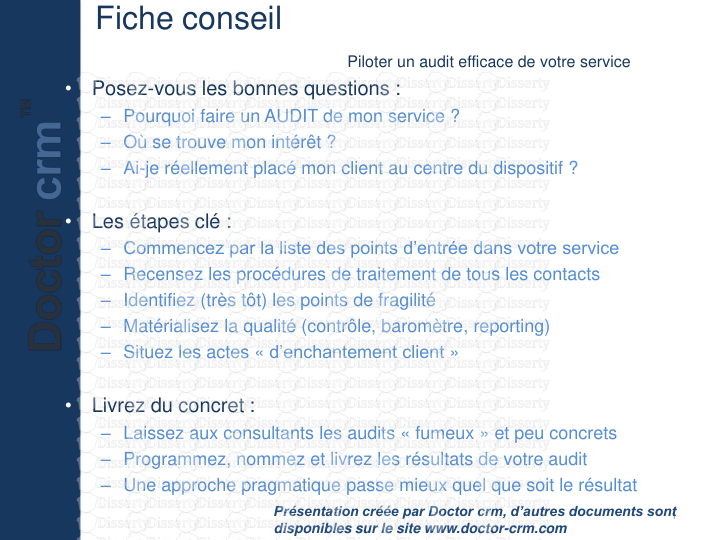






-
75
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 25, 2021
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 1.0571MB


