DU CONTRAT SOCIAL Du même auteur dans la même collection LES CONFESSIONS (deux
DU CONTRAT SOCIAL Du même auteur dans la même collection LES CONFESSIONS (deux volumes). DISCOURS SUR L’ÉCONOMIE POLITIQUE. PROJET DE CONSTITUTION POUR LA CORSE. CONSIDÉRATIONS SUR LE GOUVERNEMENT DE POLOGNE. DIALOGUES. LE LÉVITE D’ÉPHRAÏM. DISCOURS SUR L’ORIGINE ET LES FONDEMENTS DE L’INÉGALITÉ PARMI LES HOMMES. DISCOURS SUR L’ORIGINE ET LES FONDEMENTS DE L’INÉGALITÉ PARMI LES HOMMES. DISCOURS SUR LES SCIENCES ET LES ARTS. ÉMILE OU DE L’ÉDUCATION (édition avec dossier). ESSAI SUR L’ORIGINE DES LANGUES ET AUTRES TEXTES SUR LA MUSIQUE. JULIE OU LA NOUVELLE HÉLOÏSE. LETTRE À D’ALEMBERT (édition avec dossier). PROFESSION DE FOI DU VICAIRE SA VOYARD (édition avec dossier). LES RÊVERIES DU PROMENEUR SOLITAIRE (édition avec dossier). ROUSSEAU DU CONTRAT SOCIAL Présentation, notes, bibliographie et chronologie par Bruno BERNARDI GF Flammarion © Flammarion, Paris, 2001, pour la présente édition. Édition revue et mise à jour en 2012. ISBN : 978-2-0812-7523-2 www.centrenationaldulivre.fr INTRODUCTION Pour lire le Contrat social Les livres les plus célèbres ne sont pas les mieux connus. Le Contrat social vérifie la règle jusqu’à l’épure 1. Objet de scandale lors de sa parution et occulté par ce scandale, il allait connaître une éclatante consécration durant les premières phases de la période révolution- naire. Mais, comme souvent en pareil cas, ce fut au prix d’une instrumentalisation qui pèsera durablement sur sa lecture. Le Contrat social était devenu un symbole. Dénoncé comme porteur de la substitution de la tyrannie du peuple à celle de l’Ancien Régime ou brandi comme étendard de la souveraineté et de la liberté, il devait pro- gressivement être neutralisé par sa reconnaissance comme grand texte fondateur du républicanisme fran- çais. Entré avec Rousseau au Panthéon, il a très vite acquis le statut d’un monument : visité, honni ou révéré, rarement questionné. Pour qu’une lecture vivante en soit possible, il fallait qu’un ensemble de conditions soient réunies. L’homme Rousseau (il est hors de propos d’examiner ici la part qu’il y prit) a longtemps occulté le penseur; les «contrariétés» de la personnalité ont accrédité le préjugé d’un défaut de cohérence de la pensée. Au cours du 1. Pour distinguer l’ouvrage et le concept, on devrait écrire Du contrat social. Outre le risque de cacophonie, l’usage constant des Confessions, et des Dialogues, nous conduit à désigner l’ouvrage comme faisait son auteur : «le Contrat social». L’emploi de l’italique évitera toute ambiguïté. DU CONTRAT SOCIAL 6 XXe siècle, un ensemble de travaux (dont Cassirer a donné le départ) ont permis de reconnaître son caractère pleinement philosophique et sa profonde unité 1. L’inser- tion de l’œuvre dans l’histoire de la philosophie devait être également établie, tant était grande la tendance à voir en l’auteur un amateur inspiré, produit d’une géné- ration spontanée. De nombreuses publications, souvent dans les Annales J.-J. Rousseau, ont restitué la profon- deur des textes, mis à jour le travail dont ils procèdent. Robert Derathé y a pris, pour la philosophie politique, une part prépondérante2. En un siècle, la précision de notre lecture de Rousseau a fait des progrès considé- rables 3. Cependant, dans le cas du Contrat social, les deux fronts des études rousseauistes ne se sont pas vrai- ment unifiés 4. Ceux qui se sont attachés à l’unité philoso- phique de la pensée ont choisi d’autres points de focalisation : les œuvres antérieures, la pensée religieuse, la philosophie du langage ou de l’éducation. À l’inverse, le texte du Contrat a fait l’objet de l’attention des histo- riens de la philosophie; bien des pages ont été éclairées d’un nouveau jour. Mais aucune lecture globale ne s’est dessinée. Marquante est à cet égard la déshérence dans laquelle les livres III et IV sont restés. Sans doute est-ce 1. La dignité philosophique de Rousseau avait été reconnue en Alle- magne mieux qu’en France : Kant, Fichte, Hegel en font un interlocu- teur majeur. Cassirer («Das problem J.-J. Rousseau», 1912) la réaffirme en ouvrant une problématique philologique et historique. Les noms de Gouhier, Polin, Starobinski, Goldschmidt, Philonenko, Derrida marquent cette entreprise. Tous les ouvrages et les auteurs cités en introduction sont référencés en fin de volume, dans la Bibliographie. On trouvera de même en fin de volume les précisions chronologiques. 2. De J.-J. Rousseau et la science politique de son temps à son édition critique du Contrat social. Il faut noter, dans les dernières décennies, l’apport anglo-saxon à cette mise en perspective historique : après Vaughan et Leigh, on citera Masters, Shklar, Riley, Hulliung. 3. L’édition des Œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, en 5 volumes (1959-1995) condense l’essentiel de cet acquis. Édition notée ici OC I à V . 4. M. Viroli, La Théorie de la société bien ordonnée chez Jean-Jacques Rousseau (1988), fait à cet égard exception. INTRODUCTION 7 pourquoi les mêmes oppositions manichéennes dans l’interprétation ont pu perdurer. Aussi bien, pour qu’un texte puisse véritablement nous parler, une troisième condition doit être remplie : que nous ayons des questions à lui poser. Peut-être est-ce à nouveau le cas pour le Contrat social ? Mark Hulliung estime dans un livre récent 1 «le temps venu pour nous de faire faire un pas en avant à l’interprétation usuelle des Lumières», en prenant mieux en compte «les moments de doute de soi», et «d’autocritique». Il pro- pose de voir en Rousseau la figure privilégiée de cette «autocritique des Lumières». Cette perspective me paraît d’autant plus féconde qu’elle tire sa nécessité de ce que nous avons, pour notre compte, à penser : notre capacité à reconnaître la dimension autocritique de la pensée des Lumières commande la conscience critique que notre époque peut avoir d’elle-même. Nos questions les plus pressantes, singulièrement en philosophie poli- tique, mettent en jeu nos décisions sur l’héritage des Lumières. Sans doute la formule célèbre («Tel est le pro- blème dont le contrat social donne la solution») a-t-elle contribué à masquer ce fait essentiel : Rousseau, dans le Contrat social, est constamment occupé à poser des problèmes, à mettre en évidence des contradictions, à penser la politique comme un champ de tensions qu’il s’agit de reconnaître et de faire travailler. Aborder le Contrat social sous cet angle, c’est chercher à y lire, avant les réponses qu’il donne, les questions qu’il se pose. Des Institutions politiques au Contrat social Le Contrat social paraît, en mai 1762, avec l’Émile. Le scandale est immédiat, à Paris comme à Genève, mais porte avant tout sur les pages qui, dans les deux ouvrages, concernent la religion : la Profession de foi du 1. The Autocritique of Enlightenment. Rousseau and the Philosophers (1994), p. 7. DU CONTRAT SOCIAL 8 vicaire savoyard et le dernier chapitre du Contrat sur «la religion civile» 1. La prise en compte de la théorie poli- tique de Rousseau sera freinée par ce contexte. L’Anti- Contrat social de Bauclair (1764) fait exception. Si les thèses politiques sont débattues à Genève, c’est en contrepoint de la querelle religieuse. Les Lettres écrites de la Campagne de J.-R. Tronchin donneront à Rousseau l’occasion, dans ses Lettres écrites de la Montagne (1764), de revenir sur ses conceptions politiques. Mais ce texte est trop lié à la politique genevoise pour avoir eu un grand retentissement européen. Certes, des lecteurs aiguillonnés par leurs propres préoccupations politiques vont demander à Rousseau de prolonger ses Principes du droit politique par des travaux de politique appliquée : le Projet de Constitution pour la Corse et les Considérations sur le Gouvernement de la Pologne 2. Mais ces textes furent publiés après la mort de Rousseau. Si, dans les années qui suivent la parution du Contrat, la pensée poli- tique occupe une bonne part de l’attention de Rousseau, la partie émergée de l’œuvre est tournée vers un tout autre horizon : les Confessions, puis les Dialogues, enfin les Rêveries ou encore la musique puis la botanique. Il faut prendre acte de ce que, du vivant de Rousseau, le Contrat social est à la fois célèbre et négligé 3. Plus géné- ralement le contraste est grand entre l’importance que Rousseau accordait à la politique et la perception de son œuvre. Pour en prendre la mesure, il faut donner sa place au projet des Institutions politiques, ce grand ouvrage qui ne vit jamais le jour et dont devait subsister le Contrat social. 1. Sur la Profession de foi, voir notre introduction à ce texte (GF, 1996). Le chapitre VIII est en fait le pénultième : y succède, en forme d’envoi, un bref adieu aux Institutions politiques. 2. Respectivement rédigés en 1765 et 1771 (publiés en 1861 et 1782). Sur la politique appliquée de Rousseau, voir l’Introduction et les notes de B. de Negroni, GF, 1990. 3. Rousseau l’avait prévu : le Contrat social «sera infailliblement étouffé» par la publication de l’Émile (lettre à Rey du 4 avril 1762). INTRODUCTION 9 On connaît l’importance de l’enfance genevoise pour la formation morale et religieuse de Rousseau. On sait combien ses lectures de Plutarque, des historiens romains, de l’histoire de l’Église ont formé son cadre de pensée. On connaît moins l’influence de cette période pour sa formation politique 1. Rousseau eut très tôt conscience non seulement de son statut de citoyen, de la singularité uploads/s1/ du-contrat-social.pdf
Documents similaires







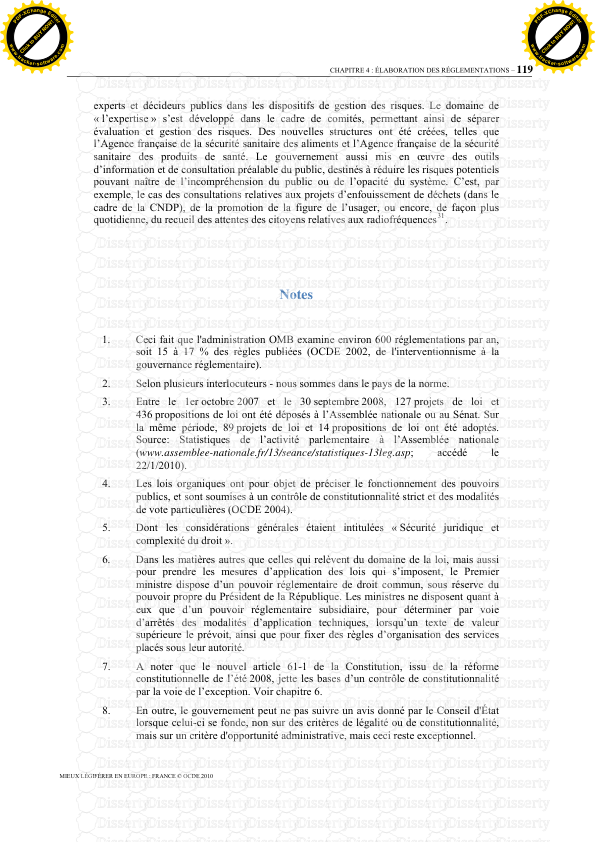


-
58
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 09, 2022
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 2.2135MB


