Faire vibrer les communautés à l’art contemporain Pistes pour une médiation viv
Faire vibrer les communautés à l’art contemporain Pistes pour une médiation vivante et engageante Ce guide pratique est le fruit d’échanges, de discussions et de recherches de personnes passionnées par la médiation. Toutes ont contribué à sa création afin d’en faire un outil riche et convivial pour une plus grande accessibilité à l’art contemporain. Conception, recherche et rédaction Marilyn Farley Marie-Laure Robitaille Collaboratrices Sophie Bédard (Illustration) Sophie Ouch (Graphisme) Intervenant.e.s lors des projets Faire vibrer les communautés à l’art contemporain et Raconter nos histoires en art contemporain Adriana de Oliveira Christelle Renoux Marie-Laure Robitaille Nicolas Rivard Coordination Lise Leblanc (AGAVF) Révision linguistique Camille Desrochers L’AGAVF remercie le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de l’Ontario et le ministère du Patrimoine canadien de leur appui financier. Faire vibrer les communautés à l’art contemporain Pistes pour une médiation vivante et engageante Table des matières Introduction VI Partie 1 : Mise en contexte de la médiation 8 Origine et pratiques de la médiation 9 Gros plan sur la médiation culturelle 10 Objectifs et effets de la médiation culturelle 12 La place de la médiation en art contemporain 14 Partie 2 : Les clés d’une intervention adaptée en médiation en art contemporain 18 Pour une visite interactive adaptée à votre public cible 19 1< Réfléchir à son public 2< Réapprendre à regarder 3< Préparer son contenu 4< Rejoindre et fidéliser son public Annexes 35 A< Caractéristiques des publics 36 B< Ressources 46 C< Lexique 48 D< Bibliographie 51 INTRODUCTION VII L’art contemporain peut parfois sembler intimidant. Il est souvent jugé complexe, hermétique et réservé à une certaine élite intellectuelle par le grand public. Toutefois, certaines clés d‘interprétation sont utiles pour aider les publics à décoder, comprendre et apprécier les œuvres. Sensible à cette question, l’AGAVF a depuis 2009 entrepris plusieurs initiatives. Elle a d’abord commandé à Marie-France Beaudoin un guide intitulé Comment parler d’art contemporain en milieu scolaire (2011) dans lequel sont proposés une dizaine de clés pour appréhender l’art contemporain. Elle a ensuite réalisé deux initiatives visant à outiller ses membres en médiation de l’art contemporain : Faire vibrer les communautés à l’art contemporain et Raconter nos histoires en art contemporain 1. Celles-ci ont mené à une vingtaine d’interventions, alliant activités de professionnalisation et création de projets de médiation en art, dans treize villes à travers le pays entre 2016 et 2020. L’AGAVF a donc voulu réunir certains contenus, outils et ressources utilisés lors des interventions à titre de rappel pour les participant.e.s aux interventions, mais surtout pour en faire bénéficier le plus grand nombre d’intervenant.e.s possible. Le document s’adresse aux diffuseurs spécialisés, aux artistes, aux médiateur.-trice.s et aux travailleur.-euse.s désirant approfondir leurs connaissances en médiation de l’art contemporain. Après un rappel des concepts de la médiation culturelle, et plus particulièrement de la médiation en art contemporain, ce document fournit les pistes d’une intervention centrée sur la visite interactive. 1 Initiatives financées par le Fonds d’action culturelle communautaire (FACC) du ministère du Patrimoine canadien. PARTIE 1 MISE EN CONTEXTE DE LA MÉDIATION 9 Le mot médiation vient du latin mediatio qui signifie « entremise ». Le terme médiateur remonte au XIIIe siècle et désigne le processus de conciliation qui se joue par l’entremise d’un intermédiaire : le ou la médiateur.-trice. Dans l’écosystème culturel et artistique, les pratiques de la médiation sont multiples et revêtent différentes formes. Elles empruntent des connaissances dans les domaines culturel, social, politique et éducationnel. Chaque pratique a son approche et son champ d’action. À titre d’exemple, nous pouvons citer la médiation sociale qui se concentre sur la relation entre des groupes sociaux, la médiation intellectuelle qui se préoccupe des rapports avec les savoirs et les pratiques intellectuelles et, finalement, la médiation culturelle qui mise sur la relation entre les citoyen.ne.s et des objets culturels (œuvres d’art, œuvres littéraires, patrimoine bâti, etc.) ou des pratiques artistiques (arts visuels, arts vivants, musique, etc.). Les frontières entre les différentes formes de médiation sont poreuses et un même projet peut emprunter des caractéristiques issues de ces différents domaines. Origine et pratiques de la médiation 10 La médiation culturelle désigne des stratégies d’action culturelle centrées sur les situations d’échange et de rencontre entre les citoyens et les milieux culturels et artistiques. Elle se caractérise par la mise en place de moyens d’accompagnement, de création et d’intervention destinés aux populations locales et aux publics du milieu artistique et culturel. La médiation culturelle a pour principe d’action l’élargissement et l’approfondissement de l’accès de la population aux moyens de création individuelle et collective (démocratie culturelle), ainsi qu’à l’offre culturelle professionnelle (démocratisation culturelle) 2. » 2 Montréal médiation culturelle. Qu’est-ce que la médiation culturelle, 2020 (7 juin 2020). http://montreal.mediationculturelle.org/quest-ce-que- la‑mediation-culturelle/ Gros plan sur la médiation culturelle « 11 Cette définition, proposée par la Ville de Montréal, fait partie d’un large éventail de définitions proposées par les villes, les institutions et les organismes culturels. Bien que variant de l’une à l’autre, la plupart des définitions s’accordent sur l’importance de la création d’un lieu d’échange favorisant la rencontre entre l’objet culturel et les publics. Autres exemples de définitions de la médiation culturelle Définition proposée par Culture pour tous 3 La médiation culturelle désigne le processus de mise en relation entre les sphères de la culture et du social, la construction de nouveaux liens entre politique, culture et espace public. Elle chapeaute un vaste ensemble de pratiques allant des actions de développement des publics à l’art participatif et communautaire. Ultimement, elle vise à faire de chaque personne, visiteur ou spectateur, un véritable acteur culturel. Définition proposée par Jean Caune dans La Médiation culturelle : Expérience esthétique et construction du Vivre-ensemble 4 La médiation culturelle (…) n’est pas la transmission d’un contenu préexistant : elle est production du sens en fonction de la matérialité du support, de l’espace et des circonstances de réception. 3 Culture pour tous. Présentation – La médiation culturelle, 2020 (29 août 2020). https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/mediation-culturelle/ 4 CAUNE, Jean. La Médiation culturelle. Expérience esthétique et construction du Vivre-ensemble, Grenoble : Presse universitaire de Grenoble, coll. Communication médias et sociétés, 2017, page 45. 12 La médiation culturelle poursuit plusieurs objectifs. En voici quelques exemples : • Faciliter l’accès aux arts et à la culture au plus grand nombre ; • Encourager et valoriser la participation et l’apport des citoyen.ne.s à la vie culturelle ; • Faciliter l’expression et l’autonomie des citoyen.ne.s face à une pratique ou une discipline artistique ; • Mettre en place des espaces de dialogue, d’échange et/ou de création. Les initiatives de médiation culturelle sont des occasions uniques de rencontres entre la culture, les artistes ou leurs œuvres, et les participant.e.s. Elles permettent l’échange et le partage d’expériences, d’idées et de connaissances. Ces moments privilégiés favorisent le rayonnement et l’inclusion de l’art dans la vie de tous les jours. De plus, la médiation culturelle peut avoir des effets directs et indirects sur les participant.e.s. Des effets positifs, variant selon le contexte, sont identifiables, notamment sur le développement personnel, l’autonomie, la cohésion sociale, le sentiment d’appartenance, l’identité, la santé et le bien-être 5. 5 JACOB, Louis, Anouk BÉLANGER, Julie SIMARD, Nathalie CASEMAJOR, Anouk SUGÀR, Emmanuelle SIROIS et Romain GUEDJ. (2014). Les effets de la médiation culturelle : participation, expression, changement, Montréal, UQAM, 2014. Études partenariales réalisées à Montréal de 2011 à 2013. Objectifs et effets de la médiation culturelle 13 Pour aller plus loin QUINTAS, Eva. La médiation culturelle en questions, Montréal : Culture pour tous, 2014. FOURCADE, Marie-Blanche. La médiation culturelle et ses mots‑clés, Montréal : Culture pour tous, 2014. JACOB, Louis, Anouk BÉLANGER, Julie SIMARD, Nathalie CASEMAJOR, Anouk SUGÀR, Emmanuelle SIROIS et Romain GUEDJ. Les effets de la médiation culturelle : participation, expression, changement, Montréal, UQAM, 2014. Récupéré de montreal.mediation.org [http://etude.montreal.mediationculturelle.org/wp-content/uploads/2014/05/ RapportFinal_EffetMediationCulturelle_VdMtl_LowRes.pdf.] CÔTÉ, Karine, Gabrielle DESBIENS, Ariane FORTIN, Nancy SAVARD et Véronique VILLENEUVE. La médiation culturelle, moteur de développement dans une perspective de développement durable, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2016. Récupéré de mcc.gouv.qc.ca [https ://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/ Politique-culturelle/Memoires___Metadonnees/Cellule_regionale_d_Innovation_ Memoire.pdf] CAMELO, Costanza, DUBÉ, Marcelle DUBÉ et Danielle MALTAIS. Portrait des pratiques de médiation culturelle au Saguenay-Lac- St‑Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2016. Études partenariales réalisées au Saguenay-Lac-Saint-Jean. LEGAULT, Caroline. « La médiation culturelle : stratégies favorisant la fréquentation des institutions culturelles », Bulletin de l’Observatoire québécois du loisir, vol. 9,n° 11 (2012) pages 1-4. Charte du médiateur culturel de musée 14 [La médiation de l’art contemporain] relève d’un travail de liaison ou de passeur entre deux parties, une méditation [...] par laquelle est réalisé un travail d’interprétation, de transmission d’une connaissance et d’une esthétique attribuée à une œuvre 6. » C’est au XXe siècle que des stratégies pour accompagner les publics lors de visites d’exposition, tels les livrets, voient le jour. Au tournant des années 1920, apparaissent les premiers guides bénévoles dans des institutions culturelles en France et aux États-Unis. En 1959, André Malraux (ministre de la Culture du gouvernement français de 1959 à 1969) déclare souhaiter l’accessibilité de la culture à tous les citoyen.ne.s peu importe leur milieu socio-économique. Ses travaux seront source d’inspiration pour les politiques culturelles québécoises. En France, la notion de médiation culturelle apparaît dans les années 1980, uploads/s1/ faire-vibrer-communautes-final.pdf
Documents similaires





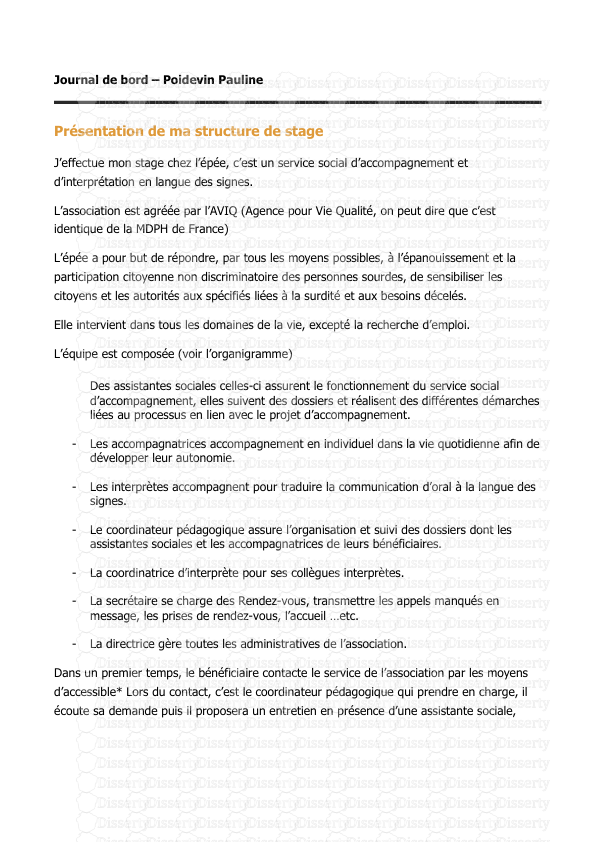




-
26
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 07, 2021
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 1.6230MB


