HILAIRE ET LIBÈRE Ces quelques pages n'ont point la prétention d'ouvrir à nouve
HILAIRE ET LIBÈRE Ces quelques pages n'ont point la prétention d'ouvrir à nouveau le procès du pape Libère. Elles se proposent uniquement d'exami- ner un des éléments qui le concernent ; le témoignage rendu à son sujet par Hilaire dans ses Fragmenta Historica x. Encore r*'entendent-elles l'aborder que sous un angle très précis : l'angle littéraire. Parmi tous les témoignages qui portent sur l'exil, la chute et le retour de Libère : Athanase, Hilaire, Jérôme, le Libellas precum, et à leur suite les historiens de cette période : Sabinos, Philostorge, Sozomène, celui de saint Hilaire de Poitiers est sans contredit le plus accablant pour le pape. C'est dans ses Frag- ments historiques, en effet, et là seulement, que se lisent les quatre lettres écrites par Libère dans son exil. Or le personnage qui s'en dégage, se montre profondément différent de ce qu'il avait été précédemment, et dont témoignaient d'autres documents également sûrs : on y voit un pape abandonnant lâchement Athanase, rétractant toutes ses positions doctrinales antérieures, suppliant sans dignité aucune les évêques de cour d'intercéder en sa faveur auprès de l'empereur pour obtenir son retour à Rome. Ce contraste même, certaines anomalies du dossier, joints aux précisions nouvelles obtenues sur l'œuvre littéraire de saint Hilaire, ont soulevé jadis d'âpres discussions et provoqué, surtout lors de l'édition critique des Fragm. Hist, une abondante littéra- ture. Les thèses se sont affrontées vainement. De part et d'autre i. Publiés par D. COUSTANT en 1693 s ° u s 1© t'-tre de Fragmenta ex opere kistorico. Texte dans Migne, PL 10, 627-724. Édition critique par A. FEDER SOUS le titre de Coîlectanea antiariana pari sina en 1916 dans» CSEL, t. LXV f S. Hilarîi Picta- viensis Opera, p. 41-193. 8 P. GLORIEUX d'ailleurs, que l'on crût ou non à la défaillance plus ou moins grave du pape, de réelles difficultés subsistaient. Il ne paraît pas impossible pourtant, maintenant que l'effer- vescence est tombée et les préoccupations polémiques apaisées, de reprendre le problème avec quelque chance de succès. A la condition toutefois d'adopter une méthode nettement différente. On partait jadis d'une thèse historique plus ou moins laborieu- sement échafaudée : à sa lumière on interprétait l'ouvrage d'Hi- laire et on se prononçait pour ou contre l'authenticité du dossier Libère. N'est-ce pas le contraire qu'il eût fallu faire ? se mettre nettement en face du problème littéraire qui se pose, l'étudier pour lui-même et s'efforcer de le résoudre en toute indépendance ? C'est dans l'ouvrage d'Hilaire, dans un examen objectif de son plan et de son but, que doit pouvoir se trouver la réponse satis- faisante à l'énigme qu'il pose. Telle est du moips la méthode que nous nous proposons de suivre ici. Notons tout d'abord qu'on fausserait dangereusement les pers- pectives en faisant de la question du pape Libère le tout ou même le sommet de l'ouvrage d'Hilaire. Celui-ci est d'une autre ampleur chronologique, embrassant comme il le fait des événements rela- tifs aux polémiques ariennes ou semi-ariennes qui s'échelonnent entre 343 et 360 (ou même 367). Par ailleurs les écrits libériens né constituent, matériellement, qu'une partie relativement minime du dossier complet rassemblé par saint Hilaire. En effet, sur les 47 pièces groupées en 15 fragments que comportent les Fragm, Hist. dans leur état actuel, le dossier de Libère n'occupe que les fragments IV-VI. Quelles pouvaient être les dimensions de l'ouvrage primitif ? Nous ne savons ; puisqu'il ne nous en reste que des fragments épars, des disjecta membra. Car tel est, oïi le sait, l'état dans lequel nous a été transmis l'écrit d'Hilaire : des feuillets arrachés, élé- ments d'une argumentation d'avocat ou d'historien où se trou- vaient, enchâssés dans un commentaire qui les expliquait et les faisait valoir, une série de documents patiemment recueillis et savamment agencés. C'est d'ailleurs pourquoi, à défaut d'un terme meilleur, on désigne généralement cet ouvrage d'Hilaire sous le titre, que nous retiendrons ici, de Fragments Historiques. Ces fragments sont de dimension et d'importance variables ; par- fois ils ne contiennent qu'une pièce unique ; parfois ils en grou- [3] HILAIRE ET LIBÈRE 9 pent plusieurs avec les notes éditoriales qui les introduisent ou les relient entre elles. Leur succession, dans les manuscrits qui les ont transmis, n'est ni chronologique ni logique. Il semble qu'à l'origine de la tradition manuscrite on ait recueilli, ne pereant, ces éléments d'un grand ouvrage et qu'on les ait copiés sans aucune préoccupation de plan. Aussi les éditeurs, à l'exception du der- nier, n'ont-iïs pas hésité à s'écarter des manuscrits et à ranger ces documents suivant un ordre qui leur parût plus satisfaisant. La division en quinze fragments et la numérotation, arbitraire d'ail- leurs, de ceux-ci, est l'œuvre de D. Coustant. Elle a été reprise par la suite, et c'est d'après elle que l'on continue à citer. Tous ces fragments donc, par leur présentation même, sou- lèvent un problème littéraire analogue à celui des Pensées de Pascal. A cette différence toutefois que ces dernières n'ont pas été mises en œuvre par leur auteur et n'ont jamais réalisé l'ou- vrage qu'il méditait ; tandis que celui d'Hilaire a existé, mais s'est vu détruire, et ses éléments éparpiller. C'est pourtant sur le plan de l'ouvrage et sa reconstitution qu'ont porté les progrès réalisés au cours des années 1905-1910. Ils furent dus en partie aux judicieuses remarques de D. Wilmart sur Y Ad Constantium lib. I et son rapprochement avec les Frag- ments auxquels il appartient effectivement, encore qu'il se soit transmis en marge \ Il est nécessaire de résumer brièvement les conclusions auxquelles la critique est parvenue avant d'aborder la question des épîtres libériennes. 1. Ce sont en effet les remarques faites par D. Wilmart, suggérées déjà par B . Marx sur ce prétendu traité de saint Hilaire et ses rapports réels avec les Frag menta Historica qui ont donné un nouvel essor à ces recherches et les ont orientées définitivement dans leur vrai sens. Parmi les principales études consacrées au problème des Fragm. Hist. il faut mentionner M. SCHIKTANZ, Die Hilarius Frag mente, Breslau 1005 ; B. M A R X , Zwei Zeugen fur die Herkunft der Fragmente x und 2 des sog. Opus historicum S. Hilarii dans Theologische Quavtahchrift 1906, P- 390-416 ; A. WILMART, VAd Constantium liber primus de S. Hiiaite de Poitiers et les Fragments Historiques, dans Revue Bénédictine, 1908, p. 149-179. 293-317 ; Les Fragments Historiques et le synode de Péziers en 356 dans Revue Bénédictine, 1908, p. 225-229 ; A. FEDER, Studien zu Hilarius von Poitiers. I. Die sogenannte Fragmenta Historica und der sog. liber I ad Constantium imperatoremt dan» Sitzungs- berichte der K. Akad. der Wissenschaften in Wien, Phih-hist. Klasse 1910, t. C L X V , Vo r auss. t. C L X V I , fasc. 5 (1911). Bon exposé de l'état de la question dans X . L E BACHELET, art. Hilaire dans Dict. tkéol. cath. A consulter surtout la préface de l'édition critique de A. F E D E R , p. XX-LXIX. 10 P. GLORIEUX [4] La première de ces conclusions est que nos Fragm. Hist. con- tiennent deux traités polémiques de saint Hilaire, composés et édités à quatre années d'interValle (356 et 360), réédités proba- blement ensemble avec quelques additions vers 363 (peut-être même vers 367). Ces traités qui encadrent donc l'exil de l'évêque de Poitiers ont pour centre, l'un, le concile de Béziers de 356, l'autre, celui de Rimini, de 359. Au mois de janvier 356, £ l'instigation des évêques de cour Ursace et Valens, de Saturnin d'Arles rallié à eux depuis deux ans, un concile s'était tenu en Gaule dans l'intention bien arrêtée d'obtenir de tous les .évêques encore-réfractaires une adhésion complète à la politique impériale, la condamnation d'Athanase, l'abandon des autres évêques déjà frappés par l'empereur et exilés : Paulin de Trêves, Eusèbe de Verceil, Denys de Milan. Convié à ce synode, Hilaire s'y présenta en défenseur delà vérité, décidé à dénoncer devant ses collègues assemblés la fourberie des Ariens. Ceux-ci s'interposèrent violemment, interrompant à cha- que instant sa harangue, la couvrant de leurs clameurs. Hilaire réussit maJgré tout à entraîner dans son attitude son collègue de Toulouse, Rhodanius, mais s'exposa par le fait même aux représailles impériales. Le rapport adressé à Constance par Satuf- xûn au nom même du concile, provoqua la sentence de bannis- sement qui l'atteignit. Ce fut d'ans les jours où son sort se décidait ainsi qu'il reprit en un « volume » régulièrement composé, complet, le discours, sermo, qu'il avait essayé de prononcer à Béziers x. Et c'est ce premier ouvrage que nous ont conservé les fragments I, III, II et VAd Constantium liber primus 2. 1. Quamquam enim ex aliquibus quae Biterris gesta sunt, cognosci potuerit longe aliud agi quam existimabatur, tamen propensiore cura rem omnem hoc vcJumine placuit exponere ; raptim enim tune haec per nos ingerebantur, corruptio evangeliorum, depravatio fidei et simulata Christi nominis blasphéma confessio ; et necesse fuit in eo sermotie omnîa esse praepropera, incomposita, confusa, quia quanto nos impensîore cura audientiam quaereremus, tanto illi pertinaciore studio audientiae uploads/s1/ hilaire-et-libere.pdf
Documents similaires





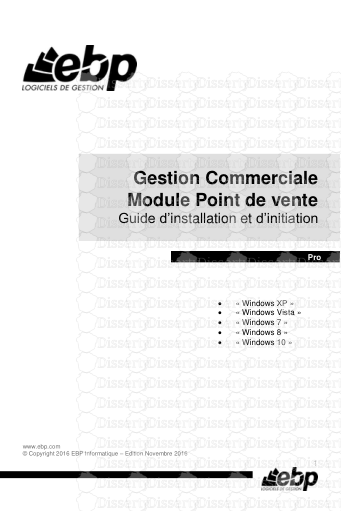




-
196
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 17, 2022
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 0.8165MB


