S O M M A I R E 1 SARAH KOFMAN Sarah Kofman • DESSIN 2 Alexandre Kyritsos et Ph
S O M M A I R E 1 SARAH KOFMAN Sarah Kofman • DESSIN 2 Alexandre Kyritsos et Philippe Boutibonnes • REPÈRES 5 Sarah Kofman • LA MORT BLANCHE 7 Philippe Lacoue-Labarthe • LA NAISSANCE EST LA MORT 8 Françoise Armengaud • LE RIRE DE SARAH 12 Jean-Luc Nancy • COURS, SARAH ! 19 Sarah Kofman • LA MORT CONJURÉE 27 Philippe Boutibonnes • UNE LEÇON, UNE LECTURE 31 2 SERGE LUNAL Christian Prigent • QUESTION D’ESPACE 38 Jean-Claude Hauc • L’OBSCUR OBJET DE LA PEINTURE 39 Serge Lunal • 12 PEINTURES EN COULEURS 49 Daniel Dezeuze • CIBLES CHROMATIQUES, FLÈCHES MUSICALES 61 Serge Lunal/Claude Viallat • PROPOS 63 François Lagarde • SERGE LUNAL 68 3 ROBERT PINGET Clothilde Roullier • PINGET PASSE-PASSE 70 Robert Pinget • LETTRE À MORTIN 71 • HORS-TEXTE 72 Fabienne Caray • ÉCHANGE DUBUFFET-PINGET 74 Christine Montalbetti • LE LAPIN NEURASTHÉNIQUE 89 Michel Butor • SIGNET 91 Danièle Momont • PUIS DE NOUVEAU GRIFFONNANT AU COIN DU FEU 93 Bibliographie indicative 94 4 ONCLES D’AMÉRIQUE Frank O’Hara • EN SOUVENIR DE MES SENSATIONS 96 Raymond Federman • POÈMES ÉCRITS À LA MAIN 102 5 TRAVAUX EN COURS Jérôme Bertin • LES BATAILLES 108 Jean Renaud • MADAME, IL FAUT PARTIR 111 Éric Clémens • POUR UN ART AU MONDE 114 2 Sarah Kofman, dessin au crayon de couleur orange vif sur bristol, 20 x 12,5 cm. 1 SARAH KOFMAN Textes de Sarah Kofman, Alexandre Kyritsos, Philippe Lacoue-Labarthe, Françoise Armengaud, Jean-Luc Nancy, Philippe Boutibonnes L'importance du dossier consacré à Sarah Kofman nous contraint à reporter au prochain numéro de Fusées (n°17, Avril 2010) la partie consacrée aux dessins et aux textes afférents. Philosophe, Sarah Kofman (1934–1994) est l’auteur d’une trentaine de livres dédiés, entre autres, à la pensée de Nietzsche et de Freud – mais aussi de Platon – ainsi qu’à la question de la femme et du féminin. Mais Sarah Kofman dessinait aussi, assidûment. De cette activité compulsion- nelle nous restent plusieurs centaines de visages – le sien et ceux d’autrui –, la plu- part coupés de leur corps. Attentive au thème de la représentation – l’attestent au moins deux de ses livres, Mélancolie de l’art et L’imposture de la beauté –, Sarah Kofman interroge les textes et les peintures pour tenter de comprendre la fonction « pharmaceutique » de l’art : Comment peut-il nous protéger de l’illusion, de la mélancolie et de la fascination morbide ? En quoi rend-il tolérable l’intolérable ? Ce sera le propos de La mort conjurée. Le dossier que nous consacrons à Sarah Kofman rassemble la première version de l’ultime texte qu’elle écrivit, des témoignages de ses amis (Françoise Armengaud, Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy), un ensemble de ses dessins ainsi que leur lecture attentionnée dont s’est acquitté Jean-Luc Nancy : Que disent-ils, en effet, ces portraits à la bouche démesurément ouverte ? Ce dossier n’aurait pu voir le jour sans l’aide amicale et les encouragements d’Alexandre Kyritsos. Il nous a permis d’avoir accès et de disposer d’une somme de dessins et de documents dont certains sont ici reproduits. Qu’il en soit très vivement remercié. Nous remercions Albert Dichy, Directeur littéraire de l’IMEC (Institut Mémoires de l’édition contem- poraine) de nous avoir autorisé à publier le texte de Sarah Kofman ainsi que la page manuscrite. 4 REPÈRES Alexandre Kyritsos et Philippe Boutibonnes Pour Sarah Kofman - née en 1934 à Paris de parents polonais émigrés en 1929 - la seconde guerre mondiale fut, à plus d’un titre, une épreuve cruciale : l’épreuve du malheur extrême. Son père, Bereck Kofman, rabbin, fut arrêté (« ramassé » écrit- elle) par la police française en juillet 1942, l’année du port obligatoire de l’étoile jaune et des rafles massives. Déporté à Auschwitz, il y fut assassiné « enterré vivant à coups de pioche pour avoir refusé de travailler ce jour-là » (Shabbat) : « Parce qu’il était juif, mon père est mort à Auschwitz : comment ne pas le dire ? Et comment le dire ? Comment parler de ce devant quoi cesse toute possibilité de parler ? » Durant les trois années qui suivirent la déportation et la mort de son père, Sarah et ses cinq frères et sœurs vécurent cachés sous un nom d’emprunt, séparés et dis- persés en Province. Sarah devenue Suzanne fut recueillie par la « dame de la rue Labat » qu’elle nomma Mémé. Elle décrit cet épisode et la rupture affective qui s’en- suivit dans son dernier livre. Enfance déchirée : l’expérience de la mort au-delà de la mort (« mort pire que la mort » écrit-elle), l’éloignement de la fratrie et l’arra- chement puis le partage impossible de l’amour pour une mère et son double, vécus comme la toute puissance d’un exil intérieur (« ce fut atroce » note-t-elle) imprè- gnent l’ensemble de la réflexion de Sarah Kofman. La guerre finie, ce fut, pour une courte période, le retour à l’école primaire de la rue Doudeauville où Sarah retrouve ses anciennes camarades, puis Nonancourt, le préventorium d’Hendaye et enfin, durant cinq ans, le séjour au Moulin, à Moissac, institution pour enfants de déportés. A sa demande Sarah est inscrite au collège et entreprend des études secondaires classiques. Elle apprend l’hébreu. L’une des salles de la bibliothèque de cette ville porte maintenant son nom. Elle revient alors à Paris vivre chez sa mère. Elle prépare le baccalauréat au lycée Jules Ferry avant d’obtenir à la Sorbonne l’équivalent de la maîtrise actuelle avec un mémoire sur Platon et le langage. Après l’obtention de l’agrégation, elle aborde sa carrière d’enseignante au lycée Saint-Sernin à Toulouse (1960) puis est nommée, en hypokhâgne, au lycée Claude Monet à Paris. De cette époque date son premier article : Le problème moral dans la philosophie de l’absurde (1963). Sous la direction de Jean Hippolyte, elle com- 5 mence des recherches pour une thèse de doctorat sur le concept de culture chez Nietzsche et Freud, thèse qui sera conduite, après la mort de Jean Hippolyte, par Gilles Deleuze. Dès la fin des années 60 elle suit, à l’E.N.S. le séminaire de Jacques Derrida – auquel la lie une profonde amitié et auquel elle consacrera un livre (Lectures de Derrida, Galilée Ed., 1973) – séminaire où elle rencontre Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy. De l’estime partagée entre les quatre philosophes naîtra la col- lection La Philosophie en effet et dont le premier livre publié sera Camera obscura. De l’idéologie, (1973). Sarah Kofman devient Maître-assistante à la Sorbonne en 1970 et le restera quelques vingt ans. Elle participe alors activement aux travaux du GREPH (Groupe de recherches sur l’enseignement de la philosophie). Malgré la parution d’une vingtaine d’ouvrages et l’obtention, sur travaux, de son Doctorat en 1976, sa candidature à un poste de Professeur provoque de vives polémiques au sein de la section de Philosophie du Comité National de l’Université. Nommée Professeur en 1991, elle poursuivra son enseignement universitaire jusqu’à sa mort. Cette même année paraît un court récit : Rue Ordener, rue Labat (Galilée Ed., 19941), un « aveu » dont « les livres précédents n’ont été que des voies de traverses pour parvenir à l’écrire » – avouait-elle. Durant la guerre, les deux rues nommées dans le titre bor- naient son horizon. Elles « dessinent un dédale d’où ne surgit plus aucune issue, alors c’en est fini et de la philosophie et de la vie. » (F. Proust, 1997). Sarah Kofman met fin à ses jours le 15 octobre 1994. 1. En 1995, dans un film vidéo d’une trentaine de minutes, la réalisatrice israélienne, Shiri Tsur, a pro- posé une lecture scrupuleuse et pathétique de ce livre. 6 LA MORT BLANCHE Sarah Kofman Sentier de campagne – montagnes alentour. Me sera-t-il donné de revoir, jouissance absolue, ce paysage – le mien – qui hante et comble mes rêves ? Il me faut d’abord emprunter un immense escalier en zigzag, avant de le contem- pler, stupéfaite devant tant de splendeur, fascinée par une énorme vague gonflée d’écume blanche, roulant au ralenti vers le rivage. Soudain, alors qu’elle allait se briser sur le sable, elle se métamorphose en un ange vêtu de blanc armé d’une faux qui me griffe, me prend par derrière et me terrasse à mort. Eveillée par l’angoisse, pas tout à fait sûre d’avoir seulement rêvé, je murmure : « lait de ma mort… ». Si j’avais à donner un titre à ce rêve, ce pourrait être : « la mort blanche ». Cette brève transcription d’un rêve, non datée, a été retrouvée récemment dans les archives de Sarah Kofman par Alexandre Kyritsos, qui l’a confiée à la revue. 7 LA NAISSANCE EST LA MORT Philippe Lacoue-Labarthe A la mémoire de Sarah « Vivre est une mort, et la mort elle aussi une vie. Hölderlin, En bleu adorable Il y a des scènes primitives : c’est connu, ou reconnu, depuis Freud. Au moins. Celles-ci sont matricielles : remémorées, réélaborées ou reconstituées, voire tout simplement inventées, par l’effet d’une sorte de rétroprojection – élaborées, donc, elles informent ou commandent un destin, singulier ou collectif. uploads/s3/ 16-fusees.pdf
Documents similaires




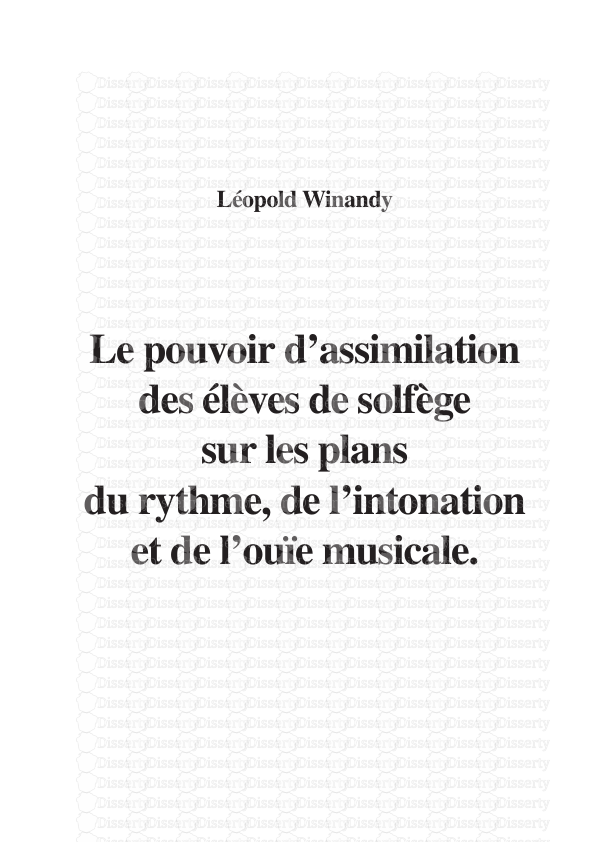





-
46
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 25, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.3080MB


