Paul Noyen Aristote et la réforme monétaire de Solon In: L'antiquité classique,
Paul Noyen Aristote et la réforme monétaire de Solon In: L'antiquité classique, Tome 26, fasc. 1, 1957. pp. 136-141. Résumé Le chapitre X de la « Constitution d'Athènes » d'Aristote, traitant de la réforme monétaire de Solon, devient parfaitement intelligible à la lumière de quelques données numismatiques. Premièrement, la mine euboïco-attique, divisée en 100 drachmes, équivalait à 73,5 drachmes de la mine éginétique, qui comptait seulement 70 drachmes. Deuxièmement, la talent euboïco-attique correspondait à 63 mines éginétiques. Citer ce document / Cite this document : Noyen Paul. Aristote et la réforme monétaire de Solon. In: L'antiquité classique, Tome 26, fasc. 1, 1957. pp. 136-141. doi : 10.3406/antiq.1957.3313 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/antiq_0770-2817_1957_num_26_1_3313 MÉLANGES - VARIA ARISTOTE ET LA RÉFORME MONETAIRE DE SOLON par P. Noyen Le chapitre X de la « Constitution d'Athènes », traitant de la monétaire de Solon, reste encore toujours un des passages les plus obscurs et, partant, les plus discutés de l'ouvrage consacré par le philosophe de Stagire à l'histoire constitutionnelle d'Athènes. En effet, pour les uns Q), l'aspect technique propre aux procédés d'interchangibilité de numéraires d'étalon différent, résultant de l'innovation du sage d'Athènes, innovation que nous voudrions de capitale eu égard à l'expansion économique subséquente, aurait complètement échappé aux investigations d'Aristote, qui se serait par conséquent débarrassé par un exposé vague d'un problème dont seuls les traits généraux lui étaient acquis (2). D'autres, éditeurs et commentateurs (3), proposent de changer le texte et estiment même que c'est là le seul moyen de rendre intelligible le chapitre en question. D'autres encore — et ils sont les plus nombreux — évitent de toucher au fond même d'un problème considéré comme insoluble (4). De la diversité de ces avis, dont nous n'avons retenu que les plus représentatifs et les plus autorisés, se dégage indiscutablement que le chapitre X de la « Constitution d'Athènes », tel qu'il (1) F. E. Adcock, Cambridge Ancient History, vol. IV, p. 134. G. Busolt, Griechische Geschichte, 2, IL p. 263, η. 1. (2) II est à remarquer que ce jugement n'implique pas une dépréciation de la valeur d'Aristote comme historien. En effet, on sait qu'au moment où Aris- tote rédigeait son Athenaion Politeia (fin du ive siècle), il ne pouvait plus les κνρβεις contenant les lois de Solon. Et même, s'il avait pu le faire, il faut croire qu'il en serait résulté peu de profit pour son œuvre. Un siècle plus tôt, une commission spécialement désignée pour étudier la patria con- stitutio de Solon d'après les textes des κνρβεις, n'était pas parvenue à honorablement de sa tâche. Il faut en conclure que les κνρβεις ne donnaient qu'une idée fragmentaire de la nouvelle constitution de Solon. (3) F. G. Kenyon, qui en 1891 donna la première édition de ΓΑ.Ρ. Cf. J. E. Sandys, Aristotle's Constitution of Athens, London 1912, p. 40. (4) Ch. Seltman, Greek Coins, London 1933, p. 44 et sv. ; G. Mathieu et Β. Haussoullier, Aristote, Constitution d'Athènes, Paris 1952, coll. G. Budé, p. 10. ARISTOTE ET LA RÉFORME MONÉTAIRE DE SOLON 137 nous a été transmis et tel qu'il a été expliqué jusqu'ici, pose un irritant auquel l'historien n'est pas parvenu à donner une solution plausible. C'est pour cette raison que nous allons l'aborder ici avec l'aide de la numismatique. En effet, il nous semble que l'on peut interpréter le passage discuté de telle façon qu'il constitue un ensemble bien ordonné et logiquement conçu dont les moindres techniques trouvent leur justification mathématique. Exposer cette interprétation et tâcher de convaincre le lecteur de son bien- fondé, sera le sujet de la présente étude. Voici d'abord le texte et la traduction du chapitre X de ΓΑ. P. (x) : Έν μέν οϋν τοις νόμοις ταντα δοκεΐ θεΐναι δημοτικά, προ δέ της νομοθεσίας ποιήσαι την των χρεών άποκοπήν και μετά ταντα την τε των μέτρων και σταθμών και την τον νομίσματος ανξησιν. 2 Έπ' εκείνον γαρ έγένετο και τα μέτρα μείζω τών Φειδωνείων, και ή μνα, πρότερον εχονσα σταθμόν έβδομήκοντα δραχμας, άνεπληρώθη ταις εκατόν. *Ην δ' δ αρχαίος χαρακτήρ δίδραχμον. Έποίησε δέ και σταθμά προς το νόμισμα τρεις και έξήκοντα μνας το τάλαντον άγουσας, καΐ επιδιενεμήθησαν αϊ τρεις μναΐ τω στατηρι και τοις άλλοις σταθμοΐς. « Voilà donc, semble-t-il, quelles sont les mesures dans les lois de Solon. L'abolition des dettes avait la législation ; l'augmentation des mesures, poids et la suivit. Car c'est sous Solon que les mesures furent rendues plus grandes que celles de Phidon et que la mine, qui comptait auparavant soixante-dix drachmes, fut portée à cent. L'ancien type de monnaie était la pièce de deux drachmes. Solon établit aussi des poids en rapport avec la monnaie, mines pesant un talent : les trois mines furent entre les statères et les autres unités divisionnaires ». Nous croyons que dans ses grandes lignes, l'ordre des idées et secondaires, exprimées dans le chapitre X de Γ A. P., se laisse préciser comme suit. Tout d'abord, Aristote tient à nous qu'après sa législation, Solon a introduit en Attique une réforme des mesures, des poids et de la monnaie (2), cette réforme en l'occurrence, une plus-value au système métrologique existant. (1) G. Matthieu et B. Haussoullier, o. c. (2) D'une façon générale, toute réforme monétaire entraîne automatiquement un changement dans le système des poids et des mesures, vu la relation naturelle et très étroite existant entre la monnaie, le poids et la mesure antiques. Le mot δραχμή signifiait à l'origine une poignée de métal ou d'une autre quelconque, le mot στατήρ rappelle l'arrêt (ϊστημι) de la balance. latine pour payer est penderé (peser). Les termes uncia, mine, talent, shekel, désignant des monnaies ou des valeurs monétaires, étaient également employés comme dénominations pondérales. 138 P. NOYEN Cet énoncé général au sujet de la réforme monétaire, Aristote maintenant par deux mesures concrètes prises par Solon. En premier lieu, l'augmentation des mesures par rapport à celles de Phidon, la mine étant portée de soixante-dix à cent drachmes. En second lieu l'adaptation des poids à la monnaie, soixante-trois mines pesant un talent. Avant d'aborder l'étude de ces textes, exposons brièvement la signification fondamentale et la portée pratique des réformes soloniennes. Grâce à l'étude de Th. Mommsen (*), il ne fait plus de doute pour personne que Solon a substitué, en Attique, à l'étalon monétaire éginétique l'étalon euboïco-attique. On se qu'avant Solon, aussi bien en Attique que dans la presque totalité du Péloponnèse, circulait exclusivement un numéraire basé sur l'étalon éginétique, à l'exemple des « tortues » d'Égine, qui été les premières pièces grecques frappées vers 700 av. J. C. par Phidon d' Argos. Confirmation nous en est donnée par les numismatiques prouvant que la première frappe de monnaie athénienne date du temps de Solon et que cette émission relève du système euboïco-attique. Il est clair aussi que le but, assigné par Solon à sa réforme monétaire, visait avant tout l'affranchissement économique de sa patrie vis-à-vis du commerce d'Égine et des relations commerciales d'Athènes avec l'Eubée, Corinthe et Samos. L'épanouissement économique d'Athènes qui alla en s'am- plifiant au cours du vie siècle, est dû en grande partie à la politique réaliste de l'homme d'affaires que fut avant tout Solon. Mais ces considérations générales dépasseraient le cadre de cette étude. Nous voulons seulement attirer l'attention sur le fait que les deux étalons monétaires dont nous avons parlé plus haut, existaient encore au temps d'Aristote et que par conséquent ce dernier savait parfaitement bien de quoi il s'agissait. Examinons maintenant la première mesure monétaire énoncée dans le texte. Quand Aristote parle d'une mine, qui auparavant comptait 70 drachmes, il ne peut s'agir que de la mine éginétique qui, avant la réforme de Solon, était la seule connue sur les marchés at- tiques. Mais ce serait une erreur grave que de penser, comme on ferait volontiers après une première lecture, que dans ce même texte Aristote veut nous faire accroire que 70 drachmes éginétiques à 100 drachmes nouvelles, c.-à-d. euboïco-attiques, alors que nous savons, grâce aux recherches numismatiques, corroborées par le témoignage d'Androtion (2), que le change était en réalité d'environ (1) Römisches Münzwesen, p. 43 et sv. (2) Chez Plutarque, Solon, 15. Androtion ou Plutarque paraît avoir laissé tomber le chiffre décimal. Εκατόν γάρ έποίησε δραχμών την μναν πρότερον εβδομήκοντα και τριών οϋσαν Nous tenons à remercier ici M. Hombert d'avoir attiré notre attention sur un article de Th. Reinach (Zu Androtion Fr. 40, Hermes LXIII, 1928, pp. 238- ARISTOTE ET LA RÉFORME MONETAIRE DE SOLON 139 73,5 drachmes éginétiques pour 100 drachmes euboïco-attiques. Il sera montré plus loin que ce change était connu d'Aristote. Nous sommes convaincu qu'il faut entendre ici que Solon a simplement remplacé l'ancienne mine éginétique, qui comptait 70 drachmes, par la nouvelle mine euboïco-attique de 100 drachmes. Seulement cette assertion se heurte de front aux données élémentaires de la ancienne, nous enseignant que la mine de n'importe quel étalon monétaire grec est composée invariablement de 100 drachmes. Et pourtant, un aperçu des articles à ce sujet dans la Real-Encyclopädie nous prouve à quel point nos connaissances dans ce domaine sont encore sujettes à caution (x). C'est pourquoi nous avons adopté uploads/s3/ aristote-et-la-reforme-monetaire-de-solon.pdf
Documents similaires








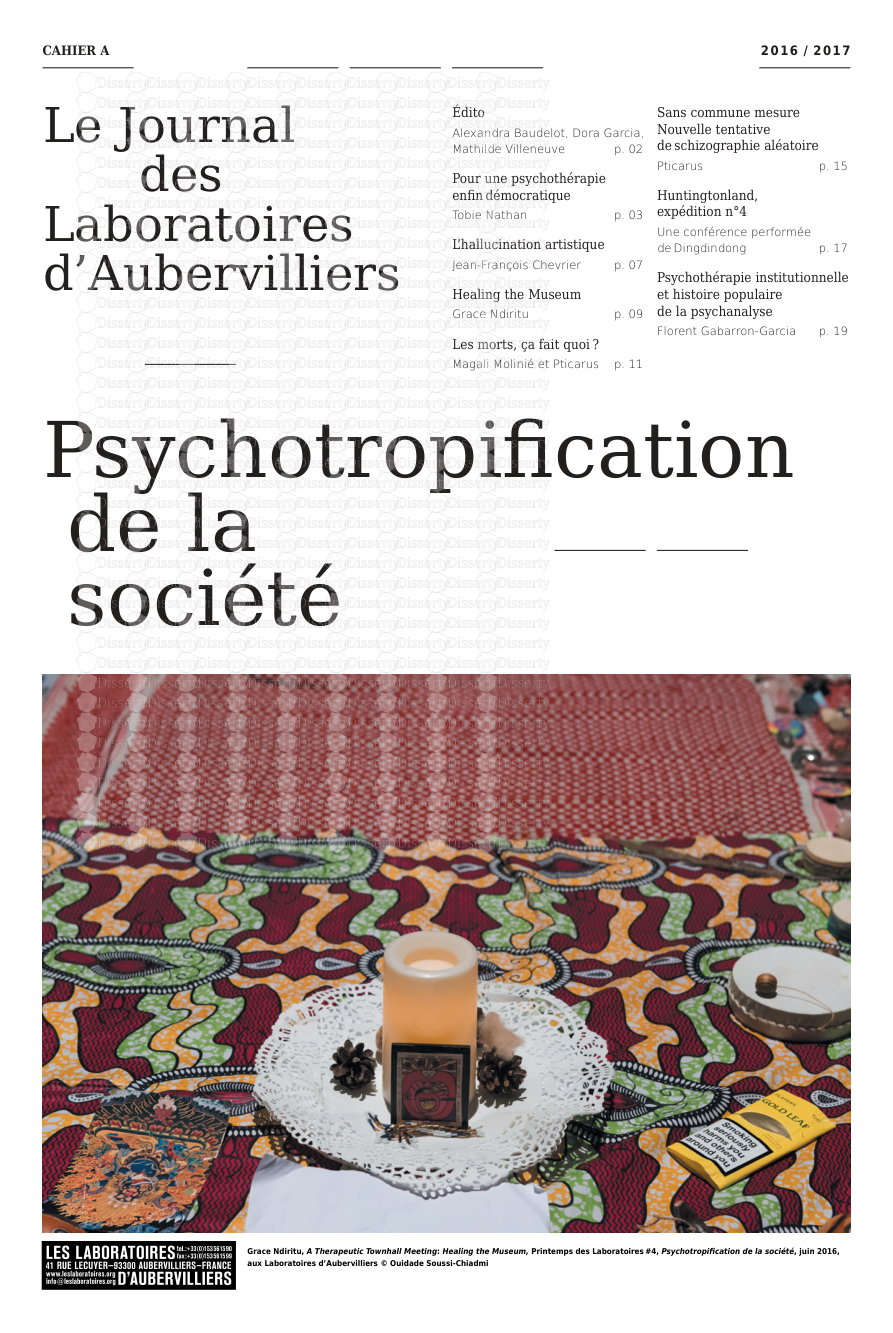

-
47
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 21, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.5046MB


