Résidences d'artistes en région Centre Document préparatoire à la journée d'étu
Résidences d'artistes en région Centre Document préparatoire à la journée d'étude « L'autorité de l'artiste en résidence » Université François Rabelais Tours - Mai 2014 SOMMAIRE Fiche 1 : Présentation générale (historique, définition, cadre réglementaire) Fiche 2 : Résidences « spectacle vivant » Fiche 3 : Résidences « arts plastiques » Annexe : Résidence « Mode d'emploi » (Tours) Fiche 4 : Résidences « auteurs » Fiche 5 : Résidences « cinéma » Fiche 6 : Résidences en milieu scolaire Annexe : Résidences « DRAAF » Fiche 7 : Résidences universitaires Fiche 1 : Introduction Historique Héritées de la pratique ancienne du mécénat, les résidences se sont construites sur un mode très empirique. De la diversité des pratiques et des expériences a émergé dans les années 1990 une forme de label « résidence » qui cache des réalités très hétérogènes selon les disciplines artistiques. D'abord impulsées par le ministère de la culture, en prenant appui sur le réseau national des institutions labellisées, avec l'objectif de soutenir la création et les émergences, les résidences répondent désormais à des objectifs partagés Etat/ collectivités territoriales sur la relation aux publics et l'irrigation culturelle du territoire. Inscrites dans les cahiers des missions et des charges des institutions labellisées, les modalités et moyens des résidences sont le plus souvent établis de façon concertée entre l'Etat et les collectivités territoriales dans le cadre des contrats d’objectifs et de moyens de ces structures. Cadre réglementaire L’une des premières circulaires qui, sans être exclusivement consacrée aux résidences, y consacre une place importante, est la note du 4 décembre 1997 « préparatoire à la mise en place de la déconcentration du dispositif des aides à la création et à la diffusion chorégraphiques, préalable à l'avis de la circulaire d'emploi des crédits déconcentrés ». Ce dispositif s'organise en trois axes : l'aide à la création chorégraphique l'aide aux résidences chorégraphiques l'aide à la diffusion chorégraphique 3 types de résidences chorégraphiques sont distinguées : la résidence – création la résidence – mission la résidence - implantation Ce sont ces trois formes de résidences qui se trouvent reprises sous une forme légèrement modifiée dans la circulaire n° 2006/001 du 13 janvier 2006 « relative au soutien à des artistes et à des équipes artistiques dans le cadre de résidences » qui élargit le propos à l'ensemble du champ artistique spectacle vivant, mais aussi arts plastiques et littérature. Troisième circulaire importante, la circulaire n° 2010/004 du 5 février 2010 relative à la dimension éducative et pédagogique des résidences d’artistes (charte nationale) précise le cadre dans lequel les ministères chargés de l’éducation nationale, de la culture et de la communication, et de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche souhaitent développer la dimension éducative et pédagogique des résidences d’artistes menées en liaison avec les écoles, collèges et lycées. Définition La circulaire n° 2006/001 du 13 janvier 2006 définit les résidences comme « des actions qui conduisent un ou plusieurs artistes d'une part, et une ou plusieurs structures, institutions ou établissements culturels d'autre part, à croiser, pour un temps donné, leurs projets respectifs, dans l'objectif partagé d'une rencontre avec le public. » En réalité certaines résidences, notamment en arts plastiques, ne comportent pas nécessairement de volet action culturelle. En revanche, les résidences spectacle vivant soutenues par la DRAC comportent contractuellement un volet « action en faveur des publics ». La diversité des résidences se traduit aussi dans leur fonctionnement. La sélection des artistes par appels à projets qui fait sens pour les arts plastiques n'est pas forcément la meilleure condition de mise en œuvre d’un projet pour le spectacle vivant, au vu du nombre important de lieux et d’équipes et de la structuration professionnelle du secteur. DRAC Centre – Résidences d'artistes – Avril 2014 Fiche 1 (1) Typologie des résidences La circulaire de 2006 ne méconnaît pas cette grande diversité des formes adoptées par les résidences mais s'efforce de la dépasser en définissant un cadre contractuel. 3 catégories de résidences sont distinguées : La résidence de création ou d'expérimentation Une résidence de création ou d'expérimentation contribue à donner à un artiste ou à un groupe d'artistes les conditions techniques et financières, pour concevoir, écrire, achever, produire une oeuvre nouvelle ou pour préparer et conduire un travail original, et y associer le public dans le cadre d'une présentation. La résidence de diffusion territoriale Au contraire de la catégorie précédente, la résidence de diffusion territoriale s'inscrit en priorité dans une stratégie de développement local. Elle a pour objectif de sensibiliser un territoire au domaine esthétique auquel se rattache l'activité des artistes accueillis, sans exclure toutefois les projets pluridisciplinaires. Elle s'inscrit dans un projet dont les artistes accueillis sont les principaux concepteurs et ne doit pas, a contrario, être assimilée à la commande d'une prestation de services définis par la structure support. Elle suppose par ailleurs que la structure d'accueil exerce une mission de développement local dans laquelle puisse s'inscrire l'équipe artistique invitée en disposant des moyens humains, techniques et logistiques nécessaires à la réalisation de l'objectif visé. La résidence-association La résidence-association répond au souhait d'installation d'un ou plusieurs artistes, d'une compagnie ou d'un ensemble constitué et à la nécessité d'une présence artistique de longue durée dans un établissement culturel. Cette présence « longue » peut revêtir diverses formes : de la création à la diffusion pour la réexploitation de répertoire donnant lieu à des séries de représentations, de l’association de l’artiste au choix de programmation à la définition d’un volet action culturelle/EAC. La résidence-association fait l'objet d'un contrat sur une ou plusieurs saison, associant les artistes, le lieu d'accueil, l'Etat et des partenaires locaux ou nationaux. Elle est reconductible le cas échéant. DRAC Centre – Résidences d'artistes – Avril 2014 Fiche 1 (2) Fiche 2 : Résidences Spectacle vivant Dans le domaine du spectacle vivant, la DRAC aide : - Soit directement : aide apportée à un lieu d’accueil qui n’est pas « labellisé » par la DRAC sous forme d'une aide au projet ou apportée à une compagnie ayant contractualisé avec un lieu pour un temps de résidence. La DRAC Centre a particulièrement développé ces aides dans le domaine du théâtre ces dernières années. Partant du constat du manque d’échanges entre les lieux et les compagnies, les aides à la résidence favorisent les dialogues entre compagnies et théâtres non labellisés, les dialogues entre la DRAC et les lieux généralement non aidés par l’Etat. Ce dispositif est également un moyen d’accompagner les projets artistiques émergents et les croisements inter-régionaux. NB : avec les contraintes budgétaires actuelles : peu de marge de manœuvre sur ce type de projets. - soit indirectement pour les résidences mises en œuvre par une structure labellisée soutenue en fonctionnement par la DRAC et dont la mission accompagnement des équipes / la résidence est inscrite dans son contrat d’objectifs. Toutes les structures labellisées du SV à l'exception de l'Opéra (soit 16 structures) accueillent ainsi d'une manière ou d'une autre des résidences, c'est d'ailleurs inscrit dans leur cahier des missions et des charges. Au total plus de 100 résidences par an sont soutenues directement ou indirectement par la DRAC suivant les années : de la mise à disposition de plateau sur quelques jours avec coproduction et restitution à un public – cas le plus courant - , jusqu’à la résidence longue sur une saison. Une procédure nationale existe également dans le domaine des musiques actuelles depuis 1998. Anciennement dénommée « résidences chanson » elle s’est ouverte ensuite à l’ensemble du champ des musiques actuelles et est mise en œuvre depuis 2008 par le CNV – Centre national de la chanson de la variété et du jazz sur des crédits délégués par la DGCA (environ 400 000 euros). Cette procédure a pour objectif de soutenir, dans le cadre de résidences, des créations qui réunissent un artiste et un lieu d’accueil autour d’un projet qui inclut de manière systématique une dimension d’action culturelle. De multiples initiatives donc dans le domaine du spectacle vivant, qui souvent prennent appui, d’une part sur le réseau des lieux labellisés par l’Etat, à même de disposer des moyens pour mettre en œuvre ce type de projet, et d’autre part peuvent bénéficier également des compagnies ou ensembles aidés par l’Etat. Quelques exemples notables : En 2012 L’ONJ - Orchestre National de Jazz à l’occasion de ses 25 ans pour des expérimentations "décentralisées" sur le territoire de la région Centre : une résidence territoriale de diffusion. La SMAC Le Petit Faucheux, Jazz à Tours et l’AJON (association de gestion de l’ONJ) ont organisé une «résidence» de l’ONJ en Région Centre de novembre 2011 à décembre 2012. Ce projet comportait un volet diffusion (de l’orchestre en grande formation à ses déclinaisons en petites formes «ONJ Dixcover(s)») mais aussi des actions pédagogiques et des actions culturelles. Une douzaine de partenaires se sont associés, tous différents et complémentaires : l’Hectare à Vendôme, la Scène nationale d’Orléans, le Moulin de la Vapeur à Olivet, l’Abbaye de Noirlac, la Ville de Chartres, le lycée Paul Louis Courrier, l’Agence Rurale de Développement Culturel de l’Echalier, la commune de Sainte Maure... uploads/s3/ cvl-residences-dossier-de-presentation-2014.pdf
Documents similaires

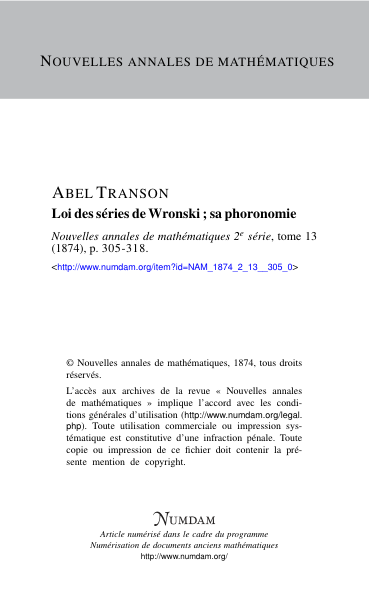








-
49
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 12, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1901MB


