Dada Pour les articles homonymes, voir Dada (homony- mie). Le mouvement dada ou
Dada Pour les articles homonymes, voir Dada (homony- mie). Le mouvement dada ou dadaïsme est un mouvement in- tellectuel, littéraire et artistique du début du XXe siècle, qui se caractérise par une remise en cause de toutes les conventions et contraintes idéologiques, esthétiques et politiques. Dada est issu d’une filiation expressionniste et sa vé- ritable naissance est le Manifeste littéraire, publié sous forme de tract, en février 1915, à Berlin, par Hugo Ball et Richard Huelsenbeck. Ceux-ci, en se déclarant « né- gationnistes », affirment : « Nous ne sommes pas assez naïfs pour croire dans le progrès. Nous ne nous occu- pons, avec amusement, que de l’aujourd’hui. Nous vou- lons être des mystiques du détail, des taraudeurs et des clairvoyants, des anti-conceptionnistes et des râleurs litté- raires. Nous voulons supprimer le désir pour toute forme de beauté, de culture, de poésie, pour tout raffinement intellectuel, toute forme de goût, socialisme, altruisme et synonymisme. » C’est à partir de ce texte que s’esquisse la position spécifique de dada. Dada connaît notamment une rapide diffusion internatio- nale. Dada met en avant un esprit mutin et caustique, un jeu avec les convenances et les conventions, son rejet de la raison et de la logique, et marque, avec son extrava- gance notoire et son art très engagé, sa dérision pour les traditions. Les artistes de dada se voulaient irrespectueux, extravagants, affichant un mépris total envers les « vieille- ries » du passé. Ils cherchaient à atteindre la plus grande liberté d'expression, en utilisant tout matériau et support possible. Ils avaient pour but de provoquer et d'amener le spectateur à réfléchir sur les fondements de la société. Ils cherchaient également une liberté du langage, qu'ils aimaient lyrique et hétéroclite. 1 Historique 1.1 Naissance du dada Le déclenchement de la Première guerre mondiale a transformé la capitale de la Suisse alémanique qu'était Zurich, en berceau d'un mouvement artistique inédit dont le « nom écrin » dada fut trouvé dans des circonstances légendaires et controversées en février 1916[1]. Début 1916, Hugo Ball, écrivain, traducteur de littéra- ture française (Henri Barbusse, Léon Bloy, Arthur Rim- Hugo Ball en costume cubiste au Cabaret Voltaire baud) et dramaturge allemand, exilé depuis 1915 et sa compagne Emmy Hennings, poète et danseuse, fondent le Cabaret Voltaire et en annoncent l'ouverture, dans la presse zurichoise, pour le 2 février. Ils invitent les « jeunes artistes et écrivains dans le but de créer un centre de divertissement artistique, […] à [les] rejoindre avec des suggestions et des propositions[2]. » Hugo Ball a l'idée de mêler la tradition des cabarets pa- risiens de la fin du XIXe siècle avec l'esprit du caba- ret berlinois d'avant-guerre, sous la figure emblématique de Voltaire dont il admire l'opposition à la religion[3]. Quelques jours auparavant, Marcel Janco, à la recherche d'un travail, passe dans la Spiegelstrasse, située dans le quartier malfamé de Zurich. Il entend de la musique sortir d'une boîte de nuit et « découvre un personnage gothique jouant du piano. » C'était Hugo Ball. Quand ce dernier apprit que Janco était peintre, il lui offrit les murs du ca- baret pour exposer. Janco revient au cabaret accompagné de ses amis Hans Arp, Sophie Taeuber et Tristan Tzara[4]. L'inauguration a lieu le 5 février, la salle est comble. Le mot « dada » est trouvé quelques jours après. Selon Henri Béhar, « pour tout le monde, désormais, dada est né à 1 2 1 HISTORIQUE Zurich le 8 février 1916, son nom ayant été trouvé à l'aide d'un coupe-papier glissé au hasard entre les pages d'un dictionnaire Larousse. Gardons-nous de ne pas croire aux légendes »[5] ! Dans une lettre de janvier 1921 adressée à des artistes new-yorkais, Tzara explique les circonstances de l'invention du nom dont il se garde de revendiquer la paternité : « […] j'étais avec des amis, je cherchais dans un dictionnaire un mot approprié aux sonorités de toutes les langues, il faisait presque nuit lorsqu'une main verte déposa sa laideur sur la page du Larousse – en indiquant d'une manière précise dada – mon choix fut fait. »[6] Au cours d'un entretien accordé à Arts magazine (New York, décembre 1982), Marcel Janco reconnaît qu'il n'était pas présent à ce moment-là : « Un après-midi, dans un café où nous nous retrouvions, j’ai appris que Tzara avait trouvé un nom pour le groupe, que tout le monde avait accepté. Ils cherchaient un nom parce que le mou- vement était devenu très important. Tzara avait trouvé le mot dans le Larousse. »[7] En 1921, l'apparente précision du témoignage de Hans Arp paraît disqualifiée par la description ironique des cir- constances : « Tzara a trouvé le mot Dada le 8 février 1916 à 6 heures du soir ; j’étais présent avec mes 12 en- fants lorsque Tzara a prononcé pour la première fois ce nom qui a déchaîné en nous un enthousiasme légitime. Cela se passait au Café de la Terrasse à Zurich et je por- tais une brioche dans la narine gauche. »[8] Dada apparaît pour la première fois dans l'unique numéro de la revue Cabaret Voltaire publiée en mai 1916. La controverse sur la naissance du nom dada vient de Richard Huelsenbeck qui en a toujours revendiqué la pa- ternité : « Le mot dada a été découvert par hasard dans un dictionnaire allemand-français par Hugo Ball et moi, alors que nous cherchions un nom de théâtre pour Mme Le Roy, la chanteuse du Cabaret. »[9] Même si une lettre de H. Ball à R. Huelsenbeck du 28 novembre 1916 semble soutenir sa version : « Et finalement j’y ai également dé- crit dada : le Cabaret et la Galerie. Tu auras donc eu le dernier mot de dada comme tu as eu le premier » la ré- currente revendication[10] de Huelsenbeck, ne résiste pas au fait que, appelé par Hugo Ball, il ne soit pas arrivé à Zurich avant le 11 février 1916[11] 1.2 Développement du dada Au bout de six mois, en juillet 1916, les protagonistes du Cabaret Voltaire veulent créer une revue et une ga- lerie. Mais Hugo Ball s’oppose à l'idée de faire de dada un mouvement artistique. Dans son manifeste, écrit à ce moment-là, il donne la primauté au mot, et hésite à par- ler d'art : « Le mot, messieurs, le mot est une affaire pu- blique de tout premier ordre. » Les dadaïstes créent tout de même une maison d'édition et une galerie. Le mou- vement dérive des spectacles spontanés des cabarets à la programmation d'événements. Il converge vers la danse, probablement grâce à Sophie Taeuber. La galerie dada, Sophie Taeuber-Arp, Composition verticale-horizontale (1916) ouverte en janvier 1917, se révèle un succès, mais elle ne dure que quelques semaines. Hugo Ball, finalement, voyait dans cette galerie un effort pédagogique pour ré- viser les traditions littéraires et artistiques. Durant cette expérience, Huelsenbeck quitte le mouvement zurichois, l'assimilant à un petit commerce artistique, pour aller re- lancer dada à Berlin[12]. À Berlin, Huelsenbeck passe quelque temps à étudier et réfléchir. Le mouvement est effectivement relancé à par- tir de quelques soirées au Café des Westens, en février 1918, par des artistes tels Huelsenbeck et Grosz. Leur posture est de se battre contre l'expressionnisme, de se présenter comme adversaires de l'art abstrait, d'aborder des sujets politiques tels la guerre (une nouveauté par rap- port à l'époque zurichoise), et d'intégrer le scandale maxi- mum dans leur démarche. Dada prend un tour nettement offensif. Le public afflue à Berlin pour voir le phénomène et des soirées dada s’organisent dans toute la ville. Les da- daïstes berlinois effectuent même une tournée en Tché- coslovaquie. Un peu avant la fin de la guerre, des mouvements dadas sont créés dans les grandes villes allemandes : Berlin, Ha- novre et Cologne. Les différents Manifestes parviennent à Paris, malgré la censure et le « bourrage de crâne » contre tout « germanisme ». Courant 1917 et 1918 le mouvement s’internationalise. À Zurich, l'improvisation des débuts est remplacée par une programmation plus institutionnalisée. De nouvelles personnalités, comme Walter Serner, émergent, et une vi- site au Cabaret Voltaire reste un passage obligé pour tous 1.3 La fin du dada 3 ceux qui veulent participer à dada. Ainsi Francis Picabia s’y présente, publie un numéro spécial de sa revue 391 sur Zurich, tout en réalisant, à New-York, avec Marcel Du- champ et d'autres, des événements dada, comme le salon des artistes indépendants, où est présentée (mais refusée) la Fontaine de Marcel Duchamp. Avec Arthur Cravan, dada investit aussi le domaine du sport, avec à Madrid un combat mémorable, dès avril 1916, pour le titre de cham- pion du monde de boxe[13]. Après quatre années passées à Zurich, Tristan Tzara dé- cide de rejoindre Paris en 1919, pour donner à l'anarchie dada un nouvel élan. Dès 1918 il avait commencé à col- laborer à une des revues dada parisienne, Littérature, ce qui l'avait rapproché des principaux artistes parisiens[14]. Au moins deux œuvres, qualifiées a posteriori de préda- daïstes, avaient déjà sensibilisé publics et artistes pari- siens à la manière uploads/s3/ dada.pdf
Documents similaires





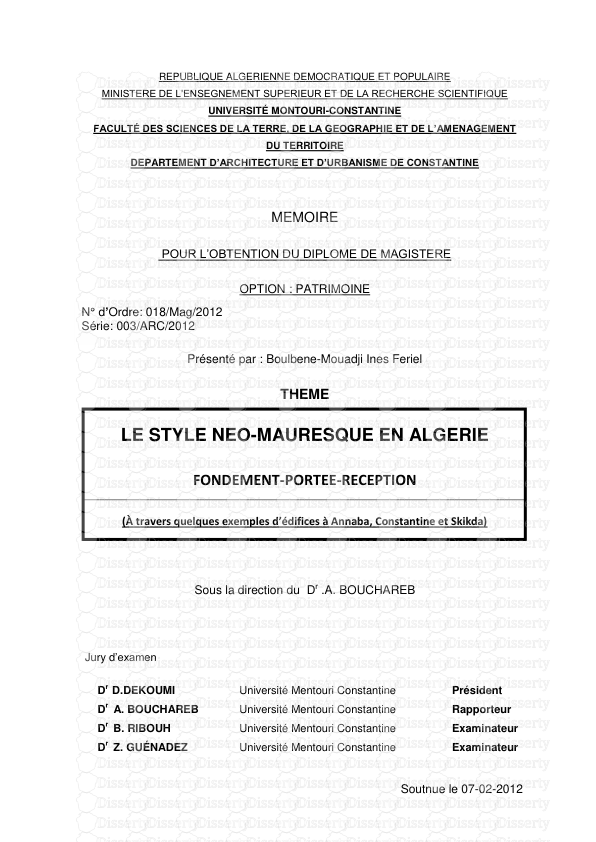




-
55
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 17, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.7684MB


