1 JAMMEH Saly TS2dc 2009-2010 Le langage du CORPS 2 3 SOMMAIRE Introduction Déf
1 JAMMEH Saly TS2dc 2009-2010 Le langage du CORPS 2 3 SOMMAIRE Introduction Définitions 1. Le langage du corps et du geste. 2. La représentation du corps en mouvement 3. Le corps agissant de l’ar tiste. 4. Corps du spectateur et percep tion. - Devant une œuvre (peinture, Installation, sculpture …) - Devant une représentions (danse, théâtre) 5. L’esthétique de l’être humain - Por traits 4 Introduction Le mouvement c’est la vie et cette notion n’est pas une invention de l’art du XXème, ni du XXIème siècle. Le geste est un mouve ment du corps ou d’un membre qui exprime une pensée ou une émotion. Selon Diderot, « le geste est quelque fois aussi sublime que le mot », et nous savons qu’il existe un langa ge élémentaire et instinctif des gestes. L’œil de l’artiste, à travers les époques, à tenté de le saisir. Le geste donne le ton à l’œuvre ; la position des mains, le jeu des corps, l’attitude du groupe sont fixés. Au chapitre du geste et de la vitesse, « La Victoire de Samothrace », sculpture réalisée en 190 av J.C et présentée au Louvre, en dit tout autant que les tableaux futuristes. D’ailleurs, Umberto Boccioni finit par lui emprunter certains éléments pour sa sculpture « Synthèse du dynamisme humain ». Au tournant des années 1910 le mouve ment, la vitesse, le dynamisme, le machi nisme, la modernité sont des termes marte lés dans toutes les capitales culturelles. Les raisons en sont la technique (l’automobile, le train, l’avion), l’accélération de la société industrielle et la science avec mouvement comme sujets de représentation, ces deux notions sont aussi nécessaires à l’élaboration du tableau, et sont aussi l’investissement pul sionnel de l’artiste dans son geste : le temps représenté, le temps du faire par l’artiste, le temps de la lecture de l’œuvre par le specta teur. À travers différents artistes et leurs démar ches, nous allons tenter d’aborder plusieurs axes de réflexion qui portent sur le corps et le 5 mouvement. Ce dossier présente des pistes sur les notions de corps et de mouvement. Que ce soit à tra vers l’histoire de l’art (peintures, sculptures, photographie…) ou des autres forme d’art dit art visuel (danse, théâtre, poésie, installa tions, mise en scène). 6 Quelques définitions Dictionnaire historique de la langue française. Éd. Le Robert. CORPS n, m est issu du latin corpus. Dès l’origine, corpus est pris dans l’opposition « corps- âme », opposé à anima ou animus, et désigne non seulement l’organisme vivant, mais aussi le corps inanimé, le cadavre, ainsi que tout objet pris dans sa matérialité, toute substance matérielle. Par métaphore, il est employé à propos de choses composées de parties (comme le corps est formé du tronc, de la tête et des membres), en particulier dans la vie politique, en parlant d’une assemblée, d’une « corporation ». MOUVOIR v.t est issu du latin movere « remuer, bouger » et surtout « se déplacer », égale ment employer au sens moral d’ « exciter, émouvoir ». MOUVEMENT n.m. « faculté de se mouvoir », en particulier « action, manière de bouger une par tie du corps, le corps ». Depuis le XVIIème siècle, il est employé spécialement dans le langage de la critique artistique pour l’animation, la sensation de mouvement évoquée à la vue d’une œuvre d’art, à la lecture d’une œuvre, d’une phrase. HAPPENING: Forme d’action art proche du pop art qui se développe dans les années 1960 et vise à l’effacement de la frontière entre l’art et la vie de tous les jours, l’artiste et son public, organisant de grandes actions le plus souvent en plein air, dont le déroulement est indiqué dans son ensemble par l’artiste mais laisse place aux interprétations. Le happening ne comporte pas de répétition et n’a lieu en règle générale qu’une fois. Il se fonde sur la vue et le toucher. L’intégration du public est censée amorcer une transformation de ses habitudes visuelles et conceptuelles. 7 Le terme provient des 18 happenings in 6 Parts organisés par A. Kapro en 1959 à New York. INSTALLATION: Certes, les œuvres ont toujours été « installées » dans les espaces d’exposition. Mais dans l’art contemporain, le mot installation désigne des œuvres conçues pour un lieu donné, ou du moins adaptées à ce lieu. Ses divers éléments constituent un environnement qui sollicite une parti cipation plus active du spectateur. Pour éviter les connotations statiques de ce terme, certains artistes préfèrent parler de dispositifs. PERFORMANCE: Le mot performance, directement emprunté à l’anglais (ou il y a le sens du spec tacle, représentation) sert aujourd’hui à désigner toutes les activités artistiques qui se déroulent devant un public et font intervenir la musique (art sonore), la danse, la poésie, le théâtre ou la vidéo, ou une quelconque combinaison de ces ingrédients. 8 1. Le langage du corps et du geste A lors même que l’artiste n’a pas encore l’habileté technique pour exprimer le geste, il cherche pourtant le moyen de l’exprimer. Il est diffi cile de dater le moment où les sculpteurs grecs ont détaché les bras du corps et de leur don- né différentes attitudes, de dater le passage de la frontalité à la liberté des mouvements du corps. Polyclète, vers 450, serait le premier, dans la statuaire, à faire porter le poids du corps sur une seule jambe. La frontalité caractérise l’art jusqu’en 500, par la suite, les mouvements ne peu- vent être représentés que d’une manière raide et imparfaite. Une fois les diffi cultés techniques surmontées et l’artiste devenu maître de son motif et de sa manière, il part à la conquête du domaine des gestes et des attitudes possibles. 9 Aphrodite du type du Capitole, Rome, IIème siècle apr. JC, marbre Pierre Narcisse Guérin Jeune fi lle en buste, 1794 Johann Heinrich Füssli, Lady Macbeth, 1783, toile Eugene Delacroix, La Liberté guidant le peuple, 1830, toile François Gérard, Psyché et Amour, 1798, toile Ary Scheffer, Francesca et Paolo, 1855, toile Bosio, Hercule combat- tant Achéloüs, 1814-24, bronze Hercule et le dragon, XVIIème, d’après Jean de Bologne, bronze Quentin Metsys, Le Prêteur et sa femme, 1530, Bois La Tireuse de cartes, Lucas van Leyden, 1508, bois Georges de La Tour, Le Tricheur, XVIIème s, toile 10 Mais durant toute cette évolution les représentations, les thèmes, les sujets, ont changés, ce qui a ouvert les portes sur des nouvelles perspectives, sur un nouveau regard. Les artistes grecs étudient de façon minutieuse l’anatomie et les proportions, et les représen- tations fi gées font place à des images de plus en plus réalistes. Générations après générations, les parties du corps sont fi dèlement reproduites. On s’attache alors au mouvement et aux po- ses plus naturelles. Pour cela, on évite la symétrie des mouvements (par le contrapposto). Les représentations d’Apollon, Venus, et autres modèles grecs par ces artistes ont ainsi imposé leurs canons de beauté et d’harmonie, qui seront redécouverts et glorifi és par les artistes de la Renaissance. C’est bien évidemment sur l’Art de l’Antiquité que les maîtres italiens ont fondé leurs canons esthétiques, mais l’art de la Renaissance a toutefois suivi son propre cheminement, avec des supports différents (peinture sur toile, fresque, sculpture) et un grand nombre d’innovations techniques (la peinture à l’huile, la perspective linéaire, le sfumato, le trompe-l’oeil,...), qui lui confèrent des caractéristiques propres. Le corps nu est représenté essentiellement dans des oeuvres sur des thèmes mythologiques. L’homme qui marche de Rodin 1877 L’homme qui marche de Giacometti 1960 11 Le body art ou art corporel Suite aux premières performances ou happenings du Black Moutain College aux États-Unis, la mise en scène du corps, le plus souvent, celui de l’artiste lui même est devenu un nou- veau médium de transfi guration du corps. En France, c’est notamment avec Michel Journiac, dans les années 1970, que l’art corporel, où apparaissent très souvent des corps nus, a émergé. Plus récemment, Ana Mendieta, explorant les rites yoruba de sa culture cubaine d’origine, entrait nue dans un cratère, dans un mouvement d’appel à son corps embryonnaire. Les performances d’Yves Klein, où le corps de jeunes fi lles mêlé à de la peinture bleue laisse son empreinte sur des toiles, est également une scène de body-art célèbre Yves klein, Atropométrie,1960 Michel Journiac, Messe pour un corps,1969 12 2. La représentation du corps en mouvement A vec le futurisme italien, l’artiste adopte le parti de la représentation du mouvement et sélectionne ses motifs dans la vie moderne, même si un grand nombre d’entre eux comme le sport ou l’héroïsme datant de l’Antiquité, et il s’appuie sur la recherche optique pour justifi er des effets stéréoscopiques. Sous l’infl uence des manifestes italiens, des artistes comme Duchamp ou le belge Khnopff passent d’une fi guration plurielle d’une même personne à la description de son déplacement. Ils empruntent à la recherche photographique des années 1880 les images séparées de Muybridge et à Marey, la chronophotographie qui lie dans un même fondu les mouvements successifs du corps. Giacomo Balla, Les rythmes de l’archer, 1912 Bragaglia, La Gifl e, 1913 Umberto Boccioni, Synthèse uploads/s3/ dossier-atc.pdf
Documents similaires





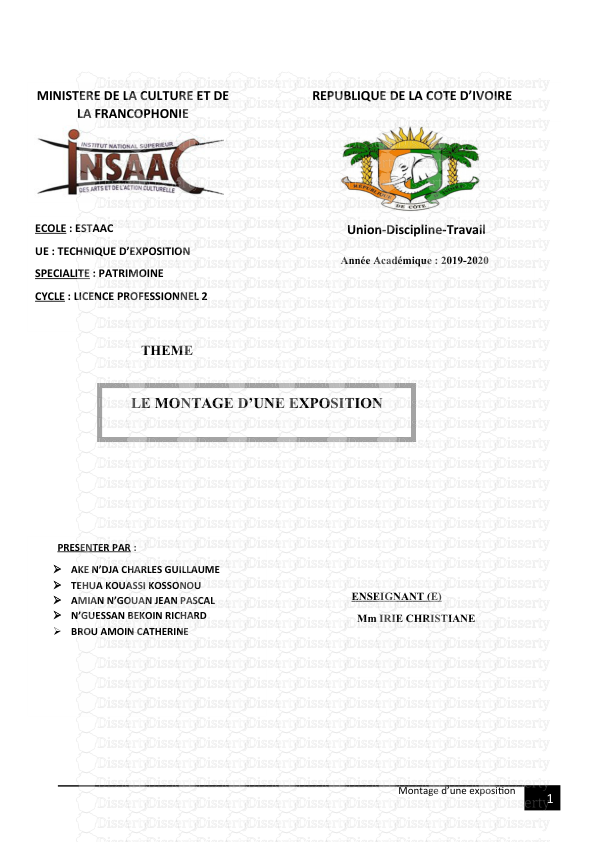




-
82
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 19, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 6.3817MB


