164 À gauche : Iannis Xenakis, Premières esquisses et plan au sol pour le Pavil
164 À gauche : Iannis Xenakis, Premières esquisses et plan au sol pour le Pavillon Philips, 1956. Le Corbusier avait délégué la conception du Pavillon Philips pour l’exposition universelle de Bruxelles de 1958 à Xenakis. Ci-dessus : Iannis Xenakis, Études pour les glissandi de Metastasis, 1954. « Le nombre nombrant est rythmique, non pas harmonique. Il n’est pas de cadence ou de mesure : c’est seulement dans les armées d’Etat, et pour la discipline et la parade, qu’on marche en cadence. » « Le rythme est l’Inégal ou l’Incommensurable. » Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux. Introduction : rythmicité et plasticité Quelle est la nécessité du concept de Rythme dans le champ des arts plastiques ? Un usage restreint du terme “rythme” nous a habitués, sous l’influence notable de la musi- cologie qui en a accaparé l’usage légitime, à limiter son champ d’application aux phé- nomènes temporels. Parler de rythme à propos des arts plastiques ne pourrait alors relever que d’un usage métaphorique du terme, par analogie avec ces arts de la durée que sont la musique et la danse, voire le théâtre et le cinéma. Mais, en toute rigueur, un tel clivage aurait également pour conséquence de métaphoriser l’usage que l’on fait du terme “mouvement” : si l’on voulait cantonner le dessin et la peinture à une stricte spatialité inerte, il faudrait en effet considérer un tableau comme le Derby d’Epsom de Géricault comme une simple représentation truquée du mouvement, sans prise direc- te sur le réel qu’il représenterait, et ne voir dans les calligraphies chinoises que les traces figées de traits qui ne sont plus. Une telle conséquence aurait presque valeur d’une réfu- tation par l’absurde si des siècles d’un platonisme dogmatique ne nous avaient condi- tionnés à regarder les images de l’art comme des simulacres. En réalité, la plasticité n’est pas moins capable de mobilité et de rythmicité que la tem- poralité éthérée de la musique. Sans nier les différences essentielles entre les arts, l’esthétique du XXe siècle est d’une certaine manière vouée à un vocabulaire de plus en plus transversal, qui transgresse leurs frontières. De même que la musique s’est livrée à une “spatialisation” du son, de même la peinture incarne à sa manière le rythme et en revendique un usage au sens propre. La peinture investit réellement le rythme, et invente des moyens proprement picturaux de faire le rythme. Le Nu descendant un esca- lier de Duchamp fait un rythme comme seule la peinture peut le faire. Un tel système 165 Éléments d’arythmétique Le rythme selon Whitehead et Deleuze Frédéric Bisson d’échanges entre les arts n’est donc pas purement lexicologique, mais ontologique. La racine de la séparation entre la peinture et la musique se trouve dans la séparation plus fondamentale entre l’espace et le temps. L’erreur commune revient à considérer que le mouvement s’effectue dans un espace immobile et abstrait, comme dans une pièce vide, comme s’il pouvait le survoler sans être déjà pris en lui, impliqué en lui, sans mordre sur lui. Le concept de Rythme permet au contraire de ressaisir le mouvement en deçà de la bifurcation entre le temps et l’espace. Les arts plastiques prolongent en ce sens une rythmicité déjà présente dans la nature. Messiaen a vu le prototype des “rythmes non rétrogradables” qu’il met en musique dans les dessins symétriques des ailes de papillons1. Plus encore, les nervures d’une feuille d’arbre, par le jeu complexe de symétrie et d’irrégularité qu’elles manifestent, ne sont pas moins rythmiques que le flux et le reflux des vagues sur la plage. Philosophe du rythme, Ludwig Klages a essayé de le ressaisir comme la matrice de l’espace et du temps : « les rainures de la coquille d’une noix bien mûre ne suivent aucune règle, ce qui les rend d’ailleurs uniques, mais sont parfaitement rythmiques, de même que les plissements labyrinthiques du noyau, les chemins tortueux que le vers du bois dessine dans l’écorce de l’arbre »2. De même, un relief ou un paysage semble fait de processus rythmiques : « ne disons-nous pas fort à propos qu’un chemin nous “mène” ou nous “conduit” quelque part, “traverse” une prairie, “serpente” le long d’un ruisseau, que la rigide spirale “tourne”, que la vrille “se hisse”, que l’arête d’une montagne “grimpe” jusqu’au sommet, qu’une falaise “plonge” à pic »3. Si une écriture, un dessin, une peinture ou un édifice architectural peuvent à leur tour être dits rythmés, ce n’est pas seulement par analogie avec les mouvements rythmiques de la main qui les ont produits dans le temps, encore moins avec les mouvements oculaires que le spectateur doit effectuer pour en faire la synthèse. Goethe a qualifié l’architecture de musique pétrifiée : cela ne veut pas dire que la pierre aurait tout perdu de la fluidité de la musique. Selon le mythe, c’est en mouvant les pierres par le son de sa lyre qu’Amphion a construit les murs de la ville de Thèbes, pétrifiant les accords musicaux dans les proportions architecturales qui continuent de les manifester. La structure garde et prend sur soi le rythme vif de sa genèse. Les œuvres d’art plastiques sont intrinsèquement rythmiques, au même titre que les gestes qui les ont fait naître. Les mouvements du spectateur ne font à leur tour que développer une temporalité déjà enveloppée dans les choses mêmes, comme la marche en pleine nature, quand elle parvient à un degré presque somnambulique de communion affective avec l’espace, ne fait que développer la temporalité intrinsèque du paysage et du relief qu’elle épouse. L’espace est intérieurement travaillé de forces plastiques que le mouvement temporel actualise. Le concept de “plasticité” désigne ainsi l’élément dynamique de l’espace : elle est ce qui dans l’espace échappe à l’inertie, l’énergie potentielle qui couve dans la matière sous son apparente immobilité. Cette énergie se manifeste physiquement dans les transitions de phases, quand la matière passe soudainement d’un état à un autre, comme dans le cas remarquable du brouillard givrant. Mais ce qui paraît soudain se prépare en réalité dans une vie secrète. C’est la force propre de l’art que de rendre visibles les forces plastiques invisibles de la matière qu’il travaille, en réinventant les points critiques de température (cristallisation, fusion, congélation, condensation, 166 1. Claude Samuel, Entretiens avec Olivier Messiaen, Paris, Belfond, 1967, p. 83 : « Quand les papillons sont enfermés dans leur chrysalide, leurs ailes sont repliées et collées l’une contre l’autre ; le dessin de l’une se reproduit donc en sens inverse sur l’autre. Plus tard, lorsque les ailes se déploieront, il y aura un dessin et des couleurs rétrogrades sur l’aile droite par rap- port à l’aile gauche et inversement, le corps de la chenille, le thorax et les antennes placés entre les deux ailes constituant la valeur centrale. Ce sont de merveilleux rythmes non rétro- gradables vivants ». Messiaen appelle ces rythmes “non rétrogradables” parce qu’ils ne sont pas différents lorsqu’on les lit de gauche à droite ou de droite à gauche. 2. Ludwig Klages, Vom Wesen des Rhythmus (1922), tr. fr. La nature du rythme, Paris, L’Har - mattan, 2004, p. 71. 3. Ibid., pp. 74-75. surfusion, etc.) à l’intérieur même d’un seul état apparemment homogène. La plasti- cité nomme cette puissance de fluxion qui permet à la spatialité d’accueillir le Rythme qui va l’organiser. 1. Les aventures du pythagorisme La rythmanalyse n’est pas seulement spéciale, mais générale. Si elle n’implique aucune équivocité ou analogie dans l’usage généralisé du concept de Rythme, quelle est donc la raison du Rythme ? Qu’est-ce qui autorise à parler univoquement de rythme dans la nature et dans les arts, en musique, en architecture, en peinture ? Suivant une étymologie hypothétique, rhuthmos est parent d’arithmos, le nombre. Cette étymologie suggère ainsi que toute expérience du Rythme serait, pour plagier ce que dit Leibniz de la musique, un exercice inconscient d’arithmétique, où l’âme ne s’aper- çoit pas qu’elle compte4. La main de Matisse qui danse au ralenti devant la toile5 ne semble-t-elle pas arithméticienne ? Phénoménologue et humaniste, Merleau-Ponty a voulu rejeter l’arithmétique hors du geste esthétique : « Matisse se trompait s’il a cru, sur la foi du film, qu’il eût vraiment opté, ce jour-là, entre tous les tracés possibles et résolu, comme le Dieu de Leibniz, un immense problème de minimum et de maxi- mum ; il n’était pas démiurge, il était homme »6. Il n’est cependant pas besoin de sup- poser une conscience mathématique extralucide pour voir les nombres gouverner la Nature : les cristaux apériodiques, les fleurs pentamères, les organismes marins comme le nautilius pompilius ou le corps humain participent spontanément au nombre d’or qui régit leur symétrie dynamique, pentagonale7. Les fleurs ne contemplent pas seu- lement l’eau, l’azote, le carbone, les chlorures et les sulfates qu’elles contractent8, mais aussi les nombres que leur calice “préhende”, comme ceux de la Victoria Regia ou de la Grande Consoude (Symphytum officinale). La croissance rythmique des êtres est ainsi inséparable d’un calcul sans conscience. Le geste du peintre n’est pas enfermé dans une humanité opaque et mystérieuse, mais participe à son tour de cette spontanéité uploads/s3/ elements-darythmetique-le-rythme-selon-pdf.pdf
Documents similaires






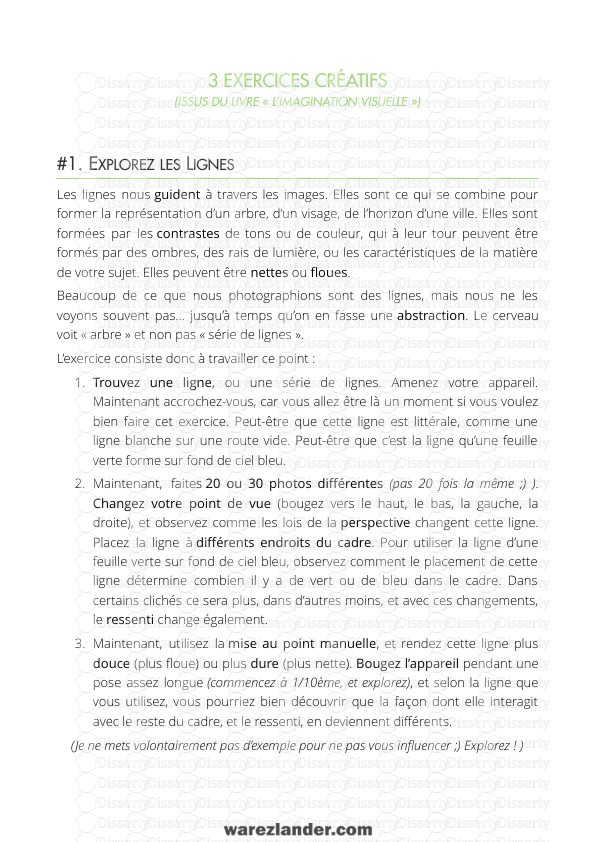



-
35
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 04, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.8571MB


