MPRA Munich Personal RePEc Archive The determinants of female entrepreneurship
MPRA Munich Personal RePEc Archive The determinants of female entrepreneurship in Dakar Senegal Ibrahima Dia and Jean Bonnet and Rafik Abdesselam Centre de Recherche en Economie et en Management, Laboratoire Conception de l’Action en Situation (COACTIS) 10 March 2017 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/81293/ MPRA Paper No. 81293, posted 11 September 2017 23:30 UTC The determinants of female entrepreneurship in Dakar (Senegal) By Ibrahima DIA* Jean BONNET ** Rafik ABDESSELAM*** * Docteur en Sciences Economiques Générales, Chercheur associé au Centre de Recherche en Economie et en Ménagement Université de Caen Normandie/UMR CNRS 6211 Attaché Temporaire d’Enseignements et de Recherches Université des Antilles Pôle Martinique ** Professeur associé au Centre de Recherche en Economie et en Management Université de Caen Normandie/ UMR CNRS 6211 *** Professeur associé au laboratoire Conception de l’Action en Situation (COACTIS), Université Lumière Lyon 2 Abstract: The purpose of this paper is to understand the determinants of women's entrepreneurship in the informal sector in Dakar (Senegal). It aims mainly at a better knowledge of women's involvement in economic activities through the informal sector. The paper does this in three ways: first, by defining the informal sector and the female entrepreneur through a literature review; second, by adapting theoretical models in entrepreneurship to the Senegalese informal sector and by defining the concept of entrepreneurial culture ; third, by making a discriminating factorial analysis and a barycentric analysis, based on primary data collected from 153 women in Dakar, to describe a woman’s belonging to a category of creation: creation in the formal or large informal sector, creation in the small informal sector and non- creation. The results show that the woman entrepreneurial activity from one sector to another depends on her human, social and cultural capital and confirm the importance of social capital in the female entrepreneurship of the developing countries where the informal sector is highly developed. Jel code : L26, E26, M13, M14 Les déterminants de l’entrepreneuriat féminin à Dakar (Sénégal) Par Ibrahima DIA* Jean BONNET** Rafik ABDESSALAM*** Résumé : L’objectif de cet article est de comprendre les déterminants de l'entrepreneuriat féminin dans les secteurs informel et formel à Dakar (Sénégal). Il vise principalement à mieux comprendre la participation des femmes aux activités économiques du pays. Pour ce faire, nous avons d’abord défini les concepts de secteur du petit informel, de secteur du gros informel, de secteur formel et de la femme entrepreneure à travers une revue de la littérature. Ensuite, nous avons présenté trois modèles théoriques d’intention entrepreneuriale adaptés aux entrepreneures sénégalaises et défini le concept de culture entrepreneuriale. Pour finir nous avons effectué une analyse factorielle discriminante et une analyse barycentrique, sur des données primaires collectées auprès de 153 femmes à Dakar, pour décrire l’appartenance d’une femme à une catégorie de création : création dans le secteur formel ou gros informel, création dans le secteur du petit informel et la non création. Les résultats montrent que le lancement d’une activité d’un secteur à l’autre dépend du capital humain, social et culturel de l’entrepreneure et confirment l’importance du capital social dans l’entrepreneuriat féminin des pays en développement où le secteur informel est très développé. Mots clés : entrepreneuriat féminin, secteur informel, modèles intentionnels, analyse discriminante, Dakar. Code Jel : L26, E26, M13, M14 1. Introduction Les premiers travaux sur l’entrepreneuriat féminin sont apparus vers 1970 aux Etats-Unis, en Angleterre et dans les pays de l’OCDE. Entre 1970 et 1980, il y a eu un regain de publication à ce sujet notamment avec les articles de Schereir en 1975, Schwartz en 1976 et Lyons en 1979. Depuis l’article pionnier « Entrepreneurship a new female frontier » de Schwartz en 1976 publié dans le « Journal of Contemporary Business », le nombre de publications en entrepreneuriat féminin a connu une croissance fulgurante. Ainsi de 1990 à 2014 beaucoup d’études sur ce thème ont vu le jour mais l’objectif ultime de l’ensemble de ces recherches a été de mettre en évidence les théories de genre. Dans ces études les femmes sont le plus souvent représentées comme étant plus vulnérables que les hommes (Bosma & Harding, 2007 ; A. Robb, 2009), disposant d’un faible niveau d’instruction (Davidsonn & Honig, 2003) ; Arnius & Minniti, 2005), disposant d’un faible réseau relationnel (Aldrich & Cliff, 2003 ; Bosma et al., 2004 ; Kraus, 2009) et de peu de ressources financières (Riding & Swift, 1990 ; Bel, 2009 ; Nelson & Vosmek, 2014 ; Stivell & Zhan, 2014). En Afrique, quelques travaux de recherches ont été menés sur ce sujet (Tchoussi, 2002 au Cameroun ; Smith-Hunter, 2013 au Ghana ; Guerrin, 2002 au Sénégal ; Rachidi, 2006 au Maroc ; Kane, 2009 en Mauritanie). Ces recherches considèrent l’entrepreneuriat féminin comme source de croissance, d’emplois et d’innovation. L’entrepreneuriat féminin est considéré dans tous les pays africains, par les gouvernants, les analystes et les bailleurs de fonds, comme l’un des moteurs du développement et l’une des sources d’emplois et est mis en avant dans toutes les politiques économiques et sociales (Stivell & Zhan, 2014). L’entrepreneuriat ou la microentreprise, plus visible dans le secteur informel des pays africains, comprend toutes les activités économiques qui peuvent résorber le problème d’accès à l’emploi dans ces économies en situation de rareté de l’emploi formel. Depuis l’apparition du terme « secteur informel » en 1972 dans le rapport du BIT1 sur le Kenya, beaucoup d’études ont vu le jour sur ce secteur notamment sur le travail informel. Il concentre principalement le travail des femmes d’après l’étude réalisée par les Nations-Unies en 2000 dans onze pays africains (Gambie, Madagascar, Côte d’Ivoire, Mali, Maroc, Sénégal, Tanzanie, Zambie, Burkina Fasso, Zimbabwe, Ethiopie). Les structures économiques de ces pays ne créent pas d’opportunités de travail. Les femmes s’appuient sur leurs propres initiatives pour créer leur propre entreprise dans un secteur facile d’accès. Les femmes africaines ont un plus grand rôle économique comparées aux autres femmes à travers le monde (Stivell & Zhan, 2014). Elles sont responsables de 70% de la population agricole et 60% du secteur informel. Ces deux secteurs combinés font 75% de l’économie africaine. Au Sénégal, il existe peu ou pas d’études sur l’entrepreneuriat féminin et notamment sur les déterminants de l’entrepreneuriat des femmes. Le secteur informel est une composante majeure de l’économie sénégalaise et pourvoit entre 60 et 70% du PIB selon le secteur d’activité (DPS2 2002). Il abrite toutes les couches sociales et emplois 80% de la population active sénégalaise (ANDS3 2012). Les femmes y sont majoritaires et on dispose de peu d’informations les 1Rapport du Bureau International du Travail sur le Kenya de 1972 2 Document de Prévisions Statistiques du Sénégal 2002 3 Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie du Sénégal concernant. L’étude de l’entrepreneuriat féminin trouve donc toute son importance pour l’économie sénégalaise d’autant plus que c’est un phénomène à inscrire dans le processus de transition de l’économie du pays. A partir d’une étude empirique menée dans la région de Dakar, cette étude s’intéresse à l’analyse des déterminants de la création d’entreprise des femmes. L’objectif de la présente recherche est de répondre à la question suivante : quels sont les facteurs qui déterminent et influencent fortement l’avènement entrepreneurial chez les femmes sénégalaises en se basant sur quelques modèles théoriques existant dans ce domaine ? Pour ce faire, nous avons réalisé cette étude en utilisant des données essentiellement primaires, collectées auprès de 67 femmes évoluant dans le secteur du petit informel, 19 dans le secteur du gros informel, 21 dans le secteur formel et 46 femmes non entrepreneures. Les résultats laissent apparaître l’importance des caractéristiques personnelles des créatrices et l’environnement local dans lequel évoluent les femmes sur leur décision de créer. La présente recherche comporte trois parties. La section 2 expose le cadre théorique de l’entrepreneuriat féminin avec l’adaptation des modèles théoriques d’intention entrepreneuriale de Shapero (1975), d’Azjen (1991) et de Hayton et al (2002) aux femmes entrepreneures sénégalaises. La section 3 expose la méthodologie que nous avons adoptée avec la présentation des données collectées et la méthode d’analyse discriminante. La section 4 expose nos résultats. La section 5 explicite l’interprétation des résultats de l’étude empirique sur l’entrepreneuriat féminin au Sénégal. Nous terminons avec la conclusion au niveau de la section 6. 2. Cadre théorique 2-1 Définition de quelques concepts clés L’étude de l’entrepreneuriat féminin dans le secteur informel ne saurait se faire sans une définition adéquate du secteur ainsi que la définition de la femme entrepreneure dans ce secteur qui en découle. 2-1-1 Définition du Secteur Informel (S.I) L’une des difficultés que rencontre le chercheur sur le secteur informel est l’absence d’une définition largement acceptée de ce secteur. Plusieurs définitions du secteur informel ont vu le jour depuis le rapport de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) sur le Kenya en 1972. Le choix d’une définition du secteur par un chercheur détermine considérablement la méthodologie d’échantillonnage pour la collecte de données, ainsi que les conclusions obtenues et les recommandations de politiques qui s’en suivent (Benjamin N. et al., 2012). Dans ce papier nous avons retenus les définitions de l’OIT de 1972, de l’Institut El Amouri de Tunis de uploads/s3/ fiche-lecture-2-2.pdf
Documents similaires







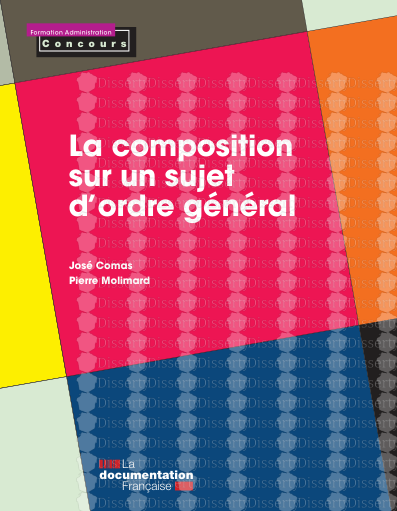


-
32
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 31, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.3001MB


